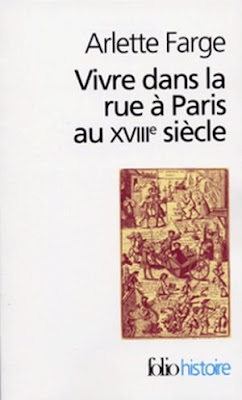On avait déjà consacré quelques billets à l'ouvrage de Jean-Clément Martin (voir ici).
Tenu au gré de mes humeurs, ce blog raconte mon amour du XVIIIè siècle.
mercredi 20 décembre 2017
vendredi 15 décembre 2017
Louis XV, par Sainte-Beuve (1)
Un portrait sans concessions de Louis XV par Sainte-Beuve.
Qu’était-ce que Louis XV? On l’a beaucoup dit, on ne l’a pas assez dit : le plus nul, le plus vil, le plus lâche des coeurs de roi. Durant son long règne énervé, il a accumulé comme à plaisir, pour les léguer à sa race, tous les malheurs. Ce n’était pas à la fin de son règne seulement qu’il était ainsi; la jeunesse elle-même ne lui put jamais donner une étincelle d’énergie. Tel on le va voir au sortir des bras de la Du Barry, dans les transes pusillanimes de la maladie et de la mort, tel il était avant la Pompadour, avant sa maladie de Metz, avant ces vains éclairs dont la nation fut dupe un instant et qui lui valurent ce surnom presque dérisoire de Bien-aimé. Il existe un petit nombre de lettres curieuses de Mme de Tencin au duc de Richelieu, écrites dans le courant de 1743; informée par son frère, le cardinal, de tout ce qui se passe dans le Conseil; cette femme spirituelle et intrigante en instruit le duc de Richelieu, alors à la guerre. Rien que ses propres phrases textuelles ne saurait rendre l’idée qu’elle avait du roi; il est bon d’en citer quelque chose ici comme digne préparation à la scène finale qui eut lieu trente ans plus tard.
Qu’était-ce que Louis XV? On l’a beaucoup dit, on ne l’a pas assez dit : le plus nul, le plus vil, le plus lâche des coeurs de roi. Durant son long règne énervé, il a accumulé comme à plaisir, pour les léguer à sa race, tous les malheurs. Ce n’était pas à la fin de son règne seulement qu’il était ainsi; la jeunesse elle-même ne lui put jamais donner une étincelle d’énergie. Tel on le va voir au sortir des bras de la Du Barry, dans les transes pusillanimes de la maladie et de la mort, tel il était avant la Pompadour, avant sa maladie de Metz, avant ces vains éclairs dont la nation fut dupe un instant et qui lui valurent ce surnom presque dérisoire de Bien-aimé. Il existe un petit nombre de lettres curieuses de Mme de Tencin au duc de Richelieu, écrites dans le courant de 1743; informée par son frère, le cardinal, de tout ce qui se passe dans le Conseil; cette femme spirituelle et intrigante en instruit le duc de Richelieu, alors à la guerre. Rien que ses propres phrases textuelles ne saurait rendre l’idée qu’elle avait du roi; il est bon d’en citer quelque chose ici comme digne préparation à la scène finale qui eut lieu trente ans plus tard.
« Versailles, 22 juin 1743... Il faudrait, je crois,
dit-elle, écrire à Mme de La Tournelle (Mme de Châteauroux)
pour qu’elle essayât de tirer le roi de l’engourdissement où
il est sur les affaires publiques. Ce que mon frère a pu lui dire
là-dessus a été inutile : c’est, comme il vous l’a
mandé, parler aux rochers. Je ne conçois pas qu’un homme
puisse vouloir être nul, quand il peut être quelque chose.
Un autre que vous ne pourrait croire à quel point les choses sont
portées. Ce qui se passe dans son royaume paraît ne pas le
regarder : il n’est affecté de rien; dans le Conseil, il est d’une
indifférence absolue; il souscrit à tout ce qui lui est présenté.
En vérité, il y a de quoi se désespérer d’avoir
affaire à un tel homme. On voit que, dans une chose quelconque,
son goût apathique le porte du côté où il y a
le moins d’embarras, dût-il être le plus mauvais. » Et
plus loin: « Les nouvelles de la Bavière sont en pis... On
prétend que le roi évite même d’être instruit
de ce qui se passe, et qu’il dit qu’il vaut encore mieux ne savoir rien
que d’apprendre des choses agréables. C’est un beau sang-froid !
» Elle rappelle au duc de Richelieu la démarche que tenta
Frédéric au commencement de la guerre : ce prince engageait
la France a attaquer la reine de Hongrie au centre, en même temps
que lui, il entrerait en Silésie. « Vous devez vous ressouvenir
que, quand vous vous fîtes annoncer à Choisy, dans un moment
où il était en tête-à-tête avec Mme de
La Tournelle pour lui faire part des propositions du roi de Prusse, il
ne montra aucun empressement pour recevoir l’envoyé, qui voulait
lui parler sans conférer avec les ministres. Ce fut vous qui le
pressâtes de vous donner une heure pour le lendemain ; vous fûtes
étonné vous-même, mon cher duc, du peu de mots qu’il
articula à cet envoyé, et de ce qu’il était comme
un écolier qui a besoin de son précepteur. Il n’eut pas la
force de se décider ; il fallut qu’il recourût à ses
Mentors... Le roi de Prusse jugeait Louis XV d’après lui ;... mais
il avait mal vu, et ne tarda point d’abandonner un allié dont il
reconnaissait la nullité, quand il eut retiré tous les avantages
qu’il attendait de la campagne.»
Le roi ira-t-il ou non à l’armée? il fallut
monter à cet effet toute une machine: « Mon frère,
écrit Mme de Tencin, ne serait pas très éloigné
de croire qu’il serait très utile de l’engager à se mettre
à la tête de ses armées. Ce n’est pas qu’entre nous
il soit en état de commander une compagnie de grenadiers; mais sa
présence fera beaucoup; le peuple aime son roi par habitude, et
il sera enchanté de lui voit faire une démarche qui lui aura
été soufflée. Ses troupes feront mieux leur devoir,
et les généraux n’oseront pas manquer si ouvertement au leur...
» On touche là les ficelles de la campagne tant célébrée
de 1744.
 |
| le bien-aimé |
Nous pourrions multiplier ces citations accablantes :
« Rien dans ce monde ne ressemble au roi, » écrit-elle
en le résumant d’un mot. Tel était Louis XV dans toute sa
force et dans toute sa virilité, à la veille de ce qu’on
a appelé son héroïsme : ce qu’il devint après
trente années encore d’une mollesse croissante et d’un abaissement
continu, on le va voit lorsque, dans sa peur de la mort, il tirera la langue
quatorze fois de suite pour la montrer à ses quatorze médecins,
chirurgiens et apothicaires.
On ne peut s’empêcher de penser, à bien regarder
la situation de la France au sortir du ministère du cardinal de
Fleury, que si le duc de Choiseul et Mme de Pompadour elle-même n’étaient
venus pour s’entendre et redonner quelque consistance et quelque suite
à la politique de la France, la révolution, ou plutôt
la dissolution sociale, serait arrivée trente ans plus tôt,
tant les ressorts de l’État étaient relâchés
! Et la nation, les hommes de 89, qui se formulent à l’amour du
bien public, à l’aspect de toutes ces bassesses; n’auraient pas
été prêts pour ressaisir les débris de l’héritage
et donner le signal d’une ère nouvelle.
Il y avait, rappelons-le pour ne pas être injuste
dans notre sévérité, il y avait, au sein de ce Versailles
d’alors et de cette Cour si corrompue, un petit coin préservé,
une sorte d’asile des vertus et de toutes les piétés domestiques
dans la personne et dans la famille du Dauphin, père de Louis XVI.
Ce prince estimable et tout ce qui l’entourait, sa mère, son épouse,
ses royales soeurs, toute sa maison, faisaient le contraste le plus absolu
et le plus silencieux aux scandales et aux intrigues du reste de la Cour.
Il serait touchant de rapprocher les détails de sa fin prématurée
et sa mort si courageusement chrétienne, de la triste agonie du
roi son père. On raconte qu’à son dernier automne (1765),
ayant désiré revoir à Versailles le bosquet qui portait
son nom et dans lequel s’était passée son enfance, il dit
avec pressentiment, en voyant les arbres à demi dépouillés
: « Déjà la chute des feuilles! » Et il ajouta
aussitôt: « Mais on voit mieux le ciel ! » Nous avons
en ce moment sous les leur une suite d’anecdotes et de particularités
intéressantes sur ce fils de Louis XV, qu’a rassemblées M.
Varin, conservateur à la bibliothèque de l’Arsenal, et nous
y reviendrons peut-être quelque jour; mais aujourd’hui il nous a
paru utile de présenter isolément, et sans correctif, le
spectacle d’une mort beaucoup moins belle, et qui, dans ses détails
les plus domestiques (c’est le lot des monarchies absolues), appartient
de droit à l’histoire.
Le Dauphin, fils de Louis XV, quelque hommage qu’on soit
disposé à rendre à ses qualités et à
ses vertus, n’était pas de ceux desquels on peut dire autrement
que par une fiction de poète; Tu Marcellus eris; tout en
lui révèle un saint, mais c’était un roi qu’il eût
fallu à la monarchie et à la France. Louis XVI, héritier
des vertus de son père, ne sut pas être ce roi, et rien n’autorise
à soupçonner que le père lui-même, s’il eût
vécu, eût été d’étoffe à l’être.
Il reste clair pour tous qu’avec Louis XV mourant, la monarchie était
condamnée déjà, et la race retranchée. Voyons
donc comment Louis XV était en train de mourir.
On ne dira pas: Voilà comment meurent les voluptueux,
car les voluptueux savent souvent finir avec bien de la fermeté
et du courage. Louis XV ne mourut pas comme Sardanapale, il mourut comme
mourra plus tard Mme Du Barry, laquelle, on le sait, montée sur
l’échafaud, se jetait aux pieds du bourreau en s’écriant,
les mains jointes : « Monsieur le bourreau, encore un instant! »
Louis XV disait quelque chose de tel à toute la Faculté assemblée.
Et quel était donc celui qui va épier et
prendre ainsi sur le fait les pusillanimités et les misères
du maître durant sa maladie suprême? Dans cette ancienne monarchie,
les rois et les grands ne songeaient pas assez à qui ils se révélaient
ainsi dans leur déshabillé et dans leur ruelle. Parmi cette
foule de courtisans qui se livraient au torrent de chaque jour, et qui
songeaient à profiter de ce qu’ils observaient sans le dire, il
se rencontrait parfois des écrivains et des peintres, des moralistes
et des hommes. Qu’on relise les surprenantes et incomparables pages de
Saint-Simon où revivent les scènes si contrastées
de la mort au grand Dauphin: les princes avaient parfois de tels historiographes
à leur Cour sans s’en douter. Les Condé logeaient dans leur
hôtel La Bruyère. La duchesse du Maine avait parmi ses femmes
cette spirituelle Delaunay qui a écrit: « Les grands, à
force de s’étendre, deviennent si minces, qu’on voit le jour au
travers; c’est une belle étude de les contempler, je ne sais rien
qui ramène plus à la philosophie. » Et encore : «
Elle (la duchesse du Maine) a fait dire à une personne de beaucoup
d’esprit que les princes étaient en morale ce que les monstres
sont dans la physique: on voit en eux à découvert la plupart
des vices qui sont imperceptibles dans les antres hommes. » C’est
en effet dans cet esprit qu’il faut étudier les grands, surtout
depuis qu’on a appris à connaître les petits : ce n’est pas
tant comme grands que comme hommes qu’il convient de les connaître.
De tout autres qu’eux à leur place auraient fait plus ou moins de
même. La vraie morale à en tirer, c’est, sans s’exagérer
le présent, et tout en y reconnaissant bien des grossièretés
et des vices, de ne jamais pourtant regretter sérieusement un passé
où de telles monstruosités étaient possibles, étaient
inévitables dans l’ordre habituel.
 |
| mort de Louis XV |
L’homme qui a écrit les pages qu’on va lire n’est
pas difficile à deviner et à reconnaître son grand-père
(lui-même nous l’indique) était collègue d’un duc de
Bouillon durant la maladie du roi à Metz, en 1744, et le voilà
qui se trouve à son tour côte à côte d’un due
de Bouillon dans cette maladie royale de 1774. Il nomme chacun des principaux
seigneurs qui sont en fonction autour de lui, et s’en distingue; il n’est
donc ni le grand-chambellan (M. de Bouillon), ni le premier gentilhomme
de la chambre (M. d’Aumont); ce ne peut être que leur égal,
le grand-maître de la garde-robe en personne, M. le duc de Liancourt,
qui avait alors la survivance du duc d’Estissac, son père, et qui
s’exerçait la charge; c’est celui même que tout le monde a
connu et vénéré sous le nom de duc de La Rochefoucauld-Liancourt,
et qui n’est mort qu’en mars 1827. Voilà le témoin, un des
plus vertueux citoyens, un homme de 89, tel qu’il s’en préparait
à cette époque dans tous les rangs, et particulièrement
au sein de la jeune noblesse éclairée et généreuse.
De pareils spectacles, il faut en convenir, étaient bien propres
à exciter de nobles coeurs et à leur donner la nausée
des basses intrigues. Si l’on veut connaître le duc de La Rochefoucauld-Liancourt,
sa vie est partout, son souvenir revit dans de nombreuses institutions
de bienfaisance. Ce fut lui qui, grâce à cette même
charge de grand-maître de la garde-robe, pénétrant
de nuit jusqu’à Louis XVI, le faisant réveiller pour lui
apprendre la prise de la Bastille, et lui entendant dire comme première
parole : C’est une révolte!
lui répondit : Non,
Sire, c’est une révolution ! Tel est l’homme qui, jeune et condamné
par les devoirs de sa charge à subir le spectacle des derniers moments
de Louis XV, eut l’idée de nous en frire profiter. Ami de M. de
Choiseul, ennemi du ministère d’Aiguillon et de la maîtresse
favorite, il eût pu dire aux approches du danger, comme Saint-Simon
à la nouvelle de la mort de Monseigneur: « La joie néanmoins
perçoit à travers les réflexions momentanées
de religion et d’humanité par lesquelles j’essayois de me rappeler.
» A nos yeux comme aux siens, est-il besoin d’en avertir? de pareils
récits et les turpitudes mêmes où ils font passer ont
un sens sérieux: la nécessité et la légitimité
de 89 sont au bout, comme une conséquence irrécusable. La
scène où l’on réveille Louis XVI et le contrecoup
fatal de celles où, quinze ans auparavant, on suivait la fin honteuse
de Louis XV. L’enseignement historique ressort avec toute sa gravité.
C’est dans cette conviction qu’en livrant ces pages au public, nous sommes
assuré de ne manquer en rien ni à la mémoire ni à
la pensée de celui qui les a écrites.
Nous reproduisons la copie qui est entre nos mains, sans
chercher à y apporter même la correction, ni à plus
forte raison, l’élégance. M. Lacretelle, qui fut attaché
au duc de Liancourt, comme secrétaire intime pendant les premières
années de la Révolution, a raconté, dans un intéressant
chapitre de ses Dix années d’épreuves, comment on
vivait à Liancourt, en cette sorte de paradis terrestre, et quelles
occupations rurales, bienfaisantes ou littéraires y variaient les
heures : « Après de laborieuses recherches, écrit M.
Lacretelle, après avoir dépouillé une vaste et touchante
correspondance, il (le duc de Liancourt) rédigeait ses Mémoires, les soumettait à ma critique, à ma révision. J’avoue
que ce fut d’abord pour moi une torture que de chercher des embellissements
à un travail tout uni, mais parfaitement conforme au sujet. Mon
style me paraissait à moi-même trop ambitieux et trop fleuri.
Je voyais bien l’auteur en portait tout bas le même jugement ; Il
me dit un jour : Ma prose fait tache dans la vôtre. Ce compliment
plus ou moins sincère fut pour moi un avertissement d’user avec
réserve de mon métier de polisseur. Plus j’y mis de discrétion
et d’économie, et mieux nous nous entendîmes. » Nous
ne nous sommes pas même
cru en droit de nous permettre ce soin si
sobre ; à part un ou deux endroits où la copie était
évidemment fautive, nous en avons respecté tout le négligé.
Cette copie provient de celle que possède la Bibliothèque
de l’Arsenal, et qui, perdue dans la masse des papiers de M. de Paulmy,
a été récemment retrouvée par M. Varin.
(à suivre ici)
(à suivre ici)
lundi 11 décembre 2017
lundi 4 décembre 2017
Bibliothèque Médicis, avec Arlette Farge
Spécialiste du XVIIIè siècle, Arlette Farge est un véritable puits de science pour tout ce qui concerne le Paris des Lumières.
mercredi 29 novembre 2017
vendredi 24 novembre 2017
Marion Sigaut - La Révolution Française, la France et l'Histoire
On connaît le propos de Tocqueville selon qui "La Révolution a
achevé soudainement, par un effort convulsif et
douloureux, sans transition, sans précaution, sans
égards, ce qui se serait achevé peu à peu
de soi-même à la longue." Et d'ajouter : "Si
elle n'eût pas eu lieu, le vieil édifice social
n'en serait pas moins tombé partout, ici plus tôt,
là plus tard".
Bon, chez nous, ce fut assez tôt, notamment pour les raisons mentionnées ici par Marion Sigaut : une dette abyssale qui n'a cessé de se creuser tout au long du siècle, des guerres ruineuses (celle de 7 ans, celle d'Amérique).
Ecoutons les 10 premières de cette conférence, elles décrivent assez justement les derniers soubresauts d'une monarchie agonisante.
La suite n'est pas au niveau : prétendue complicité entre jansénistes et Encyclopédistes, affaire Calas, Necker poursuivant la politique de Turgot...
Un conseil : (re)lisez quelques passages de Tocqueville ici !
Bon, chez nous, ce fut assez tôt, notamment pour les raisons mentionnées ici par Marion Sigaut : une dette abyssale qui n'a cessé de se creuser tout au long du siècle, des guerres ruineuses (celle de 7 ans, celle d'Amérique).
Ecoutons les 10 premières de cette conférence, elles décrivent assez justement les derniers soubresauts d'une monarchie agonisante.
La suite n'est pas au niveau : prétendue complicité entre jansénistes et Encyclopédistes, affaire Calas, Necker poursuivant la politique de Turgot...
Un conseil : (re)lisez quelques passages de Tocqueville ici !
samedi 18 novembre 2017
mercredi 15 novembre 2017
vendredi 3 novembre 2017
Le supplice de Damiens
-->
Pour remercier les fidèles, cet extrait de mon Louise d'Epinay, paru ce printemps aux éditions Sutton.
Son rêve
commençait par une clameur, d’abord lointaine, en provenance du quai Pelletier
où les pataches et les bateaux-lavoirs s’étaient amassés dès l’aube dans
l’attente du convoi. Sur la place de Grève, encore bruyante un instant plus
tôt, tout le monde fit silence. Parmi le public massé autour des barrières,
quelques hommes jouèrent des coudes pour gagner les premiers rangs et ne rien
rater du spectacle. Au-dessus de leurs têtes, accoudés aux fenêtres de l’hôtel
de ville, les échevins bénéficiaient d’un point de vue privilégié, tout comme
les spectateurs assis aux balcons des maisons qui surplombaient la place. Ils
furent les premiers à voir apparaître les soldats de la Garde française,
peut-être une dizaine, qui entrèrent sur l’esplanade encouragés par les
vociférations de la foule. Sur un ordre de leur supérieur, les hommes rompirent
alors les rangs et vinrent se disposer tout le long de l’enceinte, les armes à
la main. Lorsque le tombereau apparut à l’angle des bâtiments, encadré par une
escouade de suisses, il fut accueilli par une nouvelle acclamation. Tiré par
deux chevaux, le chariot pénétra lentement sur la place, et chacun put enfin
découvrir les traits du futur supplicié. Vêtu d’une veste sombre, d’une chemise
couleur de soufre et d’une culotte, Robert-François Damiens était agenouillé à
l’arrière du tombereau, tête basse, une main posée sur un montant et dans
l’autre une torche ardente qu’il tenait aussi droite que possible, malgré son
état de faiblesse. Comme les cris et les invectives redoublaient, il releva les
yeux et affronta le public du regard. L’homme avait le visage long, le teint
basané, la barbe et le regard noirs. Plus tard, parmi ceux qui racontèrent son
exécution, certains jurèrent qu’il avait souri, qu’il les avait toisés avec
hauteur et d’un air provocant. De l’endroit où il se tenait, à l’extrémité sud de
la place, l’abbé Martin ne voyait rien de tout cela. Il demeurait immobile, les
bras croisés sur la poitrine, pendant que du bout des doigts il serrait
nerveusement le crucifix glissé sous sa chape. Autour de lui, massés contre la
rambarde, les spectateurs essayaient tant bien que mal de se dégager une vue
sur l’échafaud, situé à une trentaine de pas de là. Deux soldats venaient
d’extraire le condamné du tombereau. Comme ses jambes ne le portaient plus, il
fut soulevé, enveloppé dans une couverture, jusqu’aux premières marches de l’hôtel
de ville, avant d’être jeté à terre sans ménagement. Les portes s’ouvrirent, et
lorsque l’archevêque apparut sur le seuil et qu’il se pencha sur le condamné
afin de recueillir sa demande de réparation, tout le monde tendit l’oreille
dans l’espoir d’entendre les derniers mots du régicide. Pendant les dix minutes
que dura l’entrevue, même les vendeurs de boissons firent silence, jusqu’à ce
que le prélat se relève enfin et fasse signe aux exécuteurs d’emmener leur
prisonnier. Légèrement surélevé, l’échafaud mesurait environ huit pieds de long
sur quatre de large. Pour l’occasion, le bourreau de Paris était secondé par
une dizaine d’officiers venus des villes voisines, et par deux confesseurs,
tout de noir vêtus, qui se pressèrent aussitôt autour du condamné pour
l’enjoindre de baiser le crucifix. L’homme laissa tomber la tête vers l’avant
et l’abbé Martin entendit à quelques pas de lui une voix féminine qui
s’écriait :
« Le monstre !
Il a craché sur la croix ! »
Cela provoqua
un mouvement de foule auquel les gardes répondirent en se resserrant, les armes
levées, le long des solives qui barraient l’accès à la place. Dans le tumulte
qui s’ensuivit, personne ne prêta attention à la lecture de l’arrêt de justice.
On n’avait plus d’yeux que pour les bourreaux qui retiraient leurs fourneaux du
foyer et les rapprochaient précautionneusement de l’échafaud, où Damiens venait
d’être sanglé, couché sur la table de supplice, à l’aide de cercles de fer qui
le maintenaient par les épaules et jusqu’à la ceinture. Quand il fut allongé,
les deux confesseurs vinrent s’agenouiller à ses côtés, le crucifix brandi
devant eux, pour l’exhorter dans ses derniers instants.
« Dieu
tout-puissant, faites grâce à ce malheureux pour la rémission de ses péchés… »
Les quelques
mots murmurés par l’abbé se perdirent dans le tumulte de cris et d’injures qui
déferlait sur la place. Le clerc lança un regard désespéré vers le balcon central
de l’hôtel de ville, où l’archevêque s’était avancé pour donner le signal aux
bourreaux.
Déjà, l’un
d’eux s’était détaché du groupe, tenant au-dessus de sa tête l’arme du crime,
un petit canif dont Damiens s’était servi pour perpétrer son forfait. Il
s’approcha lentement du prisonnier, se pencha sur son corps, et après avoir
donné l’ordre de le maintenir, il poignarda d’un mouvement sec la main qui
avait attenté à la vie du roi. La lame traversa les os et vint se ficher
jusqu’à la garde dans le support en bois. L’un des exécuteurs lâcha alors le
bras du condamné et versa sur le membre une solution soufrée à laquelle son
acolyte mit aussitôt le feu à l’aide d’une torche. Sous l’effet de la brûlure,
Damiens se cabra violemment, tirant en vain sur les ceintures métalliques qui
l’entravaient. Une odeur de chair grillée envahit instantanément la place,
soulevant le cœur de certains spectateurs pendant que d’autres rendaient leur
dîner sous eux. Aux fenêtres et aux balcons des maisons, on vit quelques dames
porter leur mouchoir devant leur nez, ce qui suscita l’hilarité générale.
« Les
garces ont payé près de dix livres pour ne rien rater du spectacle, gueula
quelqu’un, et voilà qu’elles se trouvent mal !
- Ne crains
rien, beugla un autre, elles vont tout de même en mouiller leurs dessous ! »
Le bon mot
provoqua de nouveaux rires, bientôt interrompus par la vue des bourreaux qui
s’avançaient vers le supplicié en exhibant au-dessus de leur tête des tenailles
dentelées et rougies au feu.
« Cette
fois, il va brailler ! » se réjouit une jeune femme en battant des
mains.
Un exécuteur
avait empoigné Damiens pour lui déchirer sa chemise. Lorsque ses adjoints
appliquèrent leurs pinces sur la chair de son ventre, l’homme se raidit et
poussa un long cri de douleur. D’un mouvement tournant, les deux tortionnaires
lui arrachèrent un large lambeau de peau, et à l’aide d’une louche, un
troisième versa sur les blessures une coulée de plomb fondu, puis un filet
d’huile bouillante. Le condamné se souleva à nouveau, sans un murmure cette
fois, mais il se tourna vers ses confesseurs comme pour les implorer de mettre
fin à ses tourments. Les deux hommes se courbèrent pour mieux l’entendre, et il
se passa un long temps avant qu’ils se relèvent et ordonnent aux préposés de
poursuivre leur œuvre.
« Mon
Dieu, comment pouvez-vous tolérer une telle horreur ? » protesta
l’abbé d’une voix faible, pendant qu’autour de lui les gueulements
redoublaient.
Les officiers
s’attaquèrent ensuite aux mamelons, qu’ils arrachèrent encore grésillants avant
de les présenter triomphalement au public.
Damiens hurla
quelques mots, rendus inintelligibles par l’hystérie qui avait gagné la foule.
Certains braillaient à tue-tête, invectivant le malheureux, pendant que
d’autres encourageaient les bourreaux à se montrer plus cruels encore. Tout près
de lui, Martin vit même une jeune femme, une lavandière sans doute, se tourner
vers son compagnon pour l’embrasser à pleine bouche. Le clerc sentait ses
jambes se dérober sous lui. Incapable d’émettre la moindre plainte, il n’avait
plus d’yeux que pour cet archevêque, son supérieur, qui demeurait impassible,
une main posée sur la rampe du balcon, toujours attentif à l’horreur qui se
déroulait sous son regard complice.
« Soyez
maudit ! » fulmina l’abbé en serrant les poings.
Sa protestation
fut interrompue par un énergumène qui le bouscula pour se frayer un passage
jusqu’aux premiers rangs, où il héla un soldat de la garde.
« Laissez
passer, dit ce dernier en ricanant, monsieur est un amateur ! »
Sa plaisanterie
provoqua quelques moqueries, mais comme l’homme était en grande tenue et qu’il
portait l’épée au côté, on le laissa s’avancer jusqu’à la barrière, au plus
près de l’échafaud. Martin le vit sortir un cornet de sa veste et le porter à
son oreille afin d’entendre plus distinctement les plaintes du supplicié.
Je connais cet
homme, songea l’abbé qui le voyait de trois quarts, sans parvenir à se souvenir
où il l’avait rencontré par le passé. Peut-être à Groslay dans sa
paroisse ? Ou encore chez monsieur d’Épinay, à La Chevrette1 ?
Une nouvelle
clameur ramena le clerc à lui-même. Les suisses venaient de faire entrer quatre
chevaux sur la place, accueillis par les bourreaux qui tirèrent les animaux par
le harnais et les alignèrent par paires à l’extrémité de l’échafaud, tournés en
direction de la Seine. Damiens, qui ne comprenait pas ce qui se passait dans
son dos, essaya tant bien que mal de se contorsionner pour tourner la tête.
L’un des exécuteurs lui passa alors une grosse corde autour de chaque jambe, la
serra dans un nœud coulant sur la hanche, puis l’appliqua le long des cuisses
jusqu’aux pieds, pendant qu’un de ses adjoints enserrait soigneusement ses
membres avec de fines cordelettes. Lorsque l’opération fut achevée, les deux
hommes tirèrent les cordes vers l’arrière et vinrent les fixer, chacun de leur
côté, au pommeau d’une selle. Le condamné se trouva bientôt jambes par-dessus
tête, les pieds à l’oblique, et retenu à la taille par l’épais cercle de fer
qui le maintenait plaqué contre l’échafaud. Les spectateurs retenaient leur
souffle, frémissants d’impatience et impressionnés par le savoir-faire des
tortionnaires. Ces derniers répétèrent la même manœuvre, très lentement,
garrottant les deux bras de Damiens avant de tendre les liens jusqu’aux
chevaux. Il y eut un long moment de flottement durant lequel les confesseurs
adressèrent quelques admonestations au prisonnier, mais cette fois-ci, malgré
ses souffrances, le pauvre diable refusa de leur répondre.
La première
secousse lui arracha un nouveau hurlement.
Dans
l’assistance, on eut l’impression que ses membres s’allongeaient vers
l’arrière, qu’ils s’étiraient à n’en plus finir, jusqu’à ce que l’exécuteur
relâche enfin la bride des chevaux et détende les cordes. En qualité de maître
d’œuvre, le bourreau de Paris se tenait à côté de l’échafaud, une montre à la
main. Il compta une trentaine de secondes et donna le signal de la deuxième
secousse. Les premiers rangs du public jurèrent par la suite qu’ils avaient
entendu un craquement, sans doute provoqué par le déboîtement des membres
inférieurs. Lorsque la pression se relâcha, la vue des jambes reposant inertes
et dans un angle improbable sur les planches de l’échafaud provoqua un murmure
horrifié parmi les spectateurs les plus proches. À côté de lui, l’abbé vit la
petite lavandière porter les mains devant ses yeux et se mordre les lèvres
d’effroi. D’autres exultaient au contraire, d’autant que le supplicié demeurait
conscient et que la douleur lui arrachait d’interminables râles entrecoupés de
jurements.
Bien qu’on eût
pris soin de dépaver l’enceinte, les fers des chevaux avaient glissé dans le
sable, et malgré les efforts du bourreau, les secousses suivantes demeurèrent
infructueuses. L’homme agonisait mais ses membres tenaient bon. On amena alors
deux nouvelles bêtes, qu’on joignit aux autres, et pendant qu’on fixait de
nouveaux liens, le maître d’œuvre s’approcha du condamné, et à l’aide d’un
poignard tranchant, il coupa d’un mouvement preste les nerfs qui retenaient ses
jambes et ses bras.
À l’absence de
plainte, chacun devina que le martyre arrivait à son terme.
Cette fois, les
six bêtes furent lancées au trot, arrachant sans même ralentir les deux bras et
l’une des jambes. Damiens ouvrit une dernière fois la bouche, le buste tendu
vers le ciel, puis il retomba sans vie contre la table, ce qui déchaîna un
tonnerre d’applaudissements. Le bourreau détacha alors les trois membres avant
de les jeter sur l’échafaud. Un autre défit le corps du défunt et dans un
mouvement circulaire, il présenta son buste sanguinolent à la foule qui salua
son geste avec frénésie. Ce qui restait du régicide fut jeté au feu. Sous
l’effet du soufre mêlé à l’huile, la chair s’embrasa comme une torche,
soulevant une fumée noire et malodorante qui fit reculer les exécuteurs.
Encadrée par
les soldats du guet, la foule commençait déjà à se disperser. Dix-sept heures
venaient de sonner à l’horloge du campanile. Pour les habitants des quartiers
aisés, c’était l’heure de se rendre à l’Opéra ou dans leurs cercles, où ils
devaient être attendus avec impatience. Les autres, ceux des faubourgs
populaires, pourraient toujours descendre jusqu’aux cafés du Palais-Royal pour
y boire quelques pintes de bière et échanger leurs impressions. Au passage,
certains s’inclinèrent devant l’archevêque qui, appuyé au balcon, leur répondit
d’un imperceptible mouvement de tête.
La communion
dans l’horreur, songea tristement l’abbé Martin, à qui les larmes venaient aux
yeux en voyant défiler ces hommes et ces femmes, tous repus de haine et de mort
maintenant qu’on leur avait accordé leur pitance.
Lorsqu’il
tourna à son tour le dos au bûcher, le jeune clerc sentit qu’un feu sans nom
avait embrasé ses entrailles et qu’il ne tarderait pas à l’emporter corps et
âme dans des abîmes de souffrance.
1 L’allusion au cornet nous
incite à penser qu’il s’agit de monsieur de La Condamine (qui était
malentendant), le seul parmi les intellectuels des Lumières à avoir assisté à
l’exécution. Pourtant, à notre connaissance, l’homme n’a jamais fréquenté le
cercle de la famille d’Épinay.
mercredi 1 novembre 2017
Florence Gauthier à propos du droit naturel (2)
Entretien avec Florence Gauthier (historienne Paris Diderot)
(lire la première partie ici)
– Pendant
la Révolution française, le droit naturel à l’existence est donc réapparu, mais
comment est-il devenu le critère de la régulation du droit de propriété et
d’une forme d’économie politique qualifiée de populaire ?
Florence Gauthier
– Un des premiers
actes de la Révolution fut de voter la Déclaration des droits de l’homme et du
citoyen le 26 août 1789, une déclaration des droits naturels comme fondements
de la société politique ! Voyons de plus près. L’article 1er reprend
la formulation médiévale de la liberté contre l’esclavage : « Les hommes
naissent et demeurent libres et égaux en droits. » Or, on
vient de le voir, le capitalisme impérialiste avait imposé l’inverse en
imposant, dans son empire, la conquête et l’esclavage, avec leurs formes
spécifiques de misère. En 1789, on décidait de repartir dans la bonne
direction : une grande espérance renaissait.
Voyons maintenant le droit à l’existence comme régulateur
de la répartition du droit de propriété. Je résume très rapidement les grandes
phases de la Révolution française. En juillet 1789, le mouvement populaire
et en particulier paysan, le plus important alors, est entré sur la scène
politique et a rétabli les pratiques démocratiques villageoises y compris dans
les villes : et ces pratiques sont devenues celle de la Révolution, avec
assemblées générales des citoyens et des citoyennes, selon la tradition
populaire médiévale qui n’excluait pas les femmes de la vie politique locale.
Les paysans ont encore proposé aux seigneurs un nouveau contrat social. Il
s’agissait cette fois de partager la seigneurie – une part au seigneur, leur
part aux paysans – partage accompagné de la suppression des droits juridiques
du seigneur, qui lui-même devenait un simple citoyen.
Mais la seigneurie commença par
refuser dès 1789 et provoqua la guerre civile, qui rythma la Révolution,
jusqu’en été 1793. De 1789 à 1792, la réaction seigneuriale soutint le régime
de monarchie constitutionnelle et d’aristocratie des riches –tel était son nom-,
qui fut renversée par la Révolution du 10 août 1792.
Une République démocratique à
suffrage universel fut alors établie, avec une nouvelle assemblée constituante,
la Convention, et le mouvement populaire, rural et urbain, réclama le droit à
l’existence et aux moyens de la conserver, par ses actes comme par ses
pétitions et décisions exprimées dans les assemblées communales.
Mais, de septembre 1792 à juin 1793, la Convention fut dirigée par le parti
de la Gironde qui refusait une constitution démocratique et la réforme agraire.
Et, pour les éviter toutes deux, la Gironde se lança dans une politique de
guerre de conquête des peuples voisins. Elle échoua : les peuples voisins
n’aimèrent pas la conquête et, à l’intérieur, elle provoqua une nouvelle
révolution, celle des 31 mai-2 juin 1793.
C’est ainsi que la Montagne fut portée
au pouvoir et commença par voter une Constitution et à répondre au mouvement
populaire en réalisant la réforme agraire et la politique du maximum afin de développer la production
d’une part et de l’autre, rééquilibrer prix, salaires et profits, par la
législation depuis juin 1793 jusqu’au renversement de la Convention
montagnarde, le 9 thermidor an II-27 juillet 1794.
La Constitution de 1793 proclamait l’existence de droits sociaux et la
nécessité de les défendre.
Robespierre, en particulier, a théorisé cette politique sociale, réclamée
par le mouvement populaire, dans différentes interventions dont son Discours sur les subsistances de 1792 et
son Projet de déclaration des droits de
l’homme et du citoyen, de 1793. C’est là que nous allons faire connaissance
avec le droit à l’existence comme régulateur de la répartition et de l’exercice
du droit de propriété des biens matériels.
Robespierre s’inspire de la riche
tradition du droit naturel de Gratien à Mably et critique la politique de
hausse des prix des denrées de 1ère nécessité, menée par l’Assemblée
depuis 1789. La politique de liberté illimitée du commerce des grains décidée avec
l’aristocratie des riches puis prolongée par la Gironde, soit de 1789 à juin
1793, visait à hausser les prix des subsistances, dont le pain. La hausse des
prix provoquait des disettes factices,
car les pauvres qui n’avaient pas d’argent pour acheter le pain dont ils
avaient besoin, voyaient les marchés garnis de grains, mais ne pouvaient y
atteindre ! Cette politique faisait de l’achat des subsistances une
propriété privée exclusive des marchands de grains. Robespierre propose une
autre politique économique, fondée sur le droit à l’existence :
« Quel est le premier objet de la société ? C’est de maintenir
les droits imprescriptibles de l’homme. Quel est le premier de ces
droits ? Celui d’exister. La première loi sociale est donc celle qui
garantit à tous les membres de la société les moyens d’exister ; toutes
les autres sont subordonnées à celle-là ; la propriété n’a été instituée
ou garantie que pour la cimenter ; c’est pour vivre d’abord qu’on a des
propriétés. Il n’est pas vrai que la propriété puisse jamais être en opposition
avec la subsistance des hommes »
On retrouve dans ce texte tout ce que je viens de rappeler sur le droit
naturel et le droit de propriété distribué aux personnes privées sous condition.
Le premier des droits naturels est ici celui de se nourrir : droit à
l’existence et aux moyens de la conserver. Robespierre en fait le critère de
régulation des lois. Il commence par le droit de propriété qu’il soumet à cette
condition du droit de se nourrir : « Les aliments nécessaires à
l’homme sont aussi sacrés que la vie elle-même. Tout ce qui est indispensable
pour la conservation est une propriété commune à la société entière »
Robespierre précise les conditions de
l’exercice de ce droit de propriété sur les denrées de première nécessité.
L’achat de grains par les marchands et détaillants privés devra se faire sous
condition de nourrir la population à un prix accessible en fonction de ses
ressources. Pourquoi ? Parce que le droit de propriété privée devra se
répartir en fonction des services que celle-ci doit rendre à la société.
Le sacré dans cette société
politique, ce sont les droits naturels de l’homme que Robespierre
hiérarchise : le droit à l’existence est le premier de ces droits, mais
non le seul, parce qu’il est d’absolue nécessité. Il devient alors le
régulateur de la répartition et de l’exercice du droit de propriété privée.
Robespierre a énoncé le principe éthique sur lequel doit reposer la
distribution politique des propriétés privées.
A l’écoute du mouvement populaire qui s’exprime dans la période de façon
parfaitement audible et précise, Robespierre a participé activement à la mise
en place de celle nouvelle politique économique d’une République démocratique
et sociale, dont l’objectif est d’assurer le droit à l’existence et aux moyens
de la conserver, ce qu’il appela « l’économie politique populaire »,
par opposition à « l’économie politique tyrannique » ou
« despotique ». Ces concepts sont remarquables et d’une troublante
actualité…
 |
| Robespierre |
Dans son Projet de Déclaration des
droits, présenté à la Convention en avril 1793, Robespierre précise les
principes de morale qui conditionnent la répartition de la propriété privée,
les voici :
« La propriété est le droit qu’a chaque citoyen de jouir et de
disposer de la portion des biens qui lui est garantie par la loi. »
La propriété des biens matériels
relève de la décision politique collective, la loi, qui la conçoit comme un
service à la société.
« Le droit de propriété est borné comme tous les autres, par
l’obligation de respecter les droits d’autrui. »
La réciprocité du droit caractérise la
notion de droit naturel : à chacun sa part des biens communs.
« Il ne peut préjudicier ni à la sûreté, ni à la liberté, ni à
l’existence, ni à la propriété de nos semblables. »
Les conditions éthiques de l’exercice
du droit de propriété interdisent de faire n’importe quoi : ici les
devoirs de l’exercice de ce droit consistent dans le respect de la réciprocité
de la liberté, de l’existence et de la propriété des autres. La propriété de la
personne s’appréhende sous ses deux aspects : sont visés, sur le plan
personnel, toute forme d’esclavage ou d’aliénation de la personne et sur le
plan matériel, le fait d’affamer les gens ou de mettre leur vie en danger.
Enfin, « Toute possession,
tout trafic qui viole ce principe est illicite et immoral »
La violation de ces conditions est grave puisqu’il s’agit
de crimes contre les droits naturels de l’humanité.
« La question est bien de
déterminer ce qui est sacré dans la société politique et, une fois encore,
c’est ce débat qu’il faut rouvrir de la façon la plus large possible, car les
gens y sont sensibles »
On comprend ce que Robespierre entend lorsqu’il insiste sur le double
caractère de la propriété privée légale : elle est à la fois privée et
commune à la société. Par exemple, stocker des denrées de première nécessité
pour faire hausser les prix relève de l’intérêt particulier du propriétaire des
denrées et viole le droit aux subsistances des pauvres qui ne peuvent acheter
leur nourriture et sont condamnés à la famine, ce qui lèse l’intérêt de la
société. C’est alors un devoir du gouvernement de rétablir, par la loi, le
double caractère de la propriété privée, à condition qu’elle reste un service à
la société, ce qui lui donne ce double objectif de concevoir l’harmonisation
entre « l’intérêt privé » et « l’intérêt commun ».
Que le droit de propriété privée résulte d’une décision politique des
sociétés humaines, le monde entier le sait, aujourd’hui comme hier, et chaque
choix politique imprime son éthique ou morale à la question, cela peut être
celle du droit naturel selon Gratien, ou encore celle qui nous domine
actuellement et qui redistribue la propriété sous la condition de privilégier
les intérêts particuliers des banques et des multinationales, au détriment de
l’intérêt général devenu aujourd’hui celui de l’humanité et de la nature.
La question est bien de déterminer ce qui est sacré dans la société politique et, une fois encore, c’est ce débat
qu’il faut rouvrir de la façon la plus large possible, car les gens y sont
sensibles et le constat de Mably est, à nouveau, d’une inquiétante
actualité :
« Vous parlerai-je de la mendicité, qui déshonore aujourd’hui
l’Europe, comme l’esclavage a autrefois déshonoré les républiques des Grecs et
des Romains ? ».
mardi 24 octobre 2017
mercredi 18 octobre 2017
Florence Gauthier à propos du droit naturel (1)
-->
Entretien avec Florence Gauthier (historienne Paris Diderot)
– Vos travaux
sur les Révolutions de France et de Saint-Domingue/Haïti mettent en lumière la
philosophie du droit naturel dans la Révolution française. Vous y avez consacré
plusieurs ouvrages, La Guerre du blé
au XVIIIe siècle; Triomphe et
mort de la Révolution des droits de l’homme, 1789-1795-1802 ; L’Aristocratie de l’épiderme, le combat
des Citoyens de couleur, 1789-1791 et un n° spécial « Droit naturel »,
de la revue Corpus en 2013. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste cette
Déclaration des Droits Naturels de l’Homme et du Citoyen ?
Florence Gauthier
– Historienne des
Révolutions de France et de Saint-Domingue/Haïti, je me suis intéressée aux
questions agraires en étudiant la communauté villageoise, son système agraire
communautaire, sa gestion des droits d’usage sur les biens communaux, ses modes
de résistance aux usurpations seigneuriales et ses pratiques démocratiques,
avant et pendant la Révolution française. J’ai rencontré encore l’offensive des
économistes physiocrates qui, dans les années précédant la Révolution de 1789
ont cherché à détruire cette propriété communale et à introduire des rapports
de type capitalistes dans le marché des denrées de première nécessité, à
commencer par celui des subsistances. Je me suis tournée vers les colonies
esclavagistes pour comprendre la Révolution de Saint-Domingue/Haïti et les
politiques coloniales qui s’affrontaient pendant la Révolution et c’est ainsi
que j’ai constaté que les archives
des couches populaires de la société, comme celles des catégories supérieures, s’intéressaient toutes à la question
des droits de l’homme, soit pour les défendre, soit pour les combattre.
J’ai alors porté mon attention sur le fait que la
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen déclarait des « droits
naturels et imprescriptibles ». Je suis partie à la recherche de
« ces droits naturels » parce que je ne trouvais guère de références
explicites à ce sujet. Et pour cause ! En 1789, la Convocation des
Etats généraux, réunis pour le 1er mai à Versailles comme le voulait
la tradition, se sont transformés en Assemblée nationale constituante le 20
juin suivant, lorsqu’une majorité de députés s’est formée pour imposer au roi
une constitution : ce fut l’Acte
I de la Révolution, juridique ici, par le remplacement des Etats généraux
convoqués par le roi, en une assemblée constituante élue par tous les sujets du
Royaume. Puis, lorsque le roi refusa la constitution
et tenta la répression contre les députés, le peuple, qui s’était impliqué en
rédigeant ses doléances, s’arma pour se protéger lui-même. On était au début du
mois de juillet.
Partout dans le pays, à la vitesse du tocsin qui prévenait
les villages voisins, les gens s’armaient avec ce qu’ils trouvaient sous la
main et les paysans se rendirent au château, exigèrent les titres de propriété
seigneuriale et les brûlèrent, réclamant la suppression des rentes féodales. Le
pouvoir municipal fut pris par les insurgés qui formèrent spontanément des
gardes nationales de citoyens. Résultat : le mouvement dura trois
semaines environ, le pays était transformé : la grande institution de la
monarchie s’était effondrée car les responsables locaux, les intendants du roi,
prirent la fuite et les gouverneurs militaires se firent tout discrets…
Une des premières mesures révolutionnaires fut le vote par
l’Assemblée constituante de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen
le 26 août 1789. Ce texte était le Manifeste de la Révolution, votée à
l’unanimité par une Assemblée qui venait d’être sauvée par l’insurrection
populaire. Que disait-il ? Je vais tenter de préciser ce qu’il y a
dans le cœur de ce manifeste. La notion de droit naturel a permis de
développer, depuis le Moyen-âge, des théories et des propositions
constitutionnalistes, fondées sur le principe de la souveraineté populaire,
dans le but de contrôler l’exercice des pouvoirs publics, législatif et
exécutif. Le législatif représente l’expression de la conscience sociale et est
constitué de l’ensemble des textes de
la constitution votés par l’assemblée des députés, sous le contrôle effectif des citoyens.
Et en effet, le système électoral communal depuis le
Moyen-âge, permettait ce contrôle effectif et voici comment : le député
élu était un commis de confiance, choisi par les électeurs et responsable
devant eux. Chargé d’une mission,
ce commis de confiance devait en rendre compte à ses électeurs et, en 1789 par exemple, les mandataires étaient entretenus durant leur mission par leurs mandants. Enfin, si ces derniers
considéraient que leurs mandataires avaient perdu leur confiance, ils étaient
rappelés et tout simplement remplacés.
Mais je reviens au droit naturel.
La notion de « droit naturel » a été retrouvée au
XIIe siècle et précisée par Gratien, juriste à l’Université de
Bologne qui a repris les termes de droit naturel à l’ancien droit romain, en
leur donnant une nouvelle signification afin d’exprimer la spécificité de ce
mouvement venu de la société entière, pour la reconnaissance de la liberté et
de la dignité humaine.
Gratien définit ce droit naturel comme un complexe de
droits et de pouvoirs. Résumons :
– Un sentiment d’indignation connu de toute personne qui
subit une violence et réclame justice.
– Un droit à la pensée critique et un pouvoir exercé selon
la raison humaine.
– Gratien l’a décliné en « droit naturel de liberté
qui appartient à tout être humain » : et voilà l’égalité qu’il
définit comme la réciprocité de ce droit de liberté et de résistance à
l’injustice et à l’oppression. Cette réciprocité, ou égalité, exprime la
relation à l’autre et aux autres. On le voit, il s’agit bien d’un droit individuel ou personnel puisqu’il appartient à chaque être humain et réciproque parce qu’il prend en compte
la relation à l’autre : l’autre a les mêmes droits que moi, j’ai le devoir
de les respecter.
Les idées d’unité du
genre humain et les termes de droit
naturel viennent de l’antiquité grecque et romaine, héritage d’une société
plus ancienne encore, puisque l’esclavage antique a contré le droit naturel de
naître libre. Mais cette notion est là, à la fois offerte et niée, dans le
droit romain : on la trouve dans la principale source du droit romain que
nous conservions, le Code Justinien (VIe s.), dans la partie
intitulée Digeste, Livre 1.
Mais ce fut au Moyen-âge, depuis la chute de l’Empire
romain d’Occident, que ces termes de droit naturel ont été retrouvés et
réappropriés pour exprimer le rejet de l’esclavage, puis du servage, et faire
de la liberté et de la résistance à l’oppression le fondement du droit des
sociétés de l’espace ouest-européen. Ce fut un tournant dans l’histoire du
droit, que de concevoir ce droit naturel justifiant la résistance à
l’oppression.
– Gratien a
laissé le Decretum, écrit vers 1140, dans lequel on trouve le droit à
l’existence des pauvres, mais ce droit est en rapport avec le droit de
propriété, de quoi s’agit-il ?
Florence Gauthier
– Retournons au droit
romain pour mieux comprendre cette question du droit à l’existence des pauvres,
qui est en effet un droit de propriété. On y rencontre l’idée que l’usage des
choses qu’offre le monde est commun au genre humain et les sociétés humaines
doivent organiser cet usage qui est à la fois commun et privé. Un
exemple : un paysan cultive une terre qui est commune à la société, mais
les fruits de son travail lui appartiennent ; ou un chasseur chasse dans
le bois commun et consomme le produit de sa chasse, etc…
Le droit de propriété des biens matériels n’est pas
considéré comme un droit naturel, à la différence des droits à la vie, à la
liberté, à la résistance à l’oppression. L’exercice du droit de propriété
relève d’une décision de la société politique qui réserve tels biens en commun,
tels autres biens à des personnes privées. Mais, que les biens soient
distribués à des particuliers ou à des collectivités, ils le sont sous condition de restitution en cas de
nécessité. Il n’y a donc pas de propriété
privée exclusive en ce qui touche à la répartition des biens matériels.
Gratien discute la question du droit des pauvres.
Ecoutons-le :
" Nourrissez les pauvres, si vous ne le faites pas,
vous les tuez " écrit-il dans le Decretum.
Les pauvres doivent être aidés parce qu’en tant qu’êtres
humains, ils ont droit à leur part des biens de ce monde. En temps de détresse,
la propriété privée a des devoirs vis-à-vis des autres et les pauvres ont un
droit sur le superflu des riches. Un pauvre qui vole un riche ne fait que
reprendre sa part du bien commun, écrit encore Gratien. Le droit à l’existence
et aux moyens de la conserver est donc bien un devoir de la société selon la
conception du droit naturel médiéval.
Prenons l’exemple de l’hospitalité partageuse. Une
communauté villageoise pouvait accueillir de nouveaux venus et décider, en
assemblée générale, de leur reconnaître le
droit d’habiter là et d’obtenir le titre d’habitant (comme membre de la
communauté) et l’accès aux droits d’usage collectifs, dont celui d’obtenir un
terrain pour construire sa maison. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas
eu de périodes de misère au Moyen-âge, il y a eu des épidémies, des guerres
dévastatrices, des accidents climatiques, mais la société a organisé des moyens
d’accueil et d’entraide, au niveau local pour s’en défendre.
– On présente
ordinairement les droits économiques et sociaux comme des idées récentes ;
il semble, au contraire, qu’elles existent depuis bien longtemps. Toutefois,
ces droits ont du être contrés de façon virulente et donner lieu à des luttes
intenses, comme le laisse penser la puissante offensive actuelle contre les
politiques de protection sociale…
Florence Gauthier
– La conception d’un
droit naturel partageux a été dominante au Moyen-âge. Elle a cependant été
contrée par des courants de pensée qui refusaient d’aborder la place du genre
humain dans la nature et dans la société, de cette manière partageuse entre
chacun de ses membres. Nous connaissons bien ces adversaires du partage,
qui ont organisé des systèmes qui réussirent à s’imposer. Prenons celui que
nous connaissons le mieux et qui domine depuis le début du XIXe
siècle : le capitalisme impérialiste,
qui peut prendre encore des formes variées, bien qu’il tende à
l’uniformisation. Il est apparu depuis la conquête du Nouveau monde,
appelé ensuite Amérique, et s’est développé peu à peu, lorsqu’une poignée
d’Européens réussit, par un concours de circonstances favorables, à mettre la
main sur un continent énorme, qui est devenu leur champ d’expériences les plus
criminelles : violences, massacres, pillages, extermination des peuples
« indiens », puis déportation de captifs africains mis en esclavage
en Amérique.
De nombreux Espagnols ont réagi avec vigueur, dès 1492, à
ces violences et ont fait avancer la théorie du droit naturel, d’une part en
dénonçant cet impérialisme nouveau, qualifié de crime contre les droits de l’humanité, et d’autre part en jetant
les bases d’une alliance cosmopolitique défendant les droits naturels des
peuples et des gens contre les conquêtes. Ce furent Las Casas et Vitoria à
l’Université de Salamanque, au début du XVIe siècle qui le
théorisèrent, ce qui fut repris et développé jusqu’à la fin du XVIIIe
siècle.
 |
| Las Casas |
Mais je n’ai pas le temps de développer cette question
importante, ici, et je poursuis sur le droit à l’existence, avec toutefois en
toile de fond, ce courant de droit naturel cosmopolitique refusant
l’impérialisme.
Les conséquences du capitalisme impérialiste commencèrent à
se faire sentir dès le XVIe siècle et de nombreuses révolutions, qui
cherchaient à s’en libérer, se succédèrent, au nom du droit naturel dans cet
espace ouest-européen. Je rappelle rapidement l’Indépendance hollandaise qui
rejeta la domination espagnole au bout d’un siècle de résistance, puis la
première Révolution d’Angleterre de 1640, qui vécut l’expérience d’un mouvement
populaire faisant campagne pour une Constitution démocratique, éclairée par une
Déclaration des droits naturels (birthrights
en anglais, droits de naissance). John Locke en fut l’héritier et offrit, avec
ses Deux Traités de gouvernement, en 1690, une théorie politique critique,
qui nourrit le siècle suivant et inspira un renouveau de la pensée du
droit naturel, largement diffusé par les Lumières au siècle suivant.
Portrait de
Montesquieu
Voici comment Montesquieu abordait la question du droit à
l’existence dans L’Esprit des Lois,
en 1757. Il constatait l’expropriation des paysans de son temps et
l’accroissement du nombre de misérables, et prenait la défense d’une
redistribution de la propriété et des droits sociaux pour assurer le droit à
l’existence :
« Quelques aumônes que l’on fait à l’homme nu dans les
rues ne remplissent pas les obligations de l’état , qui doit à tous les
citoyens une subsistance assurée, la nourriture, un vêtement convenable et un
genre de vie qui ne nuise pas à la santé »
Il est clair que Montesquieu connaît la philosophie du
droit naturel et pense dans ce cadre : la société politique doit assurer
le partage des biens afin que chacun ait accès à sa part des choses du monde et
que cette part ne soit pas accaparée par une minorité sans scrupules. Tel est,
selon, lui, le rôle d’une société politique et de son gouvernement.
Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, Mably
fut un critique perspicace de l’économie politique des puissances européennes
de son temps. Grand connaisseur des économistes écossais et, en France, des
physiocrates et des turgotins, il constatait les résultats dévastateurs des
expérimentations de cette économie politique, qui tendait à polariser les
sociétés en une mince couche de plus en plus riche et une classe de bas
salariés et de chômeurs de plus en plus misérables. Mably expose son rejet de
l’esclavage, propre à la pensée du droit naturel, et le compare à la misère des
sociétés modernes européennes : « Vous parlerai-je de la
mendicité, qui déshonore aujourd’hui l’Europe, comme l’esclavage a autrefois
déshonoré les républiques des Grecs et des Romains ? »
La misère lui apparaît comme une forme d’exclusion à
l’accès aux droits sociaux et politiques. L’objectif premier est alors d’en
proscrire la cause : « La mendicité déshonore et affaiblit un
gouvernement. Les aumônes des riches ne réparent pas le mal ; et si vous
ne voulez pas que les vices du riche profitent des vices des pauvres,
proscrivez la pauvreté »
Comment ? En renonçant aux politiques conquérantes en
ouvrant un processus de décolonisation, réclamé à l’époque dans plusieurs
colonies européennes et, à l’intérieur, en menant une politique capable de
renouer avec les principes d’une société politique qu’il estime élémentaires,
c’est-à-dire ceux du droit naturel, en commençant par rétablir un pouvoir
législatif réellement représentatif de la société, afin qu’elle puisse
délibérer et répondre aux problèmes qui se posent à elle.
Or, la monarchie, sans les avoir supprimés, ne convoquait
plus les Etats généraux en France depuis le XVIIe s, raison pour
laquelle on la qualifiait, à juste titre, de « despotique ». Mably
réclama la convocation de cette vieille institution, afin qu’elle reprenne
l’exercice du pouvoir législatif délibérant et ouvre des débats publics. Et, en
1789, la monarchie en crise profonde, en vint à convoquer les Etats généraux,
choisissant une solution politique pour répondre aux graves problèmes qui
s’imposaient alors.
(à suivre ici)
Inscription à :
Commentaires (Atom)