Quelques lignes encore, qui témoignent de la rencontre entre Bernardin de St-Pierre et Rousseau. J'ai repris la scène du Mont Valérien pour l'intégrer quasiment en l'état dans le voile déchiré...

Un jour le préfet des jésuites lui demandait comment
il était devenu si éloquent; il lui répondit : J'ai dit ce que je pensais.
Il regardait la vérité comme le plus grand charme d'un écrivain ; il
préférait les relations des missionnaires capucins à celles des jésuites. Il
avait lu avec grand plaisir les PP. Marolle et Carly dans leurs missions
d'Afrique, quoique remplies d'ignorance ; il me disait : Ces bons
pères me persuadent, parce qu'ils parlent comme gens persuadés. Ce n'est pas
d'ailleurs l'ignorance qui nuit aux hommes, c'est l'erreur; et presque toujours
elle vient des ambitieux. Les auteurs modernes, disait-il, qui ont le plus
d'esprit, font cependant peu d'effet, et inspirent peu d'intérêt dans leurs
ouvrages, parce qu'ils veulent toujours se montrer. Quelle que soit la
puissance de l'esprit, la vertu est si ravissante, que dès qu'on l'entrevoit au
milieu même des inconséquences de la superstition et de l'ignorance, elle se
fait aimer et préférer à tout. Voilà pourquoi Plutarque qui a le jugement si
sûr, intéresse jusque dans ses superstitions ;
 |
| buste de Plutarque |
car quand il s'agit de rendre
les hommes meilleurs et plus patriotes, il adopte les opinions les plus
absurdes ; sa vertu le rend crédule ; il se passe alors entre elle et
son bon esprit des combats délicieux. Il rapporte, par exemple, que la statue
de la Fortune, donnée par les dames romaines, a parlé ; puis il ajoute,
comme pour se persuader lui-même : Elle a parlé non-seulement une fois,
mais deux. Ailleurs il remarque que sa petite-fille voulait que sa nourrice
présentât la mamelle à ses compagnes et à ses jouets ; ceci semble un trait
bien puéril ; mais quand il ajoute : Elle le voulait pour faire
participer de sa table ce qui servait à ses plaisirs, on voit que la bonté du
cœur lui paraît supérieure à tout. Cette bonté était la base fondamentale du
caractère naturel de Rousseau ; il préférait un trait de sensibilité à
toutes les épigrammes de Martial. Son cœur que rien n'avait pu dépraver,
opposait sa douceur à tout le fiel dont nos sociétés s'abreuvent aujourd'hui.
Cependant il aimait mieux les caractères emportés que les apathiques. J'ai
connu, me disait-il un jour, un homme si sujet à la colère, que lorsqu'il
jouait aux échecs, s'il venait à perdre, il brisait les pièces entre ses dents.
Le maître du café voyant qu'il cassait tous ses jeux, en fit faire de gros
comme le poing. A cette vue, notre homme ressentit une grande joie, parce que,
disait-il, il pourrait les mordre à belles dents. Du reste c'était le meilleur
garçon du monde, capable de se jeter au feu pour rendre service.
Rousseau me citait encore un Dauphinois, calme, réservé,
qui se promenait avec lui en le suivant toujours sans rien dire. Un jour il vit
cueillir à Rousseau les graines d'une espèce de saule, agréables au goût ;
comme il les tenait à la main, et qu'il en mangeait, une troisième personne
survint, qui, tout effrayée, lui dit : Que mangez-vous donc là ! c'est
du poison. Comment, dit Rousseau, du poison ! — Eh oui ! et monsieur
que voilà peut vous le dire aussi bien que moi. Pourquoi donc ne m'en a-t-il
pas averti ? Mais, reprit le silencieux Dauphinois, c'est que cela
paraissait vous faire plaisir. Ce petit événement ne l'avait point corrigé de
goûter les plantes qu'il cueillait. Je me souviens qu'au bois de Boulogne, il
me montra la filipendule, dont les tubercules sont bonnes à manger; j'en
trouvai une qui avait deux racines; je me mis à en goûter, et je lui dis :
C'est fort bon, on en pourrait vivre. Au moins, me dit-il, donnez-m'en ma part,
et le voilà aussitôt à genoux sur le gazon, et creusant avec son couteau pour
en chercher d'autres.
Il était gai, confiant, ouvert, dès qu'il pouvait se
livrer à son caractère naturel. Quand je le voyais sombre : À coup sûr,
disais-je, il est dans son caractère social, ramenons-le à la nature. Je lui
parlais alors de ses premières aventures. Un soir nous étions à la Muette, il
était tard ; étourdiment, je lui proposai un chemin plus court à travers
champs. Distrait autant que lui, je m'égarai ; le chemin nous ramena dans
Passy, le long de ses longues rues, où quelques bourgeois prenaient alors le
frais sur la porte. La nuit approchait ; je le vis changer de
physionomie ; je lui dis : Voilà les Tuileries. — Oui, mais nous n'y
sommes pas. Oh ! que ma femme va être inquiète, répéta-t-il plusieurs
fois ! Il hâta le pas, fronça le sourcil; je lui parlais, il ne me
répondait plus. Je lui dis : Encore vaut-il mieux être ici que dans les
solitudes de l'Arménie ; il s'arrêta et dit : J'aimerais mieux être
au milieu des flèches des Parthes, qu'exposé aux regards des hommes. Je remis
alors la conversation sur Plutarque : il revint à lui comme sortant d'un
rêve.
La méfiance qu'il avait des hommes, s'étendait
quelquefois aux choses naturelles. Il croyait à une destinée qui le
poursuivait. Il me disait : La Providence n'a soin que des espèces, et non
des individus. Mais vous la croyez donc, lui dis-je, moins étendue que l'air
qui environne les plus petits corps ? Cependant je n'ai connu personne
plus convaincu que lui de l'existence de Dieu. Il me disait : II n'est pas
nécessaire d'étudier la nature pour s'en convaincre. Il y a un si bel ordre
dans l'ordre physique, et tant de désordre dans l'ordre moral, qu'il faut de
toute nécessité qu'il y ait un monde où l'âme soit satisfaite. Il ajoutait avec
effusion : Nous avons ce sentiment au fond du cœur : je sens qu'il
doit me revenir quelque chose.
Quatre ou cinq causes réunies contribuèrent à altérer
son caractère, dont la moindre a suffi quelquefois pour rendre un homme
méchant : les persécutions, les calomnies, la mauvaise fortune, les
maladies, le travail excessif des lettres, travail qui trop souvent fatigue
l'esprit et altère l'humeur. Aussi a-t-on reproché aux poëtes et aux peintres,
des boutades et des caprices. Les travaux de l'esprit, en l'épuisant, mettent
un homme dans la disposition d'un voyageur fatigué : Rousseau, lui-même,
lorsqu'il composait ses ouvrages, était des semaines entières sans parler à sa
femme. Mais toutes ces causes réunies ne l'ont jamais détourné de l'amour de la
justice. Il portait ce sentiment dans tous ses goûts ; et je l'ai vu
souvent, en herborisant dans la campagne, ne vouloir point cueillir une plante
quand elle était seule de son espèce.
L'homme vertueux, me disait-il, est forcé de vivre
seul ; d'ailleurs, la solitude est une affaire de goût. On a beau faire
dans le monde, on est presque toujours mécontent de soi ou des autres. Comme il
composait son bonheur d'une bonne conscience, de la santé et de la liberté, il
craignait tout ce qui peut altérer ces biens, sans lesquels les riches
eux-mêmes ne goûtent aucune félicité.
 |
| Gluck |
Dans le temps que Gluck donna son Iphigénie,
il me proposa d'aller à une répétition : j'acceptai. Soyez exact, me
dit-il ; s'il pleut nous nous joindrons sous le portique des Tuileries à
cinq heures et demie ; le premier venu attendra l'autre, mais l'heure
sonnée, il n'attendra plus : je lui promis d'être exact ; mais le
lendemain je reçus un billet ainsi conçu : Pour éviter, monsieur, la gène
des rendez-vous, voici le billet d'entrée. À l'heure du spectacle, je
m'acheminai tout seul; la première personne que je rencontrai, ce fut Jean- Jacques.
Nous allâmes nous mettre dans un coin, du côté de la loge de la reine. La foule
et le bruit augmentant, nous étouffions. L'envie me prit de le nommer, dans
l'espérance que ceux qui l'environnaient le protégeraient contre la foule.
Cependant je balançai longtemps, dans la crainte de faire une chose qui lui
déplût. Enfin, m'adressant au groupe qui était devant moi, je me hasardai de
prononcer le nom de Rousseau, en recommandant le secret. A peine cette parole
fut-elle dite, qu'il se fit un grand silence. On le considérait
respectueusement, et c'était à qui nous garantirait de la foule, sans que
personne répétât le nom que j'avais prononcé. J'admirai ce trait de discrétion
rare dans le caractère national ; et ce sentiment de vénération me prouva
le pouvoir de la présence d'un grand homme.
En sortant du spectacle, il me proposa de venir le
lundi des fêtes de Pâques au mont Valérien. Nous nous donnâmes rendez-vous dans
un café aux Champs-Elysées. Le matin nous prîmes du chocolat. Le vent était à
l'ouest. L'air était frais ; le soleil paraissait environné de grands
nuages blancs, divisés par masses sur un ciel d'azur. Entrés dans le bois de
Boulogne à huit heures, Jean-Jacques se mit à herboriser. Pendant qu'il faisait
sa petite récolte, nous avancions toujours. Déjà nous avions traversé une
partie du bois, lorsque nous aperçûmes dans ces solitudes deux jeunes filles,
dont l'une tressait les cheveux de sa compagne. Frappés de ce tableau
champêtre, nous nous arrêtâmes un instant. Ma femme, me dit Rousseau, m'a conté
que dans son pays les bergères font ainsi mutuellement leur toilette en plein
champ. Ce spectacle charmant nous rappela en même temps les beaux jours de la
Grèce, et quelques beaux vers de Virgile. Il y a dans les vers de ce poëte un
sentiment si vrai de la nature, qu'ils nous reviennent toujours à la mémoire au
milieu de nos plus douces émotions.
Arrivés sur le bord de la rivière, nous passâmes le
bac avec beaucoup de gens que la dévotion conduisait au mont Valérien. Nous
gravîmes une pente très roide ; et nous fûmes à peine à son sommet, que
pressés par la faim, nous songeâmes à dîner. Rousseau me conduisit alors vers
un ermitage où il savait qu'on nous donnerait l'hospitalité. Le religieux qui
vint nous ouvrir, nous conduisit à la chapelle, où l'on récitait les litanies
de la Providence, qui sont très-belles. Nous entrâmes justement au moment où
l'on prononçait ces mots : Providence qui avez soin des empires !
Providence qui avez soin des voyageurs ! Ces paroles si simples et si
touchantes nous remplirent d'émotion; et lorsque nous eûmes prié, Jean-Jacques
me dit avec attendrissement : Maintenant j'éprouve ce qui est dit dans
l'Évangile : Quand plusieurs d'entre vous seront rassemblés en mon nom, je
me trouverai au milieu d'eux. Il y a ici un sentiment de paix et de bonheur qui
pénètre l'âme. Je lui répondis : Si Fénelon vivait, vous seriez
catholique. Il me repartit hors de lui et les larmes aux yeux : Oh ! si
Fénelon vivait, je chercherais à être son laquais pour être son valet de chambre
! Cependant on nous introduisit au réfectoire ; nous nous assîmes pour
assister à la lecture, à laquelle Rousseau fut très attentif. Le sujet était
l'injustice des plaintes de l'homme : Dieu l'a tiré du néant; il ne lui
doit que le néant. Après cette lecture, Rousseau me dit d'une voix profondément
émue : Ah, qu'on est heureux de croire ! Hélas ! lui
répondis-je, cette paix n'est qu'une paix trompeuse et apparente; les mêmes
passions qui tourmentent les hommes du monde, respirent ici ; on y ressent
tous les maux de l'enfer du Dante, et ce qui les accroît encore, c'est qu'on ne
laisse pas à la porte toute espérance.
 |
| illustration de l'Emile |
Nous nous promenâmes quelque temps dans le cloître et
dans les jardins. On y jouit d'une vue immense. Paris élevait au loin ses tours
couvertes de lumière, et semblait couronner ce vaste paysage : ce
spectacle contrastait avec de grands nuages plombés qui se succédaient à
l'ouest, et semblaient remplir la vallée. Plus loin on apercevait la Seine, le
bois de Boulogne et le château vénérable de Madrid, bâti par François Ier, père
des lettres. Comme nous marchions en silence, en considérant ce spectacle,
Rousseau me dit : Je reviendrai cet été méditer ici.
À quelque temps de là, je lui dis : Vous m'avez
montré les paysages qui vous plaisent ; je veux vous en faire voir un de
mon goût. Le jour pris, nous partîmes un matin au lever de l'aurore, et
laissant à droite le parc de Saint-Fargeau, nous suivîmes les sentiers qui vont
à l'orient, gardant toujours la hauteur, après quoi nous arrivâmes auprès d'une
fontaine semblable à un monument grec, et sur laquelle on a gravé :
Fontaine de Saint-Pierre. Vous m'avez amené ici, dit Rousseau en riant, parce
que cette fontaine porte votre nom. C'est, lui dis-je, la fontaine des amours,
et je lui fis voir les noms de Colin et de Colette. Après nous être reposés un
moment, nous nous remîmes en route. A chaque pas, le paysage devenait plus
agréable. Rousseau recueillait une multitude de fleurs, dont il me faisait
admirer la beauté. J'avais une boîte, il me disait d'y mettre ses plantes, mais
je n'en faisais rien ; et c'est ainsi que nous arrivâmes à Romainville. Il
était l'heure de dîner ; nous entrâmes dans un cabaret, et l'on nous donna
un petit cabinet dont la fenêtre était tournée sur la rue, comme celles de tous
les cabarets des environs de Paris, parce que les habitants de ces campagnes ne
connaissent rien de plus beau que de voir passer des carrosses, et que dans les
plus riants paysages, ils ne voient que le lieu de leurs pénibles travaux. On
nous servit une omelette au lard. Ah ! dit Rousseau, si j'avais su que
nous eussions une omelette, je l'aurais faite moi-même, car je sais très-bien
les faire. Pendant le repas, il fut d'une gaieté charmante ; mais
peu-à-peu la conversation devint plus sérieuse, et nous nous mîmes à traiter
des questions philosophiques à la manière des convives dont parle Plutarque
dans ses propos de table.
Il me parla d'Émile, et voulut m'engager à le
continuer d'après son plan. Je mourrais content, me disait-il, si je laissais
cet ouvrage entre vos mains ; sur quoi je lui répondis : Jamais je ne
pourrais me résoudre à faire Sophie infidèle ; je me suis toujours figuré
qu'une Sophie ferait un jour mon bonheur. D'ailleurs, ne craignez-vous pas
qu'en voyant Sophie coupable, on ne vous demande à quoi servent tant d'apprêts,
tant de soins ? est-ce donc là le fruit de l'éducation de la nature ?
Ce sujet, me répondit-il, est utile; il ne suffit pas de préparer à la vertu,
il faut se garantir du vice. Les femmes ont encore plus à se méfier des femmes
que des hommes. Je crains, répondis-je, que les fautes de Sophie ne soient plus
contraires aux mœurs, que l'exemple de sa vertu ne leur sera profitable :
d'ailleurs, son repentir pourrait être plus touchant que son innocence ;
et un pareil effet ne serait pas sans danger pour la morale. Comme j'achevais
ces mots, le garçon de l'auberge entra, et dit tout haut : Messieurs,
votre café est prêt. Oh ! le maladroit, m'écriai-je ! ne t'avais-je
pas dit de m'avertir en secret quand l'eau serait bouillante? Eh quoi, reprit
Jean-Jacques, nous avons du café ? En vérité, je ne suis plus étonné que
vous n'ayez rien voulu mettre dans votre boîte ; le café y était. Le café
fut apporté, et nous reprîmes notre conversation sur l'Émile. Rousseau me
pressa de nouveau de traiter ce sujet : il voulait remettre en mes mains
tout ce qu'il en avait fait ; mais je le suppliai de m'en dispenser :
Je n'ai point votre style, lui disais-je, cet ouvrage serait de deux couleurs.
J'aimerais mieux vos leçons de botanique. Eh bien ! dit-il, je vous les
donnerai ; mais il faudra les mettre au net, car il ne m'est plus possible
d'écrire. J'avais renoncé à la botanique, mais il me faut une occupation :
je refais un herbier.
Nous revînmes par un chemin fort doux, en parlant de
Plutarque. Rousseau l'appelait le grand peintre du malheur. Il me cita la fin
d'Agis, celle d'Antoine, celle de Monime, femme de Mithridate, le triomphe de
Paul Émile, et les malheurs des enfants de Persée. Tacite, me disait-il,
éloigne des hommes, mais Plutarque en rapproche. En parlant ainsi, nous
marchions à l'ombre de superbes marronniers en fleurs. Rousseau en abattit une
grappe avec sa petite faux de botaniste, et me fit admirer cette fleur, qui est
composée. Nous fîmes ensuite le projet d'aller dans la huitaine sur les
hauteurs de Sèvres. Il y a, me dit-il, de beaux sapins et des bruyères toutes
violettes : nous partirons de bon matin. J'aime ce qui me rappelle le
nord : à cette occasion je lui racontai mes aventures en Russie, et mes
amours malheureuses en Pologne. Il me serra la main, et me dit en me
quittant : J'avais besoin de passer ce jour avec vous.
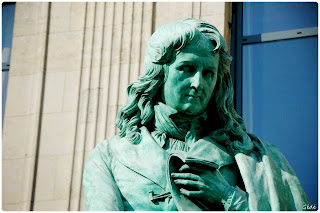 |
| Bernardin de Saint-Pierre |

.jpg)
























