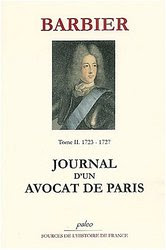Dans le passage qui suit, il évoque l'affaire bien connue des disparitions d'enfants à Paris en 1750.
Aujourd’hui, dimanche 24, tout
est assez tranquille; la rue Saint-Honoré, du côté de Saint-Roch, a été
seulement remplie de monde allant et venant à ne pouvoir passer, pour aller
voir les vitres cassées de la maison du commissaire et celles de M. Berrier. Il
y avait quelques escouades de guet à pied pour garder sa porte, et quelques
soldats aux gardes cachés dans la maison, mais il n’y en avait plus dans la
place de Vendôme; et pour prévenir tout accident de la part de cette populace
animée, surtout le soir, en revenant des guinguettes avec du vin dans la tête,
on a commandé trente hommes par compagnie des soldats aux gardes-françaises et
suisses, pour être sous les armes à leurs différents corps de garde et prêts à
marcher au premier coup de tambour, et on a commandé tout le guet tant à pied
qu’à cheval; ce qui s’exécutera, je crois, encore quelques jours, quoique,
suivant les apparences, il y ait des ordres bien précis de ne plus s’amuser à
aucun enfant.
Cet événement est d’autant plus
singulier que le peuple de Paris, en général, est assez doux et assez
tranquille, et l’on convient que, depuis quarante ans, on n’a point vu de
pareilles séditions, même dans les années de pain cher. Les émotions qu’il y a
eu ont été dissipées en peu de temps et plus aisément. Apparemment que ce fait
d’enlèvement de leurs enfants leur a été plus sensible et les a plus irrités ;
il y a eu, dans ces différentes émotions, quinze ou vingt personnes tuées ou
d’archers ou du peuple, sans ceux qui ont été bien blessés.
Il s’agit de savoir à présent ce
que l’on fera ; car on dit qu’hier on a arrêté quelques particuliers dans la rue
Saint-Honoré, et entre autres un domestique, qui peut être ne faisait qu’être
présent sans rien entreprendre ; c’est un laquais de M. Bonnet, fermier général,
homme de confiance du contrôleur général. En fera-t-on quelque exemple, parce
que, d’un côté, il est à craindre de faire naître une sédition plus générale ?
et, d’un autre côté, il est dangereux de laisser cela tout à fait impuni et de
laisser connaître au peuple sa force, et qu’il peut être redoutable; car, dans tout ceci, il a toujours eu le
dessus, et l’on a été obligé de le ménager.
Pour M. Berrier, lieutenant de
police, il n’est pas possible qu’il reste en place ; il était, dès auparavant,
détesté du peuple pour ses duretés et la quantité d’amendes qu’il impose sans
miséricorde. On dit même qu’on a fait des feux de joie dans son intendance,
quand il en est sorti ; mais quand il ne serait pas coupable, au fond, il
n’osera plus se montrer de longtemps et ses ordonnances seront méprisées.
Il y a eu, dans tout ceci, bien
de la négligence de M. Berrier, soit de n’avoir pas tenu la main à ses exempts
dans les premiers ordres, soit de n’avoir pas pris des mesures pour la sûreté
de Paris, après la première émotion du 16. On dit cependant qu’on ne doit pas
si tôt le faire sortir de sa place, pour ne pas donner au peuple cette
satisfaction et le mettre dans le cas de ne plus craindre et respecter ceux qui
occupaient cette place selon leur fantaisie.
D’ailleurs, on sent bien que
cette manœuvre, pour avoir des enfants, vient, dans la source, de M.
d’Argenson, ministre et secrétaire d’État de Paris. Cela a mal réussi, soit par
la faute de l’exécution et des ordres nécessaires, puisque c’est avoir exposé
la ville de Paris au feu et au pillage. Cet événement aura nécessairement déplu
au Roi ; il faudra que le ministre en rejette la faute sur quelqu’un pour se disculper,
et M. Berrier sera la victime de cette infâme politique. (…)
Lundi 25, la Grand Chambre du
Parlement étant en place, comme à
l’ordinaire, le lieutenant général de police et le procureur du Roi du Châtelet
se sont rendus au parquet, ont demandé à entrer pour rendre compte à la Cour de
ce qui s’était passé dans ces émeutes différentes pendant les vacations du
Parlement, depuis le samedi de la Pentecôte jusqu’à la Trinité. il a déclaré à
la Cour que les bruits d’enlèvement d’enfants étaient sans fondement; qu’il n’y
avait eu aucune ordonnance de police ni aucun ordre particulier donnés à cet
effet; que cela venait de la part de gens mal intentionnés pour troubler la
tranquillité publique. Sur quoi, après un discours des gens du Roi, la Cour a
rendu un arrêt par lequel elle a commis M. Severt, conseiller de Grand‘Chambre,
pour informer, à la requête du procureur général, tant des émotions populaires
que contre ceux qui ont répandu les faux bruits d’ordres donnés d’enlever des
enfants, que contre ceux qui se trouveraient coupables desdits enlèvements
d’enfants, si aucuns y a, avec défense de s’attrouper et de s’assembler dans
les rues de Paris, sous quelque prétexte que ce soit, sous les peines portées
par les ordonnances.
***
25 mai 1750. — J’ai vu des lettres de dimanche 24 qui disent que ce jour-là les rues étaient si pleines de monde, que celui qui écrit a été obligé de se réfugier dans un café, où il est resté enfermé trois heures. Certes ceci est excité et doit venir de plus loin que de la capture de quelques mendiants. On est heureux de se trouver hors d’une ville révoltée. 29 mai. — Le parlement vient de rendre un arrêt qui a été placardé dans toutes les rues. La cour déclare qu’il n’a point été donné d’ordre de police pour arrêter des enfants; que, s’il y en a eu d’arrêtés, les pères et mères n’ont qu’à se présenter pour en obtenir l’élargissement. Ainsi le parlement a-t-il fait l’office de médiateur efficace entre la cour et le peuple. On l’a regardé comme le sénat, et chacun y a pris une confiance qui sent plus le gouvernement démocratique que le monarchique, car les ministres sont aujourd’hui l’objet de la haine du peuple. (...)
M. Berryer, lieutenant de police, est surtout haï du peuple, qu’il a brutalisé, sans aucune qualité populaire. C’est un petit pédant, hautain et suffisant. Les discours de la populace ne tendaient qu’à le massacrer, à lui manger le coeur. On ne l’appelait que ce vilain M. Berryer. Il s’est sauvé chez lui par la porte de derrière, et s’est caché chez les jacobins. M. le premier président l’a mandé en vain pour rendre compte de tout ceci au parlement. Il a dit qu’il ne pouvait traverser Paris, qu’il craignait pour sa personne. De cette affaire là, il peut être dépossédé de sa place, et être fait conseiller d’État plutôt qu’il ne l’aurait été.
***
Cet arrêt a été expédié et imprimé
tout de suite, et, à onze heures du matin, il était affiché à tous les coins de
rues pour tranquilliser le peuple.
Cet arrêt était concerté de la
veille, car ordinairement le lieutenant de police ne vient point d’office au
Parlement ; il n’y vient que mandé par la Cour, et on n’a pas voulu perdre de
temps.
Bien des gens croient encore que les bruits d’enlèvement d’enfants sont faux, et qu’on n’en a point enlevé, parce qu’aucun de ceux qui
raisonnent ainsi n’en ont vu enlever. Ce n’est pas une raison ; il faudrait pour
cela s’être trouvé, à point nommé, dans les rues. Mais il faut observer que, de
tous temps, on prend les petits libertins et fainéants qui jouent sur les
portes et dans les carrefours, sans que le peuple s’en plaigne et se révolte, et que les gens de la police, préposés pour ces
captures, à qui on donne une rétribution par personne, abusent de leurs ordres
pour arrêter du monde
(à suivre ici)