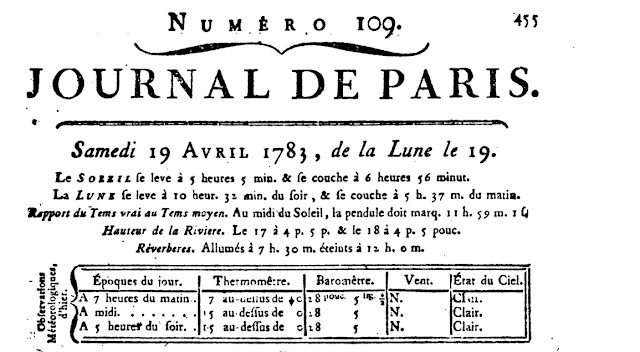Comme l'explique Marion Sigaut, c'est au cours de cette journée du 23 mai que la colère populaire va véritablement exploser.
D'abord le témoignage du marquis d'Argenson :
 |
| d'Argenson |
27 mai. —
Le peuple s'imagine toujours que les exempts enlèvent des enfants, et
il se montre des séditions aux quatre coins et au milieu de Paris à la
fois. On a poursuivi un exempt chez un commissaire ; on l'a jeté par les
fenêtres, on l'a repris et assommé à coups de pieds et de bâtons; on a
mené le cadavre chez M. Berryer, lieutenant de police; on a cassé les
vitres; il s'en est peu fallu qu'on n'ait enfoncé la maison; le
guet a résisté comme il a pu ; on fait armer les régiments des gardes
françaises et suisses. On me mande qu'il est certain qu'on n'arrête
point d'enfants, mais qu'on le fait accroire à la populace, et que l'on
craint quelque chose de fâcheux. (ndlr : si d'Argenson se montre si mal informé, c'est qu'il ne se trouvait pas à Paris à ce moment-là)
28 mai. —
Personne ne veut croire que les archers n'aient pas arrêté d'enfants et
que ce soit purement un effet de l'imagination du peuple surprise et
excitée. De part et d'autre on ne finirait pas sur les questions et sur
les sujets d'étonnement, car pourquoi arrête-t-on des enfants? que
ferait-on d'eux plutôt que d'hommes faits et de femmes capables de
peupler les colonies? Mais aussi pourquoi le peuple le croirait-il, si
cela n'était pas ? qui l'y exciterait, qui pousserait à des révoltes si
fréquentes et si universelles?
C'est encore pire s'il n'y a ni cause réelle, ni
chef de parti aiguillonnant le peuple à cette conduite; c'est un
mécontentement universel qui ne demandait qu'à paraître et qui se jette
sur le premier prétexte qu'il rencontre, puis s'emporte, éclate et gagne
de tous côtés comme la gangrène. Alors les hommes d'autorité et ayant
charge du gouvernement, les archers, les exempts qui portent l'habit
bleu sont les premiers qui ont paru sous la main et à la portée du
peuple. On s'est jeté sur eux sous des prétextes ridicules, et la
moindre apparence a offensé: il suffit qu'un homme eût l'apparence d'un
officier de police pour être déchiré. Voilà le peuple de Paris devenu
extrêmement cruel et déchirant les hommes comme des sauvages; des
archers, des pauvres, la haine et la hardiesse est montée aux exempts,
aux autres officiers, puis aux
commissaires et enfin au lieutenant de police qui est haï sans doute par
quelque acte de sévérité; on ne le respecte plus, on le hait, on
attaque sa maison. On est obligé de faire marcher partout des soldats de
la garde du roi : voilà le peuple sans frein et qui peut tout oser avec
impunité, car il n'y aura point de punition de ces massacres; quand le
peuple ne craint rien, il est tout; les hommes d'autorité ne peuvent
rien ; de là il monte bientôt à la haine de son roi, à moins qu'il ne le
voie et qu'il n'en reçoive des bienfaits et des actes de justice.(...)
On a entendu, parmi les cris de la populace, tenir des discours de grand mépris contre la personne même du roi.
J'ai vu des lettres de
dimanche 24 mai, qui disent que, ce jour-là, les rues de Paris étaient
si pleines de monde que celui qui écrit a été obligé de se réfugier
dans un café, où il a été renfermé trois heures. Certes ceci est excité
et paraît venir de plus loin que de la capture de ces mendiants. On est
heureux de se trouver hors d'une ville révoltée.
29 mai. —
Nous venons d'apprendre que tout est accommodé dans la populace de
Paris, par le parti qu'a pris le parlement de rendre un arrêt qu'on a
placardé à tous les coins de rues (ndlr : voir ci-dessous), par lequel la Cour déclare qu'on n'a
point donné d'ordre de police d'arrêter des enfants, que, s'il y en a eu
d'arrêtés, les père et mère n'ont qu'à présenter requête pour en
obtenir l'élargissement. (...)
M. Berryer, lieutenant de
police, s'est déshonoré du côté du cœur et de l'esprit dans tout ceci;
il s'est trouvé fort haï du peuple, qu'il a toujours brutalisé. Les
discours de la populace ne tendaient qu'à aller le massacrer, à lui
manger le cœur; on ne l'appelait que ce vilain M. Beurrier. Il s'est sauvé de chez lui par la
porte de derrière (dans son récit, Marion Sigaut confond la fuite de Berryer et celle de Delafosse) et s'est caché chez les jacobins. M. le premier
président l'a mandé en vain pour venir rendre compte au parlement de
tout ceci, il a dit qu'il ne pouvait traverser Paris, qu'il craignait
pour sa personne. Dans quelque temps d'ici il pourra être dépossédé de
sa place, la cour s'en prenant à lui du mauvais succès de cette police,
et voyant qu'il est si haï dans le peuple de Paris; et, de cette
affaire-là, il sera fait conseiller d'État plus tôt qu'il ne l'aurait
été.
Le témoignage de Barbier :
"Le plus vraisemblable, est qu'on
a besoin de petits enfants pour envoyer à Mississipi; mais, malgré cela, il
n'est pas à présumer qu'il y ait aucun ordre du ministre pour enlever ici des
enfants à leurs père et mère. On peut avoir dit à quelques exempts que s'ils
trouvaient des petits enfants sans père ni mère ou abandonnés, ils pourraient
s'en saisir; qu'on leur ait promis une récompense et qu'ils aient abusé de cet
ordre comme ils ont déjà fait quand il a été question de prendre tous les
vagabonds et gens sans aveu, dont il était avantageux de purger Paris".
D'ailleurs, on ne conçoit rien à ce projet : s'il est vrai qu'on ait besoin de
jeunes enfants des deux sexes pour des établissements dans l'Amérique, il y en
a une assez grande quantité tant dans les enfants trouvés du faubourg
Saint-Antoine, que dans tous les autres hôpitaux, pour remplir cette idée. Ces
enfants appartiennent au roi et à l'État : on peut en disposer sans blesser
personne. -Si la police agissait prudemment, ce serait de faire mettre, du
moins, quelques-uns de ces exempts pendant plusieurs jours de suite au carcan
pour apaiser le peuple et lui donner satisfaction."
On regrette que Marion Sigaut achève ici son récit. Car les jours qui suivent apportent eux aussi leur lot d'enseignements.
Nous y reviendrons.
(à suivre ici)