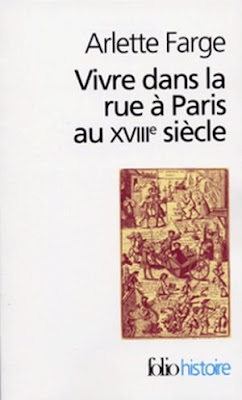Professeur d'histoire-géographie,
Anne-Marie Coustou pose un regard particulièrement critique sur
l'ouvrage de Jean-Clément Martin.
Voici quelques extraits de sa recension.
Un révolutionnaire qui justifie les massacres
La propension de Robespierre à justifier les massacres commis par le
peuple avait déjà été évoquée à propos des violences liées à la prise de
la Bastille (p. 82). On les retrouve sous forme d’interrogations à
propos des massacres de Septembre 1792. Après avoir cité à nouveau Manon
Roland qui accuse Robespierre de les avoir « permis » par la radicalité
de ses propos et après avoir affirmé que Robespierre les « justifie »,
l’auteur s’interroge : « La marche de la Révolution impose-t-elle de ne
pas s’intéresser à la trivialité des actes qui la favorisent ? Est-ce la
définition restrictive du « peuple » qui interdit toute compassion avec
les « traîtres » ? Le silence sur les exactions commises et le refus de
dénoncer ces actes barbares et de les considérer comme un acte de
justice est un choix dont la portée ne peut être éludée. » (p. 171-172.)
Ainsi, Martin interprète la célèbre formule de Robespierre « Citoyens !
Vouliez vous la Révolution sans la révolution ? » comme une
justification des massacres commis par le peuple destinée à « figer les
positions » à ce sujet. D’ailleurs l’auteur assimile les massacres
d’août (donc les violences consécutives aux tirs des gardes suisses
contre les insurgés des Tuileries le 10 août) à ceux de septembre. Il
déplore donc que, par sa faute, le débat sur ces massacres n’ait pas été
ouvert et affirme que « le jugement à porter sur ces tueries demeure en
suspens », car, selon lui, « la naissance de la république demeure
associée à cette tragédie » (p. 181). Nous retrouvons là sans surprise
les thèses de Furet sur le « dérapage » de la Révolution à partir de
septembre 1792, et même d’août pour Martin, dérapage porteur de
violences dont il convient de faire le procès à la Révolution.
En réalité, Robespierre ne « justifie » pas les massacres, il les
déplore comme tous les hommes politiques contemporains, mais il refuse
les manœuvres qui consistent, en prenant prétexte des violences
ponctuelles commises par certains groupes, à justifier la nécessité de
la répression contre les sans-culottes et le recours à des décrets
limitant la liberté du peuple, ce qui équivaudrait à une
contre-révolution. A propos des massacres, saluons la parution d’un
ouvrage qui va à l’encontre des idées reçues, celui de Micah Alpaugh qui montre que la violence, dans les manifestations politiques du
peuple de Paris, a été beaucoup plus l’exception que la règle et que le
peuple a toujours privilégié les méthodes pacifiques d’intervention dans
la vie politique chaque fois que cela était possible. Ouvrage salutaire
qui vient mettre en porte-à-faux tous les tenants de la violence du
peuple déchaîné.
 |
| JC Martin |
Grande mutation et abandon des principes
Cependant, pour J.-C. Martin, « c’est manifestement cette expérience
qui, non seulement modifie les sensibilités des contemporains, mais
change aussi les positions de Robespierre. » (p. 170) C’est ainsi qu’il
interprète la prise de position de Robespierre en faveur de la mort du
roi de manière étrange « au nom d’une nécessité quasi-eugénique visant à
débarrasser la terre d’un monstre » (p. 114), comme un « changement de
logique » (p. 188) et, en quelque sorte comme une « mutation » par
rapport au principe qu’il a toujours défendu du refus de la peine de
mort. En effet, l’auteur s’interroge : « Pense-t-il encore que
l’exécution capitale ne doit pas figurer dans le code pénal, donc que sa
position en janvier 1793 n’a été que ponctuelle, liée à la circonstance
exceptionnelle du procès de Louis XVI ? Rien n’est moins sûr. » (p.
189). Et l’auteur d’énumérer toute une série d’exemples où, à partir du
printemps 1793, Robespierre se prononce pour la peine de mort dans les
cas d’attentat contre « la sûreté générale de l’État ».
En premier lieu, il convient d’abord de préciser que Robespierre ne
parle pas d’attentats contre la « sûreté de l’Etat ». Il justifie la
peine de mort dans les cas de complots contre-révolutionnaires, donc des
attentats contre la liberté du peuple, ce qui est fort différent de
l’acception actuelle du terme de « sûreté de l’Etat ». Le 3 décembre
1792, après avoir déploré que l’Assemblée constituante a refusé sa
proposition d’abolir la peine de mort, il confirme ses convictions et
explique ainsi l’exception qu’il fait pour le roi : « Pour moi,
j’abhorre la peine de mort prodiguée par vos lois, et je n’ai pour Louis
ni amour ni haine : je ne hais que ses forfaits. J’ai demandé
l’abolition de la peine de mort à l’assemblée que vous nommez encore
constituante, et ce n’est pas ma faute si les premiers principes de la
raison lui ont paru des hérésies morales et politiques. Mais si vous ne
vous avisâtes jamais de les réclamer en faveur de tant de malheureux,
dont les délits sont moins les leurs que ceux du gouvernement, par
quelle fatalité vous en souvenez-vous seulement pour plaider la cause du
plus grand de tous les criminels ? Vous demandez une exception à la
peine de mort pour celui-là seul qui peut la légitimer ? Oui, la peine
de mort en général est un crime, et par cette raison seule que, d’après
les principes indestructibles de la nature, elle ne peut être justifiée
que dans les cas où elle est nécessaire à la sûreté des individus ou du
corps social….Un roi détrôné au sein d’une révolution…, un roi dont le
nom seul attire le fléau de la guerre sur la nation agitée ; ni la
prison ni l’exil ne peut rendre son existence indifférente au bonheur
public ; et cette cruelle exception aux lois ordinaires… ne peut être
imputée qu’à la nature de ses crimes (18). »
Ensuite, pour apprécier correctement ce présumé « changement de
logique », il convient de rappeler le contexte qui amena l’Incorruptible
à prendre de telles positions, apparemment contradictoires avec celles
défendues auparavant. Rappelons qu’en mars 1793 la France dut faire face
à de multiples dangers : la débâcle des armées françaises suite à la
guerre de conquête impulsée par les Girondins, la menace d’invasion
imminente du territoire de la République par les armées coalisées de
tous les monarques européens, le soulèvement de la Vendée contre la
République et la guerre civile fédéraliste allumée dans les départements
par la Gironde. Face à cette situation de grand péril, les vrais
défenseurs du peuple avaient-ils un autre choix pour sauver les acquis
de la Révolution que d’adopter des mesures exceptionnelles ? Les
principes indispensables en temps de paix pouvaient-ils s’appliquer
intégralement ? Les changements relevés chez Robespierre à propos de la
peine de mort ne peuvent s’appréhender qu’en tenant compte de cette
situation nouvelle. En d’autres termes, ce n’est pas Robespierre qui a
changé, c’est le contexte.
Comme il ne tient pas compte de ce contexte nouveau, J.-C. Martin en
déduit logiquement que « la position que Robespierre adopte dorénavant
sur la peine de mort semble répondre à cette mutation. Accepter de payer
le prix du sang permet de s’appuyer sur la force vive des
sans-culottes… » (p. 190). (...)
L’Incorruptible corrompu ?
J.-C. Martin suggère d’ailleurs que cet « abandon des principes » ne
concernerait pas seulement la question de la peine de mort. Même sa
probité légendaire serait également sujette à caution. Lorsque le
Journal Les Révolutions de Paris accuse Robespierre d’être « un traître
fréquentant la maison de la princesse de Lamballe, où il aurait trouvé
l’argent pour lancer son propre journal » (le Défenseur de la
Constitution), Martin estime que « la question reste posée, personne
n’ayant, semble-t-il, expliqué comment Robespierre a pu ainsi abandonner
un poste de magistrat pour une situation de folliculaire, soumis à une
opinion et à un éditeur,… » (p. 159). Rappelons, pour éclaircir ce
prétendu mystère, que, d’une part, le Défenseur de la Constitution »
était financé par souscription, et que, d’autre part, le train de vie de
Robespierre était très sobre car il considérait le luxe et le confort
comme très accessoires. (...)
« Accéder au pouvoir » pour « purger la société »
A propos de la journée du 10 août, dans laquelle Robespierre est
pourtant supposé n’avoir joué aucun rôle, et des massacres de septembre,
qu’il est censé avoir favorisés par la radicalité de ses propos, Martin
tire la conclusion suivante : « Cette série de coups de force est-elle
le prix à payer pour accéder au pouvoir et purger la Révolution de ses
membres égoïstes et corrompus ? Sans doute » (p. 172). L’image du
doctrinaire utopiste aspirant au pouvoir pour y installer un régime
totalitaire se dessine. Ce thème de la « dérive totalitaire » de la
Révolution en général, et de Robespierre en particulier, se précise dans
le chapitre intitulé « L’idole abattue ». Dans ce chapitre, l’auteur
développe des thèses très ambiguës. Le ton est donné dès
l’introduction : « Après le 5 avril, tous les Conventionnels peuvent
légitimement craindre de connaître le même sort » (que Danton) (p. 269).
« Or, non seulement Robespierre a joué un rôle de premier plan dans
cette opération, mais il semble bien vouloir continuer de mettre
l’Assemblée au pas » (p. 269). Même s’il reconnaît, ainsi que
l’historiographie en a maintenant fait la démonstration, que cette
légende d’un Robespierre sanguinaire, obsédé par le pouvoir et désireux
d’éliminer tous ses adversaires, a été forgée par ses ennemis, les
Thermidoriens, dès avant sa mort, et qu’elle a été divulguée dans
l’opinion pour le discréditer, l’auteur ne s’interdit pas pour autant de
glisser quelques insinuations tendant à faire penser que cette volonté
de s’emparer du pouvoir qui lui est prêtée ne serait pas totalement
dénuée de fondement. Ainsi, à propos de la fête de l’Être suprême,
affirme-t-il que les députés « craignent que Robespierre ne se
transforme en grand prêtre ou en grand inquisiteur, disposant d’un
pouvoir sans limites sur l’opinion et de troupes à sa solde » (p. 275)
car le cérémonial a « isolé radicalement les spectateurs et figurants
des pontifes, et pire, du pontife unique ». Martin se pose donc la
question de savoir si Robespierre « était conscient de ce qu’il a
organisé autour de sa personne » (p. 277), faisant ainsi une allusion
tacite au culte de la personnalité développé dans les régimes
totalitaires.
On sait pourtant que ce fantasme du « grand pontife » a été créé de
toutes pièces par les Thermidoriens, qui n’ont rien négligé pour
accréditer cette idée. Ces craintes supposées des députés ne sont donc
que des fantasmes, très utiles pour instiller la crainte dans l’esprit
des conventionnels hésitants et pour discréditer Robespierre dans
l’opinion. (...)
 |
| Robespierre |
Au total, cette biographie, qui se présente comme un cheminement pas à
pas dans la vie de Robespierre accompagnée d’une confrontation
sélective et étriquée avec d’autres personnages ayant vécu les mêmes
événements, offre des analyses parfois intéressantes mais difficilement
compréhensibles pour le lecteur, en particulier pour le lecteur non
averti, dans la mesure où le récit donne à voir un parcours dépourvu de
toute logique intrinsèque et qui s’insère dans une histoire dont la
trame n’est pas présentée, si ce n’est de manière anecdotique dans
certains passages. Aucun fil conducteur ne permet donc d’appréhender le
raisonnement politique de l’Incorruptible puisque ces prises de position
sont présentées la plupart du temps comme relevant de tactiques
politiciennes fluctuantes. On a du mal à comprendre à quel type de
lecteur cet ouvrage s’adresse. Il apparaît comme trop touffu pour un
lecteur néophyte qui se perdrait dans les méandres du cheminement en
apparence incohérent de Robespierre sans connaître les idées maîtresses
de sa pensée ni le contexte global qui a déterminé ses prises de
position, puisque seul le micro-contexte du moment est parfois évoqué.
Mais il semble d’un intérêt limité pour les historiens qui connaissent
déjà ce contexte et qui n’y trouvent aucun élément nouveau susceptible
d’enrichir la personnalité du révolutionnaire, d’autant plus que
l’absence de notes montre clairement que l’auteur a renoncé à faire
œuvre d’historien. Le seul auditoire visé par Martin semble en réalité
être celui des « fanatiques » supposés de Robespierre qu’il présume
ignorants des hésitations, des erreurs et des faiblesses de
l’Incorruptible, et qu’il prétend déniaiser. D’où l’impression dominante
qui ressort de cette biographie d’un Robespierre plutôt falot, suiviste
et indécis, cultivant les « postures », privilégiant la tactique aux
principes, mais préoccupé avant tout par son accession au pouvoir afin
d’instaurer un régime d’intolérance pour purger la société de ses
éléments impurs.