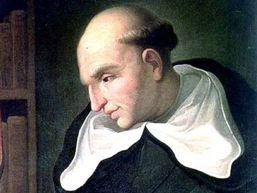"La tradition marxiste voit dans les révolutions de la liberté et de
l’égalité, qui précédèrent la Révolution russe de 1917, des “révolutions
bourgeoises”. On sait que Marx a laissé des éléments d’analyse, qui
présentent des moments différents et même contradictoires de sa
réflexion, correspondant à l’évolution de ses connaissances et de sa
compréhension de la Révolution française. Le schéma interprétatif, dont
il sera question ici, a été produit par la tradition marxiste et est,
lui-même, une interprétation des analyses laissées par Marx.
Toutefois,
mon propos n’est pas de reconstituer comment un tel schéma
interprétatif a été produit, bien que ce travail reste à faire, il est
même urgent, mais, plus précisément de chercher à savoir si ce schéma
interprétatif correspond à la réalité historique.
(...)
 |
| l'historienne Florence Gauthier |
Le schéma interprétatif de la “révolution bourgeoise” s’est peu à peu constitué en préjugé
et, comme tel, sa fonction est d’empêcher de penser. Je voudrais
maintenant montrer à travers trois exemples significatifs cette fonction
du préjugé.
Je commencerai par le problème de la perte de
visibilité d’une conception éthico-politique révolutionnaire de la
liberté républicaine, qui s’est pourtant largement exprimé pendant la
révolution, et qui a été depuis, recouvert par un libéralisme économique
privilégié de façon unilatérale, entre autres par les tenants du schéma
interprétatif de la “révolution bourgeoise”.
La Déclaration des
droits de l’homme et du citoyen de 1789 a été le produit de trois
siècles d’expériences et de réflexions, centrées sur l’idée de droit
naturel universel. La philosophie du droit naturel moderne, confrontée
aux conquêtes coloniales, à l’extermination des Indiens, à la mise en
esclavage des Noirs, aux massacres des guerres de religion, au
despotisme de l’Etat, à l’expropriation des petits producteurs, à la
prostitution de subsistance, s’affirme, dans un effort cosmopolitique,
comme la conscience critique de la “barbarie européenne”.
La
Déclaration des droits de 1789 n’a donc pas été l’œuvre de quelques
jours. Son objectif était de mettre un terme au despotisme et à la
tyrannie. La monarchie de droit divin était de nature despotique. Le roi
n’était responsable que devant Dieu. Il devait cependant respecter la
“constitution” du royaume, mais son irresponsabilité autorisait le
despote à outrepasser ces limites purement morales et à devenir un
tyran.
En établissant la Déclaration des droits de l’homme et du
citoyen, la révolution voulait mettre un terme au despotisme qui
reposait sur une théorie pratique du pouvoir sans limites autres que
morales (le bon prince), donc sans droit. Le principe de souveraineté
populaire détruisait celui de droit divin et restituait la souveraineté,
comme bien commun, au peuple. Ce faisant, le principe de souveraineté
populaire s’accompagnait de la séparation entre politique et théologie :
au cœur de la doctrine des droits de l’homme et du citoyen se trouve la
liberté de conscience, ce fruit précieux produit par les hérétiques,
qui affirmèrent contre tous les dogmatismes doctrinaux, l’existence d’un
droit naturel attaché à la personne et qui passe avant tout pouvoir
ici-bas et s’impose à toutes les institutions créées par les hommes.
Dans
ce sens, la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen fondait un
contrat social sur la protection des droits personnels et du droit
collectif de souveraineté populaire, c’est-à-dire sur des principes
traduits concrètement en termes de droit.
S’appuyant sur les
expériences hollandaise et anglaise et sur celle des Etats-Unis, la
Déclaration des droits établissait le principe lockéen du pouvoir
législatif, expression de la conscience sociale, comme pouvoir suprême.
À
contrario, le pouvoir exécutif était considéré comme dangereux par
nature. En effet, le despotisme se caractérisait, et se caractérise
toujours, par une confusion de l’exercice des pouvoirs législatif et
exécutif. L’exécutif devait donc être subordonné étroitement au
législatif et responsabilisé, c’est-à-dire contraint de rendre des
comptes rapidement, de façon à permettre de l’empêcher de nuire dès que
possible.
Insistons sur ce point : l’objectif des révolutions de
1789 et de 1792-94 était de déclarer les droits de l’homme et du
citoyen, de construire un pouvoir législatif suprême et d’inventer des
solutions nouvelles pour parvenir à subordonner l’exécutif, dangereux
dès qu’il est autonome, au législatif.
La théorie de la Révolution
des droits de l’homme et du citoyen fonde une liberté républicaine : la
Déclaration des droits affirme que le but de l’ordre social et
politique est la réalisation et la protection des droits de liberté des
individus et des peuples, à condition que ces droits soient universels,
c’est-à-dire réciproques, et ne soient donc pas transformés en leur
contraire, c’est-à-dire en privilèges. Cette théorie de la révolution
affirme également possible une société fondée non sur la force, mais sur
le droit. Ici, la légitimité du droit devient le problème même de la
politique.
Il se produisit un conflit exemplaire
pendant la Révolution lorsqu’éclata la contradiction entre la liberté
politique fondée sur un droit personnel universel et ce que l’on appelle
la liberté économique. Développons ce point.
Le
mouvement populaire, et en particulier paysan, remit en question non
seulement l’institution de la seigneurie, en se réappropriant les
tenures et les biens communaux usurpés par les seigneurs, mais aussi en
s’opposant à la concentration de l’exploitation agricole réalisée par
les gros fermiers capitalistes.
Par ailleurs, la société était
menacée par les transformations de type capitaliste dans le marché des
subsistances. La guerre du blé commençait : les gros marchands de
grains cherchaient à s’entendre avec les gros producteurs pour
substituer aux marchés publics, contrôlés par les pouvoirs publics, un
marché de gros privé. Ces marchands devenaient capables, dans certains
lieux comme les villes, de contrôler l’approvisionnement du marché et
d’imposer les prix. La spéculation à la hausse des prix des subsistances
fut un des problèmes majeurs de cette époque, comme l’ont
remarquablement montré les travaux d’Edward Palmer Thompson en
particulier.
Les économistes dits libéraux de l’époque, en fait
d’inspiration physiocratico-turgotine soutenaient, avec beaucoup de
conviction, que le droit à l’existence et aux subsistances du peuple
n’était qu’un préjugé, que, dans le moyen terme, il serait assuré par la
liberté indéfinie du commerce des grains, qui devait résoudre le
problème de la production et de la consommation pour tous, par
l’harmonie des intérêts individuels en concurrence.
Or,
l’Assemblée constituante se rallia à la politique des économistes dits
libéraux, proclama la liberté illimitée de la propriété et vota la loi
martiale pour réprimer les résistances populaires. La contradiction qui
éclata entre le droit de propriété, qui n’est pas universel, et le droit
naturel à la vie et à la conservation de l’existence, fut exemplaire.
Deux conceptions de la liberté s’affrontèrent. Le libéralisme économique
révéla son caractère pseudo libéral en renonçant à l’universalité du
droit et en rompant ainsi avec la théorie de la Révolution des droits de
l’homme et du citoyen. La Constitution de 1791 viola la Déclaration des
droits en imposant un suffrage censitaire, qui restreignait le droit de
vote aux chefs de famille mâles et riches, maintint l’esclavage dans
les colonies, au nom de la préservation des propriétés, nous l’avons
déjà aperçu avec Barnave, et appliqua la loi martiale provoquant une
guerre civile en France et dans les colonies : la grande insurrection
des esclaves commença à Saint-Domingue en août 1791, et ne s’arrêta plus
jusqu’à l’abolition de l’esclavage et l’indépendance de l’île.

La Révolution du 10 août 1792 renversa cette constitution.
Le mouvement démocratique remit la Déclaration des droits à l’ordre du
jour et réclama un nouveau droit de l’homme : le droit à l’existence et
aux moyens de la conserver. Les droits économiques et sociaux furent une
véritable invention de cette période.
La liberté illimitée du
droit de propriété et la loi martiale furent abrogées. Un programme
d’économie politique populaire, dénommé ainsi à l’époque, s’élabora de
1792 à 1794 : le mouvement paysan réalisa une véritable réforme agraire,
en récupérant la moitié des terres cultivées et les biens communaux. La
seigneurie juridique et politique fut supprimée et la communauté
villageoise lui succéda. La politique du Maximum reforma les marchés
publics et créa des greniers communaux, qui permirent de contrôler les
prix et de réajuster prix, salaires et profits.
Par ailleurs, la
citoyenneté fut pratiquée de façon nouvelle. Le suffrage universel se
restreint légalement aux hommes, mais, dans la pratique, de nombreuses
assemblées primaires étaient mixtes et offraient le droit de vote aux
femmes : les citoyens des deux sexes participaient réellement à la
formation de la loi en discutant dans leurs assemblées, en pétitionnant
et en manifestant. Citoyens et députés constituaient ensemble le pouvoir
législatif, pouvoir suprême, créant une expérience originale d’espace
public de réciprocité du droit (11), ce qui était la définition même que
l’on donnait alors à la république : un espace public allant
s’élargissant et permettant aux citoyens, non pas seulement de
communiquer, mais de décider, d’agir et de s’instruire.
Cette
économie politique populaire inventa une solution originale en
subordonnant l’exercice du droit de propriété des biens matériels au
droit à la vie et à l’existence, premier droit de l’homme. Le droit à la vie est une propriété de tout être humain, qui passe avant le droit des choses.
Rien
de plus libéral au sens fort et authentique du terme que ce programme
d’économie politique subsumé sous le droit naturel : l’exercice de la
liberté est en effet lié à la nature universelle de l’homme, c’est une
qualité réciproque fondée sur l’égalité en droits pour tous reconnue par
la loi, tandis que la liberté économique indéfinie n’est pas une
liberté civile, mais une liberté antinomique de la liberté politique
républicaine, destructrice de tout pacte social, donc de toute société
politique. C’est alors par antiphrase que l’économie classique se veut
politique, à moins de considérer le politique comme nécessairement
despotique, ce qui était, il est vrai, le cas des économistes
physiocrates et turgotins, comme des économistes qui firent appel à la
loi martiale.
On aperçoit ici que cette conception
éthico-politique révolutionnaire de la liberté est proche des
préoccupations de Marx, lorsqu’il commente la loi relative au vol de
bois, ainsi que des critiques qu’il formule sur le droit de propriété
dans les déclarations des droits de 1789 et de 1793 dans Sur la question
juive, et encore dans sa Critique du droit hégélien, à propos du
pouvoir législatif.
Pourtant, le schéma interprétatif de la
“révolution bourgeoise” se révèle incapable de prendre en considération
cette grande lutte entre ces deux conceptions de la liberté que je viens
de rappeler, et se limite à une justification unilatérale du
libéralisme économique, révélant son impuissance à saisir cette réalité
historique.
Je voudrais maintenant rappeler la dimension cosmopolitique
de la Révolution des droits de l’homme et du citoyen, qui est restée
largement ignorée de l’historiographie et entre autres, de la tradition
marxiste de la “révolution bourgeoise”.
Précisons tout d’abord que
la Révolution qui eut lieu en France prend place dans un grand cycle de
révolutions ouvertes par les indépendances de la Corse (1729) et des
Etats-Unis, suivies des Révolutions de l’Europe, de celle d’Haïti, puis à
nouveau, au début du XIXe siècle, des colonies portugaises et
espagnoles d’Amérique. Autrement dit, la Révolution en France ne fut pas
isolée, et prend place au beau milieu d’un mouvement de décolonisation
de l’Amérique. La dimension mondiale de ce cycle révolutionnaire mérite
d’être prise en considération !
En 1789, le Royaume de France
était une puissance conquérante en Europe, et colonialiste hors
d’Europe. Des penseurs des Lumières avaient déjà analysé ce système en
le reliant aux formes d’économie de domination fondées sur l’échange
inégal. Ce système impérialiste avait été désigné par les termes de “
barbarie européenne”, par Las Casas puis repris par Diderot et Mably,
par exemple.
Thomas Paine, juste au moment où il allait être
élu député à la Convention, publiait Les droits de l’homme, dans lequel
il critiqua les fondements anthropologiques du droit public européen. Il
réfuta la dénomination “d’état civilisé” que s’attribuait l’Europe, par
opposition à ‘’l’état de sauvage”. Paine montra le rapport intime qui
existait entre la politique despotique des états européens à l’intérieur
et à l’extérieur. Le système économique et la politique coloniale ont
provoqué, écrit-il, une crise sociale qui est la honte de l’Europe et ce
système n’entretient ni un état civilisé, ni un état sauvage, mais un
état de barbarie. Paine espérait que les révolutions en Europe et dans
le domaine colonial européen allaient ouvrir un processus de
renversement des politiques de puissance. Il formula cette perspective
dans les termes suivants : ”Droits de l’homme ou barbarie ” !
Il
existait bien à cette époque un courant de pensée et d’action critique
de l’impérialisme européen, non européocentrisme, et qui exprima la
menace que la barbarie européenne représentait, en Europe même, et pour
le monde.
Voici une des dimensions les plus intéressantes de l’histoire de la fin du XVIIIe siècle.
Précisons
que la théorie révolutionnaire des droits de l’homme et du citoyen posa
le problème, non pas seulement en termes politiques par rapport à une
société politique isolée, mais de façon cosmopolitique en intégrant les
relations qu’une société particulière entretient avec les autres
peuples.
L’objectif de la constitution des droits de l’homme et du
citoyen ne fut pas, en effet, de construire une souveraineté nationale
étanche aux droits des autres peuples. Ici aussi le droit naturel des
peuples à leur souveraineté impliquait le principe de réciprocité du
droit universel.
En 1790, l’Assemblée constituante renonça
solennellement aux guerres de conquête en Europe. La République
démocratique, après s’être libérée de la guerre de conquête, véritable
diversion que les Girondins tentèrent de septembre 1792 à mars 1793,
alla plus loin en soutenant la révolution des esclaves de
Saint-Domingue, en abolissant l’esclavage dans les colonies françaises
et en menant une politique commune contre les colons esclavagistes et
leurs alliés anglais et espagnols. Une perspective décolonisatrice
prenait corps, mais elle fut arrêtée, puis renversée, par le 9 thermidor
et ses suites.
La Constitution thermidorienne de 1795 renoua avec
une politique de conquête en Europe et coloniale, hors d’Europe. Cette
constitution qui supprima les institutions démocratiques et le suffrage
universel, prépara le rétablissement de l’esclavage par Bonaparte. Déjà,
lors de l’expédition d’Egypte en 1798, Bonaparte avait des esclaves. En
1802, Bonaparte devenu Consul, lança ses armées dans les Antilles et en
Guyane, pour rétablir l’esclavage. Ce qui provoqua l’indépendance de la
République haïtienne en 1804.
Malgré les appels réitérés des
historiens des révolutions coloniales - pensons en particulier à C.L.R.
James et A. Césaire - il faut bien reconnaître, à la suite d’Yves Bénot,
les silences étonnants de l’historiographie de la Révolution française
sur le problème colonial. Plus troublant est le silence des historiens
marxistes, de quelque tendance qu’ils soient d’ailleurs, orthodoxes ou
dissidents comme on dit, mais le résultat est le même.
Là
encore, le schéma interprétatif de la “révolution bourgeoise” se révèle
incapable de saisir la réalité historique. Et nous avons même vu comment
on a pu mettre Barnave, l’esclavagiste, dans la filiation
intellectuelle de Marx, et ceci au nom de Marx ! Voilà où nous en
sommes !
Pour conclure, je voudrais simplement rappeler quelques
faits qui s’opposent fortement aux résultats que l’on se plait à
attribuer aux “révolutions bourgeoises”. Elles auraient, nous dit-on,
permis en même temps que l’avènement du capitalisme, celui de la
démocratie et des droits de l’homme.
Tout d’abord, faut-il
justifier, comme certains le font sans aucun recul critique, l’avènement
du capitalisme ? En ce qui concerne l’avènement parallèle de la
démocratie et des droits de l’homme, que l’on me permette de prouver la
fausseté de cette affirmation, en ce qui concerne l’histoire française.
La
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 déclarait des
droits naturels attachés à la personne et donc universels. Mais la
Constitution de 1791 viola la Déclaration des droits et établit un
système censitaire, que l’on appela à l’époque l’aristocratie de la
richesse : le droit de suffrage n’était pas ici attaché à la personne,
mais à la richesse, c’est-à-dire à des choses. La Révolution du 10 août
1792 renversa cette Constitution de 1791 et la Constitution de 1793
renoua avec les principes de la Déclaration des droits de l’homme et du
citoyen, c’est-à-dire des droits naturels attachés à la personne. Ce fut
entre 1792 et 1794 que des institutions démocratiques apparurent :
démocratie communale, députés et agents élus de l’exécutif,
décentralisation administrative responsabilisée, apparition d’un espace
public s’élargissant. Ce processus fut arrêté et réprimé à la suite du 9
thermidor et la Constitution de 1795 supprima les institutions
démocratiques et les communes, et établit à nouveau un système
censitaire. Au moment où “la bourgeoisie” prenait le pouvoir, elle
supprima les institutions démocratiques.
Mais elle fit plus, elle
rompit avec la théorie de la révolution : en effet, la Constitution de
1795 répudia la philosophie du droit naturel moderne et la Déclaration
des droits naturels attachés à la personne et réciproques. Voilà qui est
important et que l’historiographie affecte encore trop souvent de ne
pas comprendre.
Sous le Consulat et l’Empire, Bonaparte, en
rétablissant l’esclavage, fit perdre jusqu’au souvenir de la philosophie
du droit naturel moderne et de l’idée même d’une déclaration des droits
de l’homme et du citoyen. En fait de démocratie, il n’y en eut plus
trace en France pendant près d’un siècle. Ce furent les révolutions de
1830, 1848, 1871, qui redéployèrent les idées de démocratie et de droits
de l’homme, et imposèrent la stabilisation du suffrage universel
masculin avec la IIIe République. Quant à la Déclaration des droits de
l’homme et du citoyen, répudiée en 1795, elle ne fit sa réapparition
qu’en... 1946, avec le droit de vote des femmes, soit plus de 150 ans
après sa déclaration et à l’issue d’une guerre mondiale effroyable
contre le nazisme.
On ne voit pas que démocratie et droits de
l’homme soient advenus avec le capitalisme. Ce serait faire croire que
la philosophie du droit naturel moderne, théorie de la révolution des
droits de l’homme et du citoyen, aurait été l’idéologie des
capitalistes, alors qu’elle était l’expression de la conscience critique
de la barbarie européenne."