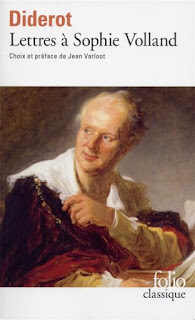Roman pornographique (souvent attribué au marquis d'Argens) distribué clandestinement en 1748, Thérèse philosophe connut un succès considérable dans la France des Lumières.
Après la mort de sa mère, Thérèse vient de faire connaissance avec la Bois-Laurier qui lui raconte son passé libertin. Un jour, alors qu'elle était en compagnie de Mme Dupuis, une sexagénaire, elle a reçu la visite de "trois capucins"...
***
Un instant après entrèrent nos trois capucins, qui, peu accoutumés à
goûter d’un morceau aussi friand que je paraissais l’être, se jettent
sur moi comme trois dogues affamés. J’étais dans ce moment debout, un
pied élevé sur une chaise, nouant une de mes jarretières. L’un, avec une
barbe rousse et une haleine infectée, vient m’appuyer un baiser sur la
parole ; encore cherchait-il à chiffonner avec sa langue. Un second
tracassait grossièrement sa main dans mes tétons ; et je sentais le
visage du troisième, qui avait levé ma chemise par derrière, appliqué
contre mes fesses, tout près du trou mignon, quelque chose de rude comme
du crin, passé entre mes cuisses, me farfouillait le quartier de
devant ; j’y porte la main : qu’est-ce que je saisis ? la barbe du
Père Hilaire, qui, se sentant pris et tiré par le menton, m’applique,
pour m’obliger à lâcher prise, un assez vigoureux coup de dent dans une
fesse. J’abandonne, en effet, la barbe, et un cri perçant, que la
douleur m’arrache, en impose heureusement à ces effrénés et me tire pour
un moment de leurs pattes. Je m’assis sur un lit de repos près lequel
j’étais ; mais à peine ai-je le temps de m’y reconnaître que trois
instruments énormes se trouvent braqués devant moi.
« Ah ! mes Pères, m’écriai-je, un moment de patience, s’il vous
plaît ; mettons un peu d’ordre dans ce qui nous reste à faire. Je ne
suis point venue ici pour jouer la vestale : voyons donc avec lequel de
vous trois je…
« — C’est à moi ! s’écrièrent-ils tous ensemble, sans me donner le
temps d’achever. — À vous, jeunes barbares ? reprit l’un d’eux en
nasillant. Vous osez disputer le pas à Père Ange, ci-devant gardien de…,
prédicateur du carême de…, votre supérieur ! Où est donc la
subordination ? — Ma foi ! ce n’est pas chez la Dupuis, reprit l’un
d’eux, sur le même ton ; ici, Père Anselme vaut bien Père Ange. — Tu en
as menti ! » répliqua ce dernier en apostrophant un coup de poing dans
le milieu de la face du très révérend Père Anselme. Celui-ci, qui
n’était rien moins
que manchot, saute sur Père Ange ; tous deux se saisissent, se
collètent, se culbutent, se déchirent à belles dents ; leurs robes,
relevées sur leurs têtes, laissent à découvert leurs misérables outils,
qui, de saillants qu’ils s’étaient montrés, se trouvaient réduits en
forme de lavettes. La Dupuis accourut pour les séparer ; elle n’y
réussit qu’on appliquant un grand seau d’eau fraîche sur les parties
honteuses de ces deux disciples de saint François.

Pendant le combat, Père Hilaire ne s’amusait point à la moutarde.
Comme je m’étais renversée sur le lit, pâmée de rire et sans force, il
fourrageait mes appas et cherchait à manger l’huître disputée à belles
gourmades par ses deux compagnons. Surpris de la résistance qu’il
rencontre, il s’arrête pour examiner de près les débouchés ; il
entr’ouvre la coquille, point d’issues. Que faire ? Il cherche de
nouveau à percer : soins perdus, peines inutiles. Son instrument, après
des efforts redoublés, est réduit à l’humiliante ressource de cracher au
nez de l’huître qu’il ne peut gober.
Le calme succéda tout à coup aux fureurs monacales. Père Hilaire
demanda un instant de silence ; il informa les deux combattants de mon
irrégularité et de la barrière insurmontable qui fermait l’entrée du
séjour des plaisirs. La vieille Dupuis essuya de vifs reproches,
dont elle se défendit en plaisantant, et, en femme qui sait son monde,
elle tâcha de faire diversion par l’arrivée d’un convoi de bouteilles de
vin de Bourgogne qui furent bientôt sablées.
Cependant, les outils de nos Pères reprennent leur première
consistance. Les libations bachiques sont interrompues de temps à autre
par des libations à Priape. Toutes imparfaites qu’étaient celles-ci, nos
frapparts semblent s’en contenter, et tantôt mes fesses, tantôt leurs
revers, servent d’autels à leurs offrandes.
Bientôt une excessive gaieté s’empare des esprits. Nous mettons à nos
convives du rouge, des mouches : chacun d’eux s’affuble de quelqu’un de
mes ajustements de femme ; peu à peu je suis dépouillée toute nue et
couverte d’un simple manteau de capucin, équipage dans lequel ils me
trouvèrent charmante. « N’êtes-vous pas trop heureux, s’écria la Dupuis,
qui était à moitié ivre, de jouir du plaisir de voir un minois comme
celui de la charmante Manon ? »
« Non, ventrebleu ! répliqua Père Ange d’un ton de fureur bachique ;
je ne suis point venu ici pour voir un minois : c’est pour f..... un c..
que je m’y suis rendu ; j’ai bien payé, ajouta-t-il, et ce v.. que je
tiens en main n’en sortira, ventredieu ! pas qu’il n’ait f....., fût-ce
le diable ! »
Écoute bien cette scène, me dit la Bois-Laurier en s’interrompant ;
elle est originale ; mais je t’avertis (peut-être un peu tard) que je ne
puis rien retrancher à l’énergie des termes, sans lui faire perdre
toutes ses grâces.
La Bois-Laurier avait trop élégamment commencé pour ne pas la laisser
finir de même : je souris ; elle continua ainsi le récit de cette
aventure :
« Fût-ce le diable, répéta la Dupuis, se levant de dessus sa chaise
et élevant la voix du même ton nasillant que celui du capucin ; eh
bien ! b....., dit-elle en se troussant jusqu’au nombril, regarde ce c…
vénérable, qui en vaut bien deux ; je suis une bonne diablesse : f…-moi
donc, si tu l’oses, et gagne ton argent ». Elle prend en même temps Père
Ange par la barbe et l’entraîne sur elle, en se laissant tomber sur le
petit lit. Le Père n’est point déconcerté par l’enthousiasme de sa
Proserpine ; il se dispose à l’enfiler, et l’enfile à l’instant.
À peine la sexagénaire Dupuis eut-elle éprouvé le frottement de
quelques secousses du Père que ce plaisir délicieux, qu’aucun mortel
n’avait eu la hardiesse de lui faire goûter depuis plus de vingt-cinq
ans, la transporte et lui fait bientôt changer de ton. « Ah ! mon papa,
disait-elle, en se démenant comme une enragée, mon cher papa, f… donc ;
donne-moi du plaisir !…
je n’ai que quinze ans, mon ami ; oui, vois-tu ? je n’ai que quinze
ans… Sens-tu ces allures ? Va donc, mon petit chérubin !… tu me rends la
vie… tu fais une œuvre méritoire…
Dans l’intervalle de ces tendres exclamations, la Dupuis baisait son
champion, elle le pinçait, elle le mordait avec les deux uniques chicots
qui lui restaient dans la bouche.
D’un autre côté, le Père, qui était surchargé de vin, ne faisait que
hannequiner ; mais, ce vin commençant à faire son effet, la galerie,
composée des révérends Pères Anselme, Hilaire et de moi, s’aperçut
bientôt que Père Ange perdait du terrain et que ses mouvements cessaient
d’être régulièrement périodiques. « Ah ! b… ! s écria tout à coup la
connaisseuse Dupuis, je crois que tu déb....., chien ; si tu me faisais
un pareil affront !… » Dans l’instant, l’estomac du Père, fatigué par
l’agitation, fait capot, et l’inondation, portant directement sur
la face de l’infortunée Dupuis, au moment d’une de ses exclamations
amoureuses qui lui tenaient la bouche béante, la vieille se sentant
infectée de cette exlibation infecte, son cœur se soulève, et elle paie
l’agresseur de la même monnaie.
Jamais spectacle plus affreux et plus risible en même temps. Le moine s’appesantit, écroulé sur la Dupuis ;
celle-ci fait de puissants efforts pour le renverser de côté ; elle y
réussit. Tous deux nagent dans l’ordure : leurs visages sont
méconnaissables ; la Dupuis, dont la colère n’était que suspendue, tombe
sur Père Ange à grands coups de poing ; mes ris immodérés et ceux des
spectateurs nous ôtent la force de leur donner du secours ; enfin, nous
les joignîmes, et nous séparâmes les champions. Père Ange s’endort ; la
Dupuis se nettoie ; à l’entrée de la nuit, chacun se retire et regagne
tranquillement son manoir.
Après ce beau récit, qui nous apprêta à rire de grand cœur, la Bois-Laurier continua à peu près dans ces termes :
Je ne te parles point du goût de ces monstres qui n’en ont que pour
le plaisir antiphysique, soit comme agents, soit comme patients.
L’Italie en produit moins aujourd’hui que la France. Ne savons-nous pas
qu’un seigneur aimable, riche, entiché de cette frénésie, ne put venir à
bout de consommer son mariage avec une épouse charmante, la première
nuit de ses noces, que par le moyen de son valet de chambre, à qui son
maître ordonna, dans le fort de l’acte, de lui faire la même
introduction par derrière que celle qu’il faisait à sa femme par
devant !
Je remarque cependant que messieurs les antiphysiques
se moquent de nos injures et défendent vivement leur goût, en soutenant
que leurs antagonistes ne se conduisent que par les mêmes principes
qu’eux.
« Nous cherchons tous le plaisir, disent ces hérétiques, par la voie
où nous croyons le trouver. C’est le goût qui guide nos adversaires,
ainsi que nous. Or, vous conviendrez que nous ne sommes pas les maîtres
d’avoir tel ou tel goût. Mais, dit-on, lorsque les goûts sont criminels,
lorsqu’ils outragent la nature, il faut les rejeter. Point du tout ; en
matière de plaisirs, pourquoi ne pas suivre son goût ? Il n’y en a
point de coupables. D’ailleurs, il est faux que l’antiphysique soit
contre nature, puisque c’est cette même nature qui nous donne le
penchant pour ce plaisir. Mais, dit-on encore, on ne peut procréer son
semblable, continuent-ils. Quel pitoyable raisonnement ! Où sont les
hommes de l’un et de l’autre goût qui prennent le plaisir de la chair
dans la vue de faire des enfants ? »
Enfin, continua la Bois-Laurier, messieurs les antiphysiques
allèguent mille bonnes raisons pour faire croire qu’ils ne sont ni à
plaindre ni à blâmer. Quoi qu’il en soit, je les déteste, et il faut que
je te conte un tour assez plaisant que j’ai joué une fois en ma vie à
un de ces exécrables ennemis de notre sexe.
J’étais avertie qu’il devait venir me voir ; et quoique je sois
naturellement une terrible péteuse, j’eus encore la précaution de me
farcir l’estomac d’une forte quantité de navets, afin d’être mieux en
état de le recevoir suivant mon projet. C’était un animal que je ne
souffrais que par complaisance pour ma mère. Chaque fois qu’il venait au
logis, il s’occupait pendant deux heures à examiner mes fesses, à les
ouvrir, à les refermer, à porter le doigt au trou, où il eût volontiers
tenté de mettre autre chose, si je ne m’étais pas expliquée nettement
sur l’article ; en un mot, je le détestais. Il arrive à neuf heures du
soir ; m’ayant fait coucher à plat ventre sur le bord du lit, puis,
après avoir exactement levé mes jupes et ma chemise, il va, selon sa
louable coutume, s’armer d’une bougie, dans le dessein de venir examiner
l’objet de son culte. C’est où je l’attendais. Il mit un genou à terre
et, approchant la lumière et son nez, je lui lâchai, à brûle-pourpoint,
un vent moelleux que je retenais avec peine depuis deux heures ; le
prisonnier, en s’échappant, fit un bruit enragé et éteignit la bougie.

Le curieux se jeta en arrière, en faisant, sans doute, une grimace de
tous les diables. La bougie tombée de ses mains fut rallumée ; je
profitai du désordre et me sauvai, en éclatant de rire, dans une chambre
voisine, où je m’enfermai, et de laquelle ni prières, ni menaces ne purent me tirer, jusqu’à ce que mon homme au camouflet eût vidé la maison.
Ici, Mme Bois-Laurier fut obligée de cesser sa narration par les ris immodérés qu’excita en moi cette dernière aventure
(à suivre)