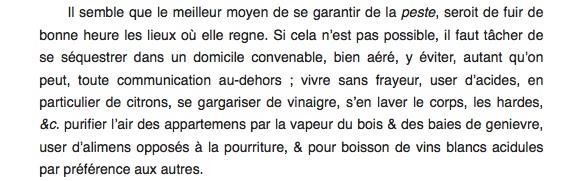La révolution vue par nos lycéens :
(à partir d’un échantillon de 176 copies de lycéens interrogés, sans
aucune préparation préalable sur la consigne suivante : « Raconte la
Révolution française » en un temps limité de 25 minutes.)
par Laurence De Cock, professeure
en lycée à Paris et Université Paris-Diderot
La périodisation de l’événement
Dans quasiment l’intégralité des
copies, la Révolution commence en 1789 et s’achève en 1789. Il arrive même
qu’elle débute puis s’achève le 14 juillet 1789. C’est la seule date qui apparaît
systématiquement. L’année 1790 est inexistante. 1791 est citée une fois, 1792 9
fois ; 1793 3 fois, 1805 une fois, et 1815 une fois. La fétichisation de
l’année 1789 est évidente. Raconter la Révolution française, c’est raconter
1789. Pour autant, la révolution n’est pas sans dénouement. Sans
systématiquement situer l’intrigue dans le temps, la fuite de Varennes
constitue un autre marqueur narratif important. Il arrive d’ailleurs que cette
fuite devienne ce qui a provoqué 1789. Le roi ayant trahi, il est normal que le
peuple se révolte. Varennes est l’élément dramatique par excellence. Il faut
une cause immédiate au soulèvement. La trahison du roi renvoie à une
scénarisation quasi fonctionnelle comme dans le récit ci-dessous d’un élève de
1ère :
Le peuple est contre le Roi et décide de se
soulever. Il y a eu la grande peur car des paysans avaient mis le feu à des
châteaux de Bourgeois. Ils ont peur des représailles. Au travers du serment du
jeu de paume, ils promettent de ne pas abandonner. De plus, le Roi emprisonne
des résistants à la prison de la Bastille. Le Roi veut quitter le château avec
Marie-Antoinette vers l’Autriche mais est reconnu et ramené à Versailles. Il ne
doit plus sortir du château. Le peuple se sent trahi. Ils partent à la Bastille
le 14 juillet 1789 et libèrent les prisonniers. Puis le roi et la reine sont
décapités.
 |
| la trahison du roi aura marqué les esprits |
Les causes
Très peu de copies ne traitent
pas des causes. La question du
« pourquoi » est inhérente au raisonnement
historique. Pour la plupart, les causes ne sont pas « intellectuelles » mais
bien liées à des facteurs économiques et sociaux. Les philosophes des Lumières
ne sont évoqués que 4 fois comme causes. Les élèves notent les impôts, les
inégalités, et les injustices. Les causes sont aussi politiques, notamment le
poids de la « monarchie absolue de droit divin ». Le terme de privilège est
assez rare (10 fois) ; les élèves parlent d’« avantages ». Cette propension à
minorer le rôle des idées est significative d’un raisonnement qui cherche à
capter les raisons immédiatement perceptibles parce qu’en résonance avec un
environnement familier (de la société, de la famille). L’élève va chercher dans
son stock de savoirs sociaux des facteurs explicatifs avec lesquels il a
une proximité intuitive comme en témoigne cet élève de Seconde
qui mobilise un vocabulaire contemporain (chômage) ou approximatif et
dramatique (famine, pendaison).
Suite à plusieurs régimes
désastreux et le mécontentement du peuple face au chômage et la famine, le
peuple décide de s’emparer de la Bastille le 14 juillet 1789 et de libérer les
prisonniers. Le roi Louis XIV à cette époque s’enfuit avec la famille royale
mais il est vite dénoncer et arrêté par les paysans. Peu de temps après ils
furent tous pendus. Cette tragédie est à l’origine de la souffrance du peuple.
En effet les nobles et les bourgeois ne sont pas concernés. Avant les débuts
violents de cette révolution, ils se sont exilés dans les pays où règne la
monarchie afin d’aider le roi a retrouver son trône car ils y voient en même
temps leur propre intérêt.
Les protagonistes
Leur nombre est également très
réduit. On distingue deux types d’acteurs : individuels et collectifs. Le nom
le plus fréquent est celui de Louis XVI (113 fois) mais on trouve aussi parmi
les individus révolutionnaires : Napoléon (12 fois), Robespierre (10 fois),
Danton (2), Desmoulin (1) et une seule femme : Marie-Antoinette (20 fois). La
révolution est donc une affaire d’hommes. Mais la révolution est un geste
surtout collectif. Elle est le fait du peuple, de la population, des Français,
des Parisiens, du Tiers-État, et ses sans-culottes (27 seulement). Les
révolutionnaires ne sont pas divisés. Le terme de Girondins n’apparaît qu’une
fois pour qualifier l’ensemble des révolutionnaires. Pas une seule mention de
la scission entre Montagnards et Girondins, encore moins de la guerre civile et
des contre-révolutionnaires. L’écriture reste irénique et consensuelle.
Les événements
Outre la prise de la Bastille
quasiment systématique, la mort de Louis XVI (non datée) arrive en seconde
position (45 fois). Le serment du jeu de Paume suit (30 fois). Les élèves le
décrivent en détail avec la dramaturgie d’un acte théâtral. S’en suit la fuite
de Varennes (29) détaillée de manière « anecdotique », c’est-à-dire
dépolitisée, comme le moment où tout bascule. La DDHC – parfois uniquement sous
forme d’acronyme – (25 fois); l’abolition des privilèges (5 fois) ; La Terreur
qui n’est mentionnée que 10 fois ; la marche des femmes (1 fois). Il arrive là
encore que le montage ne corresponde pas exactement à la réalité historique
comme chez cet élève de Terminale :
Suite à une volonté de changement de régime
politique, le roi, Louis XVI et ses partisans feront régner ce que l’on
appellera la “Terreur”, c’est à dire la peur d’être guillotiné sous peine de
tel ou tel délit, La délation est alors d’actualité et les morts s’accumulent
accentuant, les tensions au sein de la France. Sous la direction des
philosophes aux idées nouvelles et révolutionnaires, les “sans- culottes”
représentant le Tiers- État, visent à changer de régime et oublier la
monarchie. Des symboles forts tels que la Marseillaise, le chant
révolutionnaire des Français, devenu hymne national, sont créés afin de donner
confiance et force aux révolutionnaires. Le 14 juillet 1789, la Bastille sera
prise par les révolutionnaires et le roi Louis XVI sera guillotiné […].
L’échelle de l’événement est la
France, et plus encore Paris. Il y a très peu d’autres États impliqués dans les
récits d’élèves. L’Autriche et la Prusse apparaissent respectivement trois et
deux fois.
 |
| la prise de la Bastille, événement symbolique |
Qualifications et conséquences de l’événement
La violence apparaît de manière
assez fréquente. On la devine dans l’usage du vocabulaire : « guillotiné », «
décapité »,
« sanglant », « confrontation », etc., comme chez l’élève de
Première ci-dessous :
Pour finir, la révolution fut sanglante, il y
eut énormément de blessés et de morts. Mais le résultat était bien là : le roi
Louis XVI fut destitué de tout pouvoir et la France ne vivait plus sous la
gouverne d’un tyran.
Pour autant, la Révolution n’est
pas toujours une rupture, elle est parfois un simple « changement », un «
mouvement », un « tournant », marquant un « mécontentement », avec des
«
incidents » et de la « rébellion ». Ce sont des qualificatifs minorés.
C’est surtout l’événement qui
sert à valider le modèle républicain et le modèle démocratique. Si nous sommes
dans la république des droits de l’homme, c’est grâce à la Révolution française
comme l’indique cet élève de Première :
[…] Cette révolution est donc l’élément majeur
du changement du 18e siècle car c’est le peuple qui a combattu pour un monde
plus juste. La révolution française a donc abolie les privilèges, il y a eu la
déclaration des droits de l’homme et du citoyen et le suffrage universel
masculin.
Bilan de l’enquête
Le récit scolaire de la
Révolution française relève du récit de fondation à partir d’un événement
inaugurant et clôturant : l’année 1789. La quasi absence d’événements
révolutionnaires (contrairement aux prescriptions) montre le caractère
fossilisé et patrimonialisé de l’année 1789 qui condense l’ensemble de la
révolution. La Révolution française n’a donc pas d’épaisseur historique, elle
est déshistoricisée. Certains moments-clés de l’historiographie sont passés
sous silence. C’est le cas notamment de la Terreur qui avait pourtant le
potentiel tragique typique de la narration scolaire.
 |
| la Terreur n'existe pas... |
La mise en intrigue de la révolution
est naïve et diffère peu du récit lavissien. La tentative d’élargir les
échelles, de faire des causalités intellectuelles ou de conceptualiser est
plutôt un échec. La capacité « raconter » empêche la mise en forme narrative de
la complexité. Le récit continue de fonctionner sur le modèle traditionnel :
impulsion, héros, antihéros, dénouement, chute.
La Révolution française est
déconflictualisée, on saisit mal les enjeux du soulèvement, les demandes
politiques des révolutionnaires et les divisions entre acteurs. Le rapport au
politique est ici consensuel. Le révolutionnaire est une catégorie typique de
l’histoire scolaire qui classe les acteurs selon des typologies considérées
comme facilitant l’appropriation. Ces catégorisations empêchent d’aborder la
complexité des acteurs et des actes et ainsi, les élèves, cherchant à
remobiliser des connaissances dans le cadre scolaire, opèrent une
catégorisation par proximité intuitive, c’est-à-dire que l’intelligibilité de
l’événement opère un détour par le sens commun. Il se produit une socialisation
du savoir historique, forme d’apprivoisement des connaissances historiques qui
transitent par l’immédiateté de l’expérience personnelle des élèves, à savoir
leurs représentations sociales. Cette manière d’imbriquer des savoirs « déjà là
» (savoirs sociaux) et des « savoirs reçus dans et par l’école » (savoirs
scolaires, contenus d’enseignement) produit du raisonnement historique, d’où
des analogies et des anachronismes, comme celui-ci :
Lors de la révolution française, le signe
dominant est la prise de la Bastille le 14 juillet 1789 qui est maintenant la
fête nationale. C’est un grand massacre et en s’attaquant à la Bastille, ils
s’attaquent à l’armée française. (1ère)
Ou encore :
De plus, le Roi emprisonne des résistants à la
prison de la Bastille. (1ère)
Ce phénomène de mise en
conformité entre le sens commun et les savoirs historiques est sans doute
accentué, dans notre cas, par la forte présence sociale de la Révolution française
(commémorations, symboles républicains, fictions, etc.).
On peut pour terminer
s’interroger sur cette conscience historique bricolée du moment
révolutionnaire. La focalisation sur le politique, dans son sens le plus
restrictif, centré autour de la conquête de nouveaux droits (de l’homme),
introduit peut-être une vision excessivement moralisante du fait politique et
complique la réflexion sur la nature révolutionnaire de l’événement, notamment
dans ses usages assumés de la violence.
Quelques élèves tentent pourtant
de mobiliser leurs connaissances historiques pour comprendre le contemporain.
C’est le cas du premier exemple ci-dessous (Terminale) où l’usage de la
première personne et le caractère pamphlétaire de l’écrit témoignent d’une
confusion passé/présent :
Nous sommes en juillet 1789, tout exactement le
14. Nous sommes à la Bastille. Nous prenons celle-ci. Nous nous battons. Nous
souhaitons libérer notre pays de l’emprise du mal : la monarchie absolue de
droit divin. On en a marre que la monarchie nous contrôle. Ce symbole ne sera
plus le symbole de l’État mais le nôtre. Même s’il n’y avait que trois ou
quatre prisonniers, on voulait les libérer pour arrêter cette calomnie ; tout
le monde criait, se battait. C’était le début de la Révolution Française. La
bataille fut rude, on a combattu toutes ces inégalités. Stop à la société
d’ordres et au clergé qui ont tous les droits.
 |
| l'Ancien Régime, c'est "le mal"... (image extraite d'un manuel d'histoire) |
Mais aussi de ce dernier texte
qui tente une projection analogique vers les révolutions arabes :
[…] Le 14 juillet 1789, le peuple a pris la
Bastille. C’était la fin de la monarchie absolue. Louis XVI et sa famille ont
été emprisonnés jusqu’à leur décapitation. Le 26 août 1789, la déclaration des
droits de l’homme et du citoyen ont été écrit pour donner l’égalité pour tout
le monde. Les Français sont égaux. Après cet épisode, la France a connu
plusieurs régimes jusqu’à l’installation réelle d’une démocratie. On peut
comparer relier la révolution française à ce qui se passe dans le monde arabe.
[14] (Terminale)
L’École aurait sans doute un rôle
à jouer pour interroger autrement ce moment révolutionnaire que comme la
matrice d’un « toujours déjà là ». Il s’agirait d’en faire un laboratoire
d’observation des inventions politiques, sociales, économiques et humaines ;
d’en accepter les tâtonnements, les heurts, les violences, les détours et les
surprises. Cela suppose une démarche scolaire totalement novatrice. On
commencerait par varier constamment les focales : monde urbain/rural ;
Paris/province ; métropoles/colonies ; par jouer avec les temporalités :
l’élasticité, les pesanteurs, les accélérations, les usages mémoriels, puis par
accepter une véritable perspective genrée de la Révolution qui ne se réduise
pas à une simple double page désormais obligatoire dans les manuels sur « les
femmes dans la Révolution », comme si les actes de ces dernières pouvaient se
penser sans ceux des hommes.
L’enjeu consiste donc à tenter de
vivifier le sujet. Les élèves s’animent lorsque sont bousculées leurs
représentations et qu’est restituée une historicité à l’événement qu’empêche
toute téléologie ; Quels sont les possibles du moment ? Qu’est-ce qui a eu lieu
? Qu’est-ce qui aurait pu avoir lieu ?
La Révolution française permet
d’interroger autrement les concepts – liste non exhaustive – de violence,
justice/injustice, universel, rapports de domination, redistribution des
richesses, démocratie, ou même de guerre. Elle aide à sortir des catégories
usuelles d’entendement de « valeurs » surdéterminées par un présent au nom
duquel on instrumentalise le passé. C’est pourquoi il ne serait sans doute pas
inutile de revisiter la matrice originelle de son inscription scolaire.