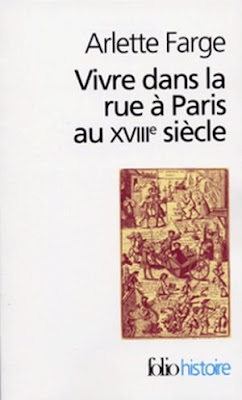Voltaire amoureux ? Pour qui a lu les tribulations sentimentales de cette froide queue, le parti-pris de Clément Oubrerie semblait audacieux. Eh bien, le 1er tome est une réussite ! En voici les premières planches. Bonne lecture.
Si on n'ignore plus rien des auteurs des Lumières, il nous reste tout à apprendre sur les hommes : sur leurs passions, leur courage et leur générosité, mais également sur leurs ambitions, leurs haines et leurs noirceurs. Ecrit au gré de mes humeurs, ce blog raconte mon amour du XVIIIè siècle.
dimanche 18 février 2018
dimanche 11 février 2018
Xavier Martin à propos des Lumières (2)
Xavier Martin, « La dignité de l'homme bafouée par les Lumières »
Professeur émérite à l’Université d’Angers, Xavier Martin est un spécialiste de l’époque révolutionnaire. Ses travaux apportent un éclairage iconoclaste sur la vision de l’homme développée par les philosophes des Lumières.
Extraits d'un entretien paru dans Famille Chrétienne n° 1916 du 4 octobre 2014.
Les Lumières, dit-on, auraient exalté l’homme, et même à l’excès. Or c’est le contraire. Elles nient qu’il ait une âme. Elles le réduisent à la matière, au corporel, et lui dénient la liberté (une pure
« chimère » selon Voltaire, « un mot vide de sens » aux yeux de Diderot). Elles lui attribuent un comportement purement mécanique : « C’est la roue mue par un torrent », dit Helvétius.
« Nous sommes de pures machines », aime répéter Voltaire, qui définira l’homme comme « cette machine qui a, je ne sais comment, la faculté d’éternuer par le nez et de penser par la cervelle ». Sous la Révolution, le médecin Cabanis, héritier des Lumières et spécialiste de la science de l’homme, dira que « le cerveau sécrète les idées comme le foie sécrète la bile », etc. Bref, en ce domaine, les idées reçues sont fort inexactes.
(NDLR : En guise d'idées reçues, citons ce passage de l'article IMMORTALITÉ, IMMORTEL, extrait d' l'Encyclopédie:
qui ne mourra point, qui n’est point sujet à la dissolution et à la mort. Dieu est immortel ; l’âme de l’homme est immortelle, non parce qu’elle est spirituelle, mais parce que Dieu qui est juste, et qui a voulu que les bons et les méchants éprouvassent dans l’autre monde un sort digne de leurs œuvres dans celui-ci, a décidé et a dû décider qu’elle resterait après la séparation d’avec le corps. Dieu a tiré l’âme du néant ; si elle n’y retombe pas, c’est qu’il lui plaît de la conserver. Matérielle ou spirituelle, elle subsisterait également, s’il lui plaisait de la conserver. Le sentiment de la spiritualité et de l’immortalité, sont indépendants l’un de l’autre ; l’âme pourrait être spirituelle et mortelle, matérielle et immortelle. Socrate qui n’avait aucune idée de la spiritualité de l’âme, croyait à son immortalité. C’est par Dieu et non pas par elle-même que l’âme est; c’est par Dieu, et ce ne peut être que par Dieu, qu’elle continuera d’être. Les Philosophes démontrent que l’âme est spirituelle, et la foi nous apprend qu’elle est immortelle, et elle nous en apprend aussi la raison.)
Cette réduction de l'image de l'homme vient d’un excès d’enthousiasme scientiste, donc antireligieux. Les sciences de la matière, alors en plein essor, devraient bientôt – croient ces auteurs – tout expliquer par des formules simples. Tout expliquer ? Y compris l’homme, au premier chef, qu’il faut ipso facto réduire à la matière, c’est-à-dire amputer de sa dimension spirituelle, non mathématisable. D’où le radical antichristianisme des «philosophes».
Leur vision de l’homme est le négatif de celle que propage la Genèse. Ce texte suscite l’horreur des Lumières. Voltaire évoque « toutes les dégoûtantes rêveries dont la grossièreté juive a farci cette fable », considérant que l’Esprit Saint (apparemment mal conseillé) s’y « conforme dans chaque ligne aux idées les plus grossières du peuple le plus grossier ».
Les conséquences sur l'homme de ce rejet de la Genèse sont toutes décisives. Négation, bien sûr, de la dimension spirituelle de l’homme et de sa relation à un Dieu personnel – autrement dit : de ce qui fonde sa dignité. L’idée de l’homme image de Dieu est spécialement insupportable à ces auteurs.
Négation, du même coup, de la congénitale fraternité de tous les hommes. Chose stupéfiante : on crédite les Lumières d’avoir professé (sinon inventé !) l’idée d’unité du genre humain, alors qu’elles ont nié sans détour cette idée, comme un enfantillage issu du christianisme
( NDLR : Xavier Martin devrait nuancer son propos. Et sans doute parcourir l'Encyclopédie dont nous tirons deux nouveaux passages ci-dessous.
Article "HOMME" : Il y a des hommes blancs, des noirs, des olivâtres, des hommes de couleur de cuivre. Voyez les articles Negres, Mulatres, etc. Les hommes ont une physionomie propre aux lieux qu’ils habitent.
Article "NEGRE": NEGRE, s. m. (Hist. nat.) homme qui habite différentes parties de la terre...Tous ces peuples que nous venons de parcourir, tant d’hommes divers sont-ils sortis d’une même mère ? Il ne nous est pas permis d’en douter.).
Négation, encore, de la vocation des deux sexes à une harmonieuse complémentarité. Pour ce courant, homme et femme sont comme étrangers l’un à l’autre. Voltaire parle même de « l’espèce femelle». Moyennant quoi, les relations entre les sexes ne sont qu’un pur rapport de force.
(NDLR : Encore faudrait-il mentionner ici, en toute honnêteté, la négation de la femme en tant qu'individu pensant dans la société du XVIIIè. Louise d'Epinay, Emilie du Châtelet, Louise Dupin, Marie du Deffand et d'autres apportent des témoignages saisissants sur la question, et notamment sur l'instruction qui leur était proposée en ce temps-là. )
Négation, enfin, d’une radicale frontière entre l’humanité et l’animalité. « L’homme et l’animal ne sont que des machines de chair », écrit Diderot, qui avance aussi – notable formule, habilement vicieuse – que « tout animal est plus ou moins homme». (...)
Le contresens sur les Lumières est on ne peut plus actuel : chacun voit bien qu’il est une pièce majeure de notre univers mental ordinaire, médiatico-académique. Paradoxe lourd : c’est au nom des Lumières, matrice réelle du vrai racisme doctrinal, que l’on dénonce continûment divers « racismes » volontiers imaginaires. C’est tout de même un peu fort !
Ensuite, toutes les audaces « bioéthiques » que nous vivons viennent en droite ligne du scientisme des Lumières. Sous l’incertaine pellicule des « droits de l’homme », la science médicale des XIXe et XXe siècles a relayé et amplifié ledit scientisme réducteur (qui est le noyau de l’idéologie nationale-socialiste), pour demeurer au cœur des « avancées » bioéthiques de notre temps.
(NDLR : Encore un raccourci fallacieux entre les Lumières et l'idéologie nazie... Faut-il rappeler que dans son Voltaire méconnu, Xavier Martin avait déjà établi cette même analogie Voltaire-Hitler ?)
Ensuite encore, le féminisme radical, dont nous constatons la vitalité, nous semble bien une réaction trop naturelle à la violente misogynie doctrinale que nous lègue aussi l’esprit des Lumières. (...)
Pour les Lumières, à strictement parler, il n’est pas d’essences proprement humaine, masculine, féminine, familiale, pas de naturelle harmonie des sexes, il est seulement des « animaux » (individuels) « qu’on appelle hommes » (Diderot, Voltaire aiment dire ainsi). Et de toute façon le législateur, bon héritier de ces derniers, décide à sa guise du bien et du mal, et recompose comme ça lui chante les liens interindividuels.
Professeur émérite à l’Université d’Angers, Xavier Martin est un spécialiste de l’époque révolutionnaire. Ses travaux apportent un éclairage iconoclaste sur la vision de l’homme développée par les philosophes des Lumières.
Extraits d'un entretien paru dans Famille Chrétienne n° 1916 du 4 octobre 2014.
 |
| Xavier Martin |
Les Lumières, dit-on, auraient exalté l’homme, et même à l’excès. Or c’est le contraire. Elles nient qu’il ait une âme. Elles le réduisent à la matière, au corporel, et lui dénient la liberté (une pure
« chimère » selon Voltaire, « un mot vide de sens » aux yeux de Diderot). Elles lui attribuent un comportement purement mécanique : « C’est la roue mue par un torrent », dit Helvétius.
« Nous sommes de pures machines », aime répéter Voltaire, qui définira l’homme comme « cette machine qui a, je ne sais comment, la faculté d’éternuer par le nez et de penser par la cervelle ». Sous la Révolution, le médecin Cabanis, héritier des Lumières et spécialiste de la science de l’homme, dira que « le cerveau sécrète les idées comme le foie sécrète la bile », etc. Bref, en ce domaine, les idées reçues sont fort inexactes.
(NDLR : En guise d'idées reçues, citons ce passage de l'article IMMORTALITÉ, IMMORTEL, extrait d' l'Encyclopédie:
qui ne mourra point, qui n’est point sujet à la dissolution et à la mort. Dieu est immortel ; l’âme de l’homme est immortelle, non parce qu’elle est spirituelle, mais parce que Dieu qui est juste, et qui a voulu que les bons et les méchants éprouvassent dans l’autre monde un sort digne de leurs œuvres dans celui-ci, a décidé et a dû décider qu’elle resterait après la séparation d’avec le corps. Dieu a tiré l’âme du néant ; si elle n’y retombe pas, c’est qu’il lui plaît de la conserver. Matérielle ou spirituelle, elle subsisterait également, s’il lui plaisait de la conserver. Le sentiment de la spiritualité et de l’immortalité, sont indépendants l’un de l’autre ; l’âme pourrait être spirituelle et mortelle, matérielle et immortelle. Socrate qui n’avait aucune idée de la spiritualité de l’âme, croyait à son immortalité. C’est par Dieu et non pas par elle-même que l’âme est; c’est par Dieu, et ce ne peut être que par Dieu, qu’elle continuera d’être. Les Philosophes démontrent que l’âme est spirituelle, et la foi nous apprend qu’elle est immortelle, et elle nous en apprend aussi la raison.)
Cette réduction de l'image de l'homme vient d’un excès d’enthousiasme scientiste, donc antireligieux. Les sciences de la matière, alors en plein essor, devraient bientôt – croient ces auteurs – tout expliquer par des formules simples. Tout expliquer ? Y compris l’homme, au premier chef, qu’il faut ipso facto réduire à la matière, c’est-à-dire amputer de sa dimension spirituelle, non mathématisable. D’où le radical antichristianisme des «philosophes».
Leur vision de l’homme est le négatif de celle que propage la Genèse. Ce texte suscite l’horreur des Lumières. Voltaire évoque « toutes les dégoûtantes rêveries dont la grossièreté juive a farci cette fable », considérant que l’Esprit Saint (apparemment mal conseillé) s’y « conforme dans chaque ligne aux idées les plus grossières du peuple le plus grossier ».
Les conséquences sur l'homme de ce rejet de la Genèse sont toutes décisives. Négation, bien sûr, de la dimension spirituelle de l’homme et de sa relation à un Dieu personnel – autrement dit : de ce qui fonde sa dignité. L’idée de l’homme image de Dieu est spécialement insupportable à ces auteurs.
Négation, du même coup, de la congénitale fraternité de tous les hommes. Chose stupéfiante : on crédite les Lumières d’avoir professé (sinon inventé !) l’idée d’unité du genre humain, alors qu’elles ont nié sans détour cette idée, comme un enfantillage issu du christianisme
( NDLR : Xavier Martin devrait nuancer son propos. Et sans doute parcourir l'Encyclopédie dont nous tirons deux nouveaux passages ci-dessous.
Article "HOMME" : Il y a des hommes blancs, des noirs, des olivâtres, des hommes de couleur de cuivre. Voyez les articles Negres, Mulatres, etc. Les hommes ont une physionomie propre aux lieux qu’ils habitent.
Article "NEGRE": NEGRE, s. m. (Hist. nat.) homme qui habite différentes parties de la terre...Tous ces peuples que nous venons de parcourir, tant d’hommes divers sont-ils sortis d’une même mère ? Il ne nous est pas permis d’en douter.).
Négation, encore, de la vocation des deux sexes à une harmonieuse complémentarité. Pour ce courant, homme et femme sont comme étrangers l’un à l’autre. Voltaire parle même de « l’espèce femelle». Moyennant quoi, les relations entre les sexes ne sont qu’un pur rapport de force.
(NDLR : Encore faudrait-il mentionner ici, en toute honnêteté, la négation de la femme en tant qu'individu pensant dans la société du XVIIIè. Louise d'Epinay, Emilie du Châtelet, Louise Dupin, Marie du Deffand et d'autres apportent des témoignages saisissants sur la question, et notamment sur l'instruction qui leur était proposée en ce temps-là. )
Négation, enfin, d’une radicale frontière entre l’humanité et l’animalité. « L’homme et l’animal ne sont que des machines de chair », écrit Diderot, qui avance aussi – notable formule, habilement vicieuse – que « tout animal est plus ou moins homme». (...)
Le contresens sur les Lumières est on ne peut plus actuel : chacun voit bien qu’il est une pièce majeure de notre univers mental ordinaire, médiatico-académique. Paradoxe lourd : c’est au nom des Lumières, matrice réelle du vrai racisme doctrinal, que l’on dénonce continûment divers « racismes » volontiers imaginaires. C’est tout de même un peu fort !
Ensuite, toutes les audaces « bioéthiques » que nous vivons viennent en droite ligne du scientisme des Lumières. Sous l’incertaine pellicule des « droits de l’homme », la science médicale des XIXe et XXe siècles a relayé et amplifié ledit scientisme réducteur (qui est le noyau de l’idéologie nationale-socialiste), pour demeurer au cœur des « avancées » bioéthiques de notre temps.
(NDLR : Encore un raccourci fallacieux entre les Lumières et l'idéologie nazie... Faut-il rappeler que dans son Voltaire méconnu, Xavier Martin avait déjà établi cette même analogie Voltaire-Hitler ?)
Ensuite encore, le féminisme radical, dont nous constatons la vitalité, nous semble bien une réaction trop naturelle à la violente misogynie doctrinale que nous lègue aussi l’esprit des Lumières. (...)
Pour les Lumières, à strictement parler, il n’est pas d’essences proprement humaine, masculine, féminine, familiale, pas de naturelle harmonie des sexes, il est seulement des « animaux » (individuels) « qu’on appelle hommes » (Diderot, Voltaire aiment dire ainsi). Et de toute façon le législateur, bon héritier de ces derniers, décide à sa guise du bien et du mal, et recompose comme ça lui chante les liens interindividuels.
lundi 5 février 2018
Xavier Martin à propos des Lumières
-->
En 2015, l'historien Xavier Martin accordait l'entretien qui suit à la revue L'homme nouveau.
Comme pour son Voltaire méconnu (que nous avions recensé ici), il y aurait une nouvelle fois beaucoup à redire !
Comme pour son Voltaire méconnu (que nous avions recensé ici), il y aurait une nouvelle fois beaucoup à redire !
***
Qu’entend-on
exactement par « esprit des Lumières » ?
Ce qu’on entend par là ? Dans la
rhétorique officielle, uniquement de grandes, belles et bonnes choses. Le XVIIIe
siècle, en France notamment, – Voltaire, Diderot, Rousseau, Montesquieu et
consorts, – aurait enfin brandi la liberté d’expression, découvert et promu la
dignité de l’homme, affirmé haut une unité du genre humain, et compati au sort
des humbles. Il aurait mis à mal les préjugés de sexe et de couleur, œuvré
contre l’absolutisme, et désembué l’esprit humain des obscurantismes religieux,
spécialement catholique… La réalité, telle qu’on la voit dans les écrits des
philosophes, est soit diamétralement contraire, soit pour le moins très
différente, sensiblement plus « composée ». Mais la version
imaginaire, dans l’enseignement, dans les médias, demeure en principe et
omniprésente, et omnipotente. À tout un chacun, notamment ceux qui ambitionnent
la qualité de bachelier, il est donc fort déconseillé d’y contrevenir.
Pourquoi
alors le siècle des Lumières apparaît-il comme malmené par la réforme (ndlr : rappelons au lecteur un brin distrait que le XVIIIè siècle et la Révolution demeurent inscrits au programme de Français en classe de 1ère, ainsi qu'au programme d'Histoire en 2nde...), au point
d’être annoncé comme propre à devenir un thème facultatif ?
Spontanément, je vous dirai que je
n’en sais rien. Ladite annonce me laisse sans voix : j’ai cru d’abord que mes
oreilles me trahissaient. Alors oui, pourquoi ? La France, pays des Lumières,
pays des Droits de l’homme, pays des « valeurs de la République » :
c’est un tout magmatique dans l’inlassable formatage médiatico-académique ici
rappelé. Le sacro-saint anti-racisme (imaginaire), l’idolâtrée (mais sélective)
liberté d’expression se prévalent jour et nuit des Lumières… La perspective de
délaisser à la légère un adossement théoriquement aussi flatteur, de
disqualifier voire mettre au rebut ce resplendissant esprit des Lumières comme
une vieille chaussette, est pour le moins énigmatique, et laisse songeur. La
réponse, escomptais-je, m’allait venir de L’Homme
Nouveau ! Et de guetter le facteur, apprêtant mes besicles et taillant mes
crayons. Votre interrogation, qui inverse les rôles, est donc désarçonnante !
Une Cour européenne des droits de l’abonné devrait bien mettre un terme à ce
type d’abus.
Le temps
d’une réponse, ne pourriez-vous pas vous considérer comme non abonné ?
L’idée est ingénieuse : il suffit d’y
penser ; ce sera, de fait, moins douloureux… Bref, à la question posée, je vois
une seule explication rationnelle, mais j’ai du mal à y souscrire résolument :
depuis vingt ans, une certaine relecture des Lumières a malmené assez vivement
notre vulgate républicaine à cet égard. Elle montre sans grand mal, à la faveur
d’une immense masse de citations, que ce courant, sous maints rapports
déterminants, a été violemment le contraire de ce dont on le crédite : négation
de l’unité de l’espèce humaine, hyper-élitisme forcené, mépris des gens de
couleur, des femmes, des gens de condition modeste, mécanisation du
comportement des individus (le fameux Homme
Machine, 1747), donc négation du libre arbitre et conception mécaniciste
des relations interindividuelles (donc, ipso
facto, sociopolitiques), biologisme scientiste inclinant au racisme et à
l’antiféminisme, absence de confiance dans la raison humaine (oui !),
animalisation du petit peuple… Cette énumération, sévère quoique incomplète,
souffrirait quelques nuances, voire ponctuellement quelques solides
tempéraments, mais elle résume assez nettement la tendance lourde du dossier.
Et, bien sûr, ça change tout ! Le
prestigieux « libre examen » des philosophes (avec l’adulé Sapere aude : ose savoir !) est noble
chose, assurément, mais si l’un d’entre eux se mêle d’en user pour évaluer
(assez chichement) votre degré d’humanité, s’il « ose » vous
« savoir » très voisin du singe et vous en méprise, on vous verra
probablement, et à bon droit, plus réservé quant aux vertus de cette notion
emblématique, et circonspect dorénavant face à ces « humanistes » qui
un jour sur deux, selon leur humeur, vous sous-humanisent. Ose savoir, nous
dit-on en leur nom ? Il faut répondre : chiche ! et les tenir enfin pour ce
qu’ils sont vraiment.
Sur cette profonde et diamétrale
restitution, abondamment documentée, des vraies « Lumières », les
grands médias, comme on s’en doute, ont fait silence. Et néanmoins
l’occultation n’est pas totale. Au moins modestement le vrai, en cette matière,
progresse et s’insinue, et sans bruit, vaille que vaille, par capillarité,
s’infiltre aux interstices. Conséquence : les tireurs de ficelles (s’ils
existent) ont peut-être jugé meilleur d’abandonner sans tambour ni trompette ce
glorieux champ de bataille. Peut-être, à tout le moins, se posent-ils la
question. À parler vrai, c’est peu de dire que l’hypothèse m’en laisse
sceptique, mais, de rationnelle, je n’en vois pas d’autre. Nous reste alors
l’irrationnel : ladite mesure ressortirait, comme fréquemment, à un pur et
simple « n’importe quoi » troussé à la hâte ; ne l’excluons pas :
c’est le plus vraisemblable.
Il est toutefois vrai que depuis le
bicentenaire de la Révolution, qui au fil de colloques richement subventionnés,
avait en fait bien défraîchi l’image convenue de cette dernière, la tendance de
l’idéologie dominante est de prudemment relativiser ses mythes fondateurs de
1789 (donc des Lumières) pour transplanter résolument son camp de base
référentiel autour de 1945. Et je n’exclus pas que la touche (malgré tout)
« nationale » des Lumières et de la Révolution françaises ait pu
devenir aussi, dans le mondialisme aujourd’hui prégnant, un motif d’estompage.
Le tout, néanmoins, laisse assez perplexe.
Quelles
conséquences cet estompage peut-il avoir sur la culture des jeunes Français ?
Question, là encore, délicate. En soi,
il est difficile de déplorer que les élèves échappent à ce massif malentendu
sur les Lumières. Je dis seulement « malentendu », car la grande
masse de ceux qui le propagent, conditionnés à cet effet, sont de bonne foi… ou
peu s’en faut ; les vrais menteurs (éventuellement par omission) sont
concentrés dans le cercle restreint des spécialistes universitaires : ceux qui
« savent », mais verrouillent un savoir différent imposé, aux étapes
décisives des carrières d’enseignement. Sans doute, au surplus, croient-ils ne
mentir que pour la bonne cause, ce qui les aide possiblement à oublier,
cahin-caha, qu’ils ne disent pas la vérité ! Cela noté, l’on ne saurait,
évidemment, imaginer que des talents aussi monumentaux et influents que ceux de
Voltaire, Diderot, Montesquieu ou Rousseau, passent à la trappe ! Pareille
amputation est inimaginable, et il va sans dire, à mon sentiment, qu’elle
n’aura pas lieu. Mais qu’enseigner exactement, à leur sujet ? C’est une tout
autre affaire, et un réel problème.
Justement,
des enseignements d’Histoire à « trous » chronologiques
conservent-ils un sens ?
La réponse théorique est sans réserve
négative, ça va de soi. Cela étant, en tous domaines je me méfie des « il
faut que ». Si par malheur j’étais moi-même en charge pratique des
programmes et manuels, je serais plus qu’embarrassé. Toute pédagogie est
nécessairement simplificatrice d’une complexité, elle-même souvent inextricable
: c’est vrai dans l’Université, ce l’est a fortiori, de façon croissante, en
raison inverse de l’âge des auditeurs. L’Histoire n’est enseignable que très
simplifiée – je n’ajouterai pas « donc très mythifiée », pour ne pas
choquer : mais sur ce point, au minimum, je m’interroge, et ce furtif ballon
d’essai pose la question (c’est bien mon tour). La notion de « roman
national » est plus qu’une formule, et donne à penser. S’agissant de
l’Histoire, il importe au surplus de ne pas négliger un trait élémentaire, qui
ne facilite rien : plus s’accumulent les décennies (et ça va vite !), moins il
est facile de tout maîtriser, d’opérer un tri, de synthétiser. Cette
lapalissade, à titre accessoire, a son importance. Ce qui, pour le grand-père,
continue de tenir à un passé récent, dont l’ignorance, dans les jeunes classes,
annonce la fin des haricots académiques, touche à la nuit des temps pour sa
progéniture. C’est assez naturel.
Qu’on me pardonne d’oser ici un
sentiment tout personnel, qui déplace le problème à défaut d’amorcer la moindre
solution : pour chaque professeur, c’est le haut défi et c’est l’essentiel, de
chercher la voie toujours mystérieuse, d’atteindre la flamme et de l’activer,
au cœur des élèves, avec ferveur, avec respect, avec réserve, sans oublier
l’accompagnement synergétique des anges gardiens, qu’à l’ordinaire sous-évalue
assez sottement le Ministère – c’est là une des clés de son handicap, de la
déprimante phraséologie étalée sur ses pauvres tartines, et de ses tristes
résultats. Cette authentique disposition professorale ? Les « sciences
cognitives » n’ont probablement que peu à y voir, et les
« méthodes » pré-mastiquantes guère davantage, ni les programmes,
souvent biaisés, jamais parfaits, rarement traités en leur entier. Dire que,
dans l’enseignement, la transmission de connaissances est négligeable serait la
première des absurdités. Mais l’essentiel est autre chose. Ladite transmission
est, sinon le prétexte, du moins l’occasion de plus profond qu’elle : cet
imperceptible toucher des âmes, objet de mystère, ambitionné sans crispation,
en vue d’ineffables germinations, parfois à long terme. L’affaire des
programmes en est, malgré tout, relativisée.
mercredi 24 janvier 2018
La peste de 1720 à Marseille , une conférence de Marion sigaut
Marion Sigaut nous fait découvrir Mgr de Belsunce, l'un des héros de la Chrétienté au XVIIIè siècle.
mercredi 10 janvier 2018
Louis XV, par Sainte-Beuve (2)
Ste Beuve rapporte ensuite le récit que fait le duc de Liancourt de la mort de Louis XV.
MÉMOIRES SUR LA MALADIE
LOUIS XV
La maladie d’un roi, d’un roi qui a une maîtresse, et une c.... pour maîtresse; d’un roi dont les ministres et les courtisans n’existent que par cette maîtresse, dont les enfants sont opposés d’intérêts et d’inclination à cette maîtresse, est une trop grande époque pour un homme qui vit et qui est destiné à vivre à la Cour, pour ne pas mériter toutes ses observations. C’est d’ailleurs un événement à peu près unique dans la vie, et qui sert plus qu’aucun autre à la connaissance parfaite de cette classe d’hommes qu’on appelle courtisans. Destiné, comme je l’étais, à voir un jour le roi malade, je m’étais toujours proposé de suivre avec la plus grande attention toute la scène de sa maladie, et tous les différents mouvements qu’elle devait produire. L’idée que j’avais avec toute la Cour de l’effet que ferait sur le roi le second accès de fièvre, rendait à ma curiosité ce moment intéressant. Il me l’était d’ailleurs encore plus par le renvoi, que je regardais comme certain, de sa maîtresse, et par la chute d’un ministre, et d’un ministre odieux, qui devait être la suite nécessaire du renvoi de cette maîtresse. La santé du roi, le soin qu’il en avait, sa vigueur, paraissaient devoir éloigner cet événement, quand tout à coup il arriva au moment où on s’y attendait le moins.
Le mercredi 27 avril au matin,
le roi, étant à Trianon de la veille, se sentit incommodé
de douleurs de tête, de frissons et de courbature. La crainte qu’il
avait de se constituer malade, ou l’espérance du bien que pourrait
lui faire l’exercice, l’engagea à ne rien changer à l’ordre
qu’il avait donné la veille. Il partit en voiture pour la chasse;
mais, se sentant plus incommodé, il ne monta pas à cheval,
resta en carrosse, fit chasser, se plaignit un peu de son mal, et revint
à Trianon vers les cinq heures et demie, s’enferma chez Mme Du Barry,
où il prit plusieurs lavements. Il n’en fut guère soulagé,
et quoiqu’il ne mangeât rien à souper, et qu’il se couchât
de fort bonne heure, il fut plus tourmenté pendant la nuit des douleurs
qu’il avait ressenties pendant le jour, et auxquelles se joignirent des
maux de reins. Lemonnier fut éveillé
pendant la nuit; il trouva de la fièvre. L’inquiétude et
la peur prirent au roi; il fit éveiller Mme Du Barry.
Cependant cette inquiétude du roi ne paraissait encore point fondée, et Lemonnier, qui connaissait sa disposition naturelle à s’effrayer de rien, regardait cette inquiétude plutôt comme un effet ordinaire d’une telle disposition que comme le présage d’une maladie. Il voyait avec les mêmes yeux les douleurs dont le roi se plaignait, et en rabattait dans son esprit les trois quarts, toujours par le même calcul. Voilà ce qui arrive toujours aux gens douillets; ils sont comme les menteurs à force d’avoir abusé de la crédulité des autres, ils perdent le droit d’être crus quand ils devraient réellement l’être. Mme Du Barry, qui connaissait le roi comme Lemonnier, pensait comme lui sur la réalité des douleurs dont le roi se plaignait et s’inquiétait, mais regardait comme un avantage pour elle les soins qu’elle pourrait lui rendre, et l’occupation qu’elle pourrait lui montrer avoir de lui. La bassesse de M. d’A.....la servit parfaitement dans cette circonstance. Ce plat gentilhomme de la chambre, au mépris de son devoir, renonça au droit qu’il avait d’entrer chez le roi, d’en savoir des nouvelles lui-même, de le servir, pour empêcher d’entrer ceux qui avaient le même droit que lui, et pour laisser le roi malade passer honteusement la journée à un quart de lieue de ses enfants, entre sa maîtresse et son valet de chambre. C’est là où commence l’histoire des plates et viles bassesses de M. d’Aumont; elles tiendront quelque place dans ce récit. Il est de cette lâche espèce d’hommes qui n’ont pas même le courage d’être bas et vils pour leurs intérêts, et dont la platitude est toujours au service de celui qui a l’apparence de la faveur.
 |
| Mme du Barry |
Cependant cette inquiétude du roi ne paraissait encore point fondée, et Lemonnier, qui connaissait sa disposition naturelle à s’effrayer de rien, regardait cette inquiétude plutôt comme un effet ordinaire d’une telle disposition que comme le présage d’une maladie. Il voyait avec les mêmes yeux les douleurs dont le roi se plaignait, et en rabattait dans son esprit les trois quarts, toujours par le même calcul. Voilà ce qui arrive toujours aux gens douillets; ils sont comme les menteurs à force d’avoir abusé de la crédulité des autres, ils perdent le droit d’être crus quand ils devraient réellement l’être. Mme Du Barry, qui connaissait le roi comme Lemonnier, pensait comme lui sur la réalité des douleurs dont le roi se plaignait et s’inquiétait, mais regardait comme un avantage pour elle les soins qu’elle pourrait lui rendre, et l’occupation qu’elle pourrait lui montrer avoir de lui. La bassesse de M. d’A.....la servit parfaitement dans cette circonstance. Ce plat gentilhomme de la chambre, au mépris de son devoir, renonça au droit qu’il avait d’entrer chez le roi, d’en savoir des nouvelles lui-même, de le servir, pour empêcher d’entrer ceux qui avaient le même droit que lui, et pour laisser le roi malade passer honteusement la journée à un quart de lieue de ses enfants, entre sa maîtresse et son valet de chambre. C’est là où commence l’histoire des plates et viles bassesses de M. d’Aumont; elles tiendront quelque place dans ce récit. Il est de cette lâche espèce d’hommes qui n’ont pas même le courage d’être bas et vils pour leurs intérêts, et dont la platitude est toujours au service de celui qui a l’apparence de la faveur.
 |
| Lemonnier, l'un des médecins du roi |
Cependant il était trois heures, et personne n’avait
encore pu pénétrer chez le roi. On n’en savait qu’imparfaitement
des nouvelles, et par celles qui transpiraient on jugeait le roi seulement
incommodé d’une légère indisposition. Mme Du Barry
en avait fait part à M. d’Aiguillon, qui était à Versailles,
et avait, d’après ses conseils, formé le projet de faire
rester le roi à Trianon tant que durerait cette incommodité.
Elle passait par ce moyen plus de temps seule auprès de lui, plus
que tout encore elle satisfaisait son aversion contre M. le Dauphin, Mme
la Dauphine et Mesdames, en écartant le roi d’eux, et rendait vis-à-vis
de lui leur conduite embarrassante. L’incertitude où était
Lemonnier de la suite de cette incommodité, l’embarras dont était
dans une chambre aussi petite le service du roi, le scandale et l’indécence
dont ce séjour prolongé devait être, rien ne pouvait
déranger Mme Du Barry de ce projet déraisonnable et indécent,
conçu pour narguer la famille royale. M. d’Aumont s’y prêtait
de toute sa bassesse, et n’avait même mandé à personne
l’état du roi, pour faciliter à cette femme le parti qu’elle
voudrait prendre. La famille royale n’en était même pas instruite
par lui, mais elle l’était d’ailleurs ; et n’osant pas venir, comme
elle l’aurait voulu, pénétrer dans son intérieur pour
savoir de ses nouvelles, elle se bornait à désirer qu’on
le déterminât à revenir à Versailles. La Martinière, sur
la nouvelle de l’incommodité du roi, qui s’était répandue,
avait accouru à Trianon, et y trouva le parti pris d’y faire rester
le roi jusqu’à sa parfaite guérison, que l’on jugeait devoir
être dans deux ou trois jours, cette incommodité n’étant
alors jugée qu’une forte indigestion. Quelque désir qu’eût
Lemonnier de faire revenir le roi à Versailles, il n’avait pas la
force de s’opposer à la volonté de Mme Du Barry. Sa position,
et plus encore son caractère, l’engageaient à tout ménager,
et, ne voulant rien mettre contre lui, il ne pouvait pas avoir cette conduite
franche et assurée, cette décision ferme et inébranlable
qu’à l’honnêteté désintéressée.
Le caractère brusque et décidé de La Martinière
lui donnait cette force. Ce vieux serviteur du roi avait, depuis qu’il
lui était attaché, pris l’habitude de lui parler avec une
liberté qui tenait de la familiarité, et même souvent
de l’indécence. Il ne s’était jamais adressé qu’au
roi pour tout ce qu’il avait obtenu de lui, et avait pris sur son esprit
un ascendant qui le faisait réussir dans tout ce qu’il lui demandait,
et qui même l’en faisait craindre. Il s’était, quatre ans
auparavant, opposé à l’arrivée de Mme Du Barry. Il
savait qu’il lui déplaisait et, sans s’en embarrasser, il n’agissait
pas plus contre elle qu’en sa faveur. La résolution où il
trouva le roi de demeurer à Trianon ne l’empêcha pas de travailler
fortement à l’en détourner, et il y réussit avec facilité
; car le roi, qui n’avait jamais eu dans sa vie la volonté des autres,
n’avait pas plus la sienne dans ce moment. Il fut donc décidé,
malgré le désir obstiné de Mme Du Barry que le roi
partirait pour Versailles dès que les carrosses qu’on avait envoyé
chercher seraient arrivés. Pour donner une idée de la manière
brusque et souvent grossière dont La Martinière parlait au
roi, je rapporterai que le roi, déterminé à suivre
son avis, lui disait, en lui parlant de sa maladie et de la diminution
journalière de ses forces: « Je sens qu’il faut enrayer.
»
—
« Sentez plutôt, lui répliqua La Martinière, qu’il faut dételer. »
« Sentez plutôt, lui répliqua La Martinière, qu’il faut dételer. »
M. de Beauvau, M. de Boisgelin, M. le prince de Condé,
qui, par le manège de M. d’Aumont dont j’ai parlé, n’avaient
pas encore pu voir le roi de la journée, le virent enfin à
quatre heures; et quoiqu’ils le trouvassent très affaissé,
très inquiet et très plaignant, ils jugèrent son état
moins inquiétant et moins douloureux qu’il ne le disait, toujours
par la connaissance de sa pusillanimité. Cependant les voitures
étaient arrivées, et le roi s’était laissé
porter dans son carrosse, se plaignant toujours beaucoup de mal de tête,
de maux de reins, de maux de coeur. Ses plaintes continuelles, ses inquiétudes,
sa profonde tristesse, confirmèrent M. de Beauvau et les autres
dans l’opinion qu’ils avaient de sa faiblesse et de sa peur; et il n’y
avait personne à Trianon ou à Versailles qui imaginât
encore que l’incommodité du roi pût être le commencement
d’une maladie. Cependant tout Paris fut averti que le roi avait resté
dans son lit jusqu’à quatre heures, qu’il était revenu en
robe de chambre et au pas de Trianon, et qu’il s’était couché
en arrivant. Tous les princes, tous les grands officiers arrivèrent;
j’arrivai comme les autres, mais sans beaucoup d’empressement, parce que
je voulais voir, avant de partir de Paris, une personne qui me tenait
plus au coeur que le roi et toute la Cour, et que par parenthèse
je ne vis pas. Je trouvai à mon arrivée
le roi couché. Lemonnier, que je vis, me dit qu’il espérait,
comme tout le monde, que la fièvre du roi cesserait dans la nuit,
mais que son affaissement lui faisait craindre que non, et qu’alors le
lendemain matin il lui demanderait du secours et de choisir un renfort
de médecins. J’appris aussi que la famille royale, qui était
venue le voir à son arrivée, n’y était restée
qu’un instant, et que le roi lui avait dit qu’il l’enverrait chercher quand
il voudrait la voir. Tout cela était l’effet des persécutions
de Mme Du Barry, qui, enragée du retour du roi à Versailles,
voulait se renfermer avec lui autant qu’il serait possible, et en exclure
ses enfants. Quand je dis que Mme Du Barry voulait, j’entends que M. d’Aiguillon
voulait; car cette femme, comme les trois quarts de celles de son espèce,
n’avait jamais eu de volonté. Toutes ses volontés se bornaient
à des fantaisies, et toutes ses fantaisies étaient des diamants,
des rubans, de l’argent. L’hommage de toute la France lui était
à peu près indifférent. Elle était ennuyée
de toutes les affaires dont son odieux favori voulait qu’elle se mêlât,
et n’avait de plaisir qu’à gaspiller en robes et en bijoux les millions
que la bassesse du contrôleur général lui fournissait
avec profusion; soit crainte, soit goût, soit faiblesse, elle était
entièrement livrée aux volontés despotiques de M.
d’Aiguillon, qui, s’en étant servi quatre ans plus tôt pour
se tirer des horreurs d’un procès criminel, l’avait employée
depuis pour l’aider à se venger de tous ses ennemis, c’est-à-dire
de tous les gens honnêtes, et pour se servir de tout le crédit
qu’elle avait sur la faiblesse apathique du roi. Il lui avait conseillé
de tenir le roi à Trianon ; il la pressait actuellement de s’enfermer
le plus souvent avec lui, et d’en écarter les princes et Mesdames.
Il lui conseillait aussi de s’appliquer à ne faire appeler que tard
ceux qui avaient droit d’entrer chez le roi et d’obtenir de lui qu’il les
fit sortir de bonne heure. Il voulait qu’il ne fût livré qu’à
elle et à ceux qu’elle y introduirait. Le roi, comme je l’ai dit,
avait déjà fait acte de soumission en disant à ses
enfants de ne pas revenir sans qu’il les envoyât chercher. Il l’avait
fait encore en n’appelant ses grands-officiers à Trianon qu’à
quatre heures, et en les congédiant à neuf heures et demie;
et voilà vraisemblablement ce qui se serait passé pendant
le cours de la maladie du roi, si elle se fût prolongée sans
devenir plus grave.
 |
| l'agonie de Louis XV |
Je quittai donc Lemonnier, après en avoir appris
l’état du roi, et après avoir su que lui-même en était
exclu par Mme Du Barry, qui y était actuellement renfermée
seule, ou avec M. d’Aiguillon. Cependant la fièvre se soutint dans
la nuit avec assez de force, il y eut même de l’augmentation; les
douleurs de tête devinrent plus fortes, et nous apprîmes à
huit heures du matin qu’on allait saigner le roi. Cette saignée
avait été ordonnée par Lemonnier, d’accord avec La
Martinière. Nous apprîmes aussi qu’on avait été
chercher à Paris Lorry et Bordeu. Lemonnier, suivant son projet
de la veille, avait demandé au roi du secours, et l’avait prié
de choisir ceux des médecins qu’il désirait appeler en consultation.
Il a dit n’en avoir proposé aucun, et cela est vrai; le roi les
avait choisis l’un et l’autre, toujours d’après Mme Du Barry. L’un
était son médecin; l’autre l’était de M. d’Aiguillon;
et celui-ci avait engagé la maîtresse à déterminer
le roi à ce choix, espérant se servir d’eux, suivant ses
besoins, dans le cours de la maladie. Lassonne fut aussi appelé;
mais comme il était médecin de Mme la Dauphine, il le fut
purement du choix de Lemonnier. La nouvelle de la saignée fit arriver
tous les courtisans; ceux qui avaient des charges, ceux qui n’en avaient
pas, tout accourut, et le cabinet se trouva bientôt rempli de gens
qui désiraient savoir des nouvelles du roi et n’avaient aucun moyen
de s’en procurer. Il ne sortait encore presque personne de la chambre,
et ceux qui en sortaient ne parlaient pas; on ne disait rien.
(à suivre)
mercredi 20 décembre 2017
vendredi 15 décembre 2017
Louis XV, par Sainte-Beuve (1)
Un portrait sans concessions de Louis XV par Sainte-Beuve.
Qu’était-ce que Louis XV? On l’a beaucoup dit, on ne l’a pas assez dit : le plus nul, le plus vil, le plus lâche des coeurs de roi. Durant son long règne énervé, il a accumulé comme à plaisir, pour les léguer à sa race, tous les malheurs. Ce n’était pas à la fin de son règne seulement qu’il était ainsi; la jeunesse elle-même ne lui put jamais donner une étincelle d’énergie. Tel on le va voir au sortir des bras de la Du Barry, dans les transes pusillanimes de la maladie et de la mort, tel il était avant la Pompadour, avant sa maladie de Metz, avant ces vains éclairs dont la nation fut dupe un instant et qui lui valurent ce surnom presque dérisoire de Bien-aimé. Il existe un petit nombre de lettres curieuses de Mme de Tencin au duc de Richelieu, écrites dans le courant de 1743; informée par son frère, le cardinal, de tout ce qui se passe dans le Conseil; cette femme spirituelle et intrigante en instruit le duc de Richelieu, alors à la guerre. Rien que ses propres phrases textuelles ne saurait rendre l’idée qu’elle avait du roi; il est bon d’en citer quelque chose ici comme digne préparation à la scène finale qui eut lieu trente ans plus tard.
Qu’était-ce que Louis XV? On l’a beaucoup dit, on ne l’a pas assez dit : le plus nul, le plus vil, le plus lâche des coeurs de roi. Durant son long règne énervé, il a accumulé comme à plaisir, pour les léguer à sa race, tous les malheurs. Ce n’était pas à la fin de son règne seulement qu’il était ainsi; la jeunesse elle-même ne lui put jamais donner une étincelle d’énergie. Tel on le va voir au sortir des bras de la Du Barry, dans les transes pusillanimes de la maladie et de la mort, tel il était avant la Pompadour, avant sa maladie de Metz, avant ces vains éclairs dont la nation fut dupe un instant et qui lui valurent ce surnom presque dérisoire de Bien-aimé. Il existe un petit nombre de lettres curieuses de Mme de Tencin au duc de Richelieu, écrites dans le courant de 1743; informée par son frère, le cardinal, de tout ce qui se passe dans le Conseil; cette femme spirituelle et intrigante en instruit le duc de Richelieu, alors à la guerre. Rien que ses propres phrases textuelles ne saurait rendre l’idée qu’elle avait du roi; il est bon d’en citer quelque chose ici comme digne préparation à la scène finale qui eut lieu trente ans plus tard.
« Versailles, 22 juin 1743... Il faudrait, je crois,
dit-elle, écrire à Mme de La Tournelle (Mme de Châteauroux)
pour qu’elle essayât de tirer le roi de l’engourdissement où
il est sur les affaires publiques. Ce que mon frère a pu lui dire
là-dessus a été inutile : c’est, comme il vous l’a
mandé, parler aux rochers. Je ne conçois pas qu’un homme
puisse vouloir être nul, quand il peut être quelque chose.
Un autre que vous ne pourrait croire à quel point les choses sont
portées. Ce qui se passe dans son royaume paraît ne pas le
regarder : il n’est affecté de rien; dans le Conseil, il est d’une
indifférence absolue; il souscrit à tout ce qui lui est présenté.
En vérité, il y a de quoi se désespérer d’avoir
affaire à un tel homme. On voit que, dans une chose quelconque,
son goût apathique le porte du côté où il y a
le moins d’embarras, dût-il être le plus mauvais. » Et
plus loin: « Les nouvelles de la Bavière sont en pis... On
prétend que le roi évite même d’être instruit
de ce qui se passe, et qu’il dit qu’il vaut encore mieux ne savoir rien
que d’apprendre des choses agréables. C’est un beau sang-froid !
» Elle rappelle au duc de Richelieu la démarche que tenta
Frédéric au commencement de la guerre : ce prince engageait
la France a attaquer la reine de Hongrie au centre, en même temps
que lui, il entrerait en Silésie. « Vous devez vous ressouvenir
que, quand vous vous fîtes annoncer à Choisy, dans un moment
où il était en tête-à-tête avec Mme de
La Tournelle pour lui faire part des propositions du roi de Prusse, il
ne montra aucun empressement pour recevoir l’envoyé, qui voulait
lui parler sans conférer avec les ministres. Ce fut vous qui le
pressâtes de vous donner une heure pour le lendemain ; vous fûtes
étonné vous-même, mon cher duc, du peu de mots qu’il
articula à cet envoyé, et de ce qu’il était comme
un écolier qui a besoin de son précepteur. Il n’eut pas la
force de se décider ; il fallut qu’il recourût à ses
Mentors... Le roi de Prusse jugeait Louis XV d’après lui ;... mais
il avait mal vu, et ne tarda point d’abandonner un allié dont il
reconnaissait la nullité, quand il eut retiré tous les avantages
qu’il attendait de la campagne.»
Le roi ira-t-il ou non à l’armée? il fallut
monter à cet effet toute une machine: « Mon frère,
écrit Mme de Tencin, ne serait pas très éloigné
de croire qu’il serait très utile de l’engager à se mettre
à la tête de ses armées. Ce n’est pas qu’entre nous
il soit en état de commander une compagnie de grenadiers; mais sa
présence fera beaucoup; le peuple aime son roi par habitude, et
il sera enchanté de lui voit faire une démarche qui lui aura
été soufflée. Ses troupes feront mieux leur devoir,
et les généraux n’oseront pas manquer si ouvertement au leur...
» On touche là les ficelles de la campagne tant célébrée
de 1744.
 |
| le bien-aimé |
Nous pourrions multiplier ces citations accablantes :
« Rien dans ce monde ne ressemble au roi, » écrit-elle
en le résumant d’un mot. Tel était Louis XV dans toute sa
force et dans toute sa virilité, à la veille de ce qu’on
a appelé son héroïsme : ce qu’il devint après
trente années encore d’une mollesse croissante et d’un abaissement
continu, on le va voit lorsque, dans sa peur de la mort, il tirera la langue
quatorze fois de suite pour la montrer à ses quatorze médecins,
chirurgiens et apothicaires.
On ne peut s’empêcher de penser, à bien regarder
la situation de la France au sortir du ministère du cardinal de
Fleury, que si le duc de Choiseul et Mme de Pompadour elle-même n’étaient
venus pour s’entendre et redonner quelque consistance et quelque suite
à la politique de la France, la révolution, ou plutôt
la dissolution sociale, serait arrivée trente ans plus tôt,
tant les ressorts de l’État étaient relâchés
! Et la nation, les hommes de 89, qui se formulent à l’amour du
bien public, à l’aspect de toutes ces bassesses; n’auraient pas
été prêts pour ressaisir les débris de l’héritage
et donner le signal d’une ère nouvelle.
Il y avait, rappelons-le pour ne pas être injuste
dans notre sévérité, il y avait, au sein de ce Versailles
d’alors et de cette Cour si corrompue, un petit coin préservé,
une sorte d’asile des vertus et de toutes les piétés domestiques
dans la personne et dans la famille du Dauphin, père de Louis XVI.
Ce prince estimable et tout ce qui l’entourait, sa mère, son épouse,
ses royales soeurs, toute sa maison, faisaient le contraste le plus absolu
et le plus silencieux aux scandales et aux intrigues du reste de la Cour.
Il serait touchant de rapprocher les détails de sa fin prématurée
et sa mort si courageusement chrétienne, de la triste agonie du
roi son père. On raconte qu’à son dernier automne (1765),
ayant désiré revoir à Versailles le bosquet qui portait
son nom et dans lequel s’était passée son enfance, il dit
avec pressentiment, en voyant les arbres à demi dépouillés
: « Déjà la chute des feuilles! » Et il ajouta
aussitôt: « Mais on voit mieux le ciel ! » Nous avons
en ce moment sous les leur une suite d’anecdotes et de particularités
intéressantes sur ce fils de Louis XV, qu’a rassemblées M.
Varin, conservateur à la bibliothèque de l’Arsenal, et nous
y reviendrons peut-être quelque jour; mais aujourd’hui il nous a
paru utile de présenter isolément, et sans correctif, le
spectacle d’une mort beaucoup moins belle, et qui, dans ses détails
les plus domestiques (c’est le lot des monarchies absolues), appartient
de droit à l’histoire.
Le Dauphin, fils de Louis XV, quelque hommage qu’on soit
disposé à rendre à ses qualités et à
ses vertus, n’était pas de ceux desquels on peut dire autrement
que par une fiction de poète; Tu Marcellus eris; tout en
lui révèle un saint, mais c’était un roi qu’il eût
fallu à la monarchie et à la France. Louis XVI, héritier
des vertus de son père, ne sut pas être ce roi, et rien n’autorise
à soupçonner que le père lui-même, s’il eût
vécu, eût été d’étoffe à l’être.
Il reste clair pour tous qu’avec Louis XV mourant, la monarchie était
condamnée déjà, et la race retranchée. Voyons
donc comment Louis XV était en train de mourir.
On ne dira pas: Voilà comment meurent les voluptueux,
car les voluptueux savent souvent finir avec bien de la fermeté
et du courage. Louis XV ne mourut pas comme Sardanapale, il mourut comme
mourra plus tard Mme Du Barry, laquelle, on le sait, montée sur
l’échafaud, se jetait aux pieds du bourreau en s’écriant,
les mains jointes : « Monsieur le bourreau, encore un instant! »
Louis XV disait quelque chose de tel à toute la Faculté assemblée.
Et quel était donc celui qui va épier et
prendre ainsi sur le fait les pusillanimités et les misères
du maître durant sa maladie suprême? Dans cette ancienne monarchie,
les rois et les grands ne songeaient pas assez à qui ils se révélaient
ainsi dans leur déshabillé et dans leur ruelle. Parmi cette
foule de courtisans qui se livraient au torrent de chaque jour, et qui
songeaient à profiter de ce qu’ils observaient sans le dire, il
se rencontrait parfois des écrivains et des peintres, des moralistes
et des hommes. Qu’on relise les surprenantes et incomparables pages de
Saint-Simon où revivent les scènes si contrastées
de la mort au grand Dauphin: les princes avaient parfois de tels historiographes
à leur Cour sans s’en douter. Les Condé logeaient dans leur
hôtel La Bruyère. La duchesse du Maine avait parmi ses femmes
cette spirituelle Delaunay qui a écrit: « Les grands, à
force de s’étendre, deviennent si minces, qu’on voit le jour au
travers; c’est une belle étude de les contempler, je ne sais rien
qui ramène plus à la philosophie. » Et encore : «
Elle (la duchesse du Maine) a fait dire à une personne de beaucoup
d’esprit que les princes étaient en morale ce que les monstres
sont dans la physique: on voit en eux à découvert la plupart
des vices qui sont imperceptibles dans les antres hommes. » C’est
en effet dans cet esprit qu’il faut étudier les grands, surtout
depuis qu’on a appris à connaître les petits : ce n’est pas
tant comme grands que comme hommes qu’il convient de les connaître.
De tout autres qu’eux à leur place auraient fait plus ou moins de
même. La vraie morale à en tirer, c’est, sans s’exagérer
le présent, et tout en y reconnaissant bien des grossièretés
et des vices, de ne jamais pourtant regretter sérieusement un passé
où de telles monstruosités étaient possibles, étaient
inévitables dans l’ordre habituel.
 |
| mort de Louis XV |
L’homme qui a écrit les pages qu’on va lire n’est
pas difficile à deviner et à reconnaître son grand-père
(lui-même nous l’indique) était collègue d’un duc de
Bouillon durant la maladie du roi à Metz, en 1744, et le voilà
qui se trouve à son tour côte à côte d’un due
de Bouillon dans cette maladie royale de 1774. Il nomme chacun des principaux
seigneurs qui sont en fonction autour de lui, et s’en distingue; il n’est
donc ni le grand-chambellan (M. de Bouillon), ni le premier gentilhomme
de la chambre (M. d’Aumont); ce ne peut être que leur égal,
le grand-maître de la garde-robe en personne, M. le duc de Liancourt,
qui avait alors la survivance du duc d’Estissac, son père, et qui
s’exerçait la charge; c’est celui même que tout le monde a
connu et vénéré sous le nom de duc de La Rochefoucauld-Liancourt,
et qui n’est mort qu’en mars 1827. Voilà le témoin, un des
plus vertueux citoyens, un homme de 89, tel qu’il s’en préparait
à cette époque dans tous les rangs, et particulièrement
au sein de la jeune noblesse éclairée et généreuse.
De pareils spectacles, il faut en convenir, étaient bien propres
à exciter de nobles coeurs et à leur donner la nausée
des basses intrigues. Si l’on veut connaître le duc de La Rochefoucauld-Liancourt,
sa vie est partout, son souvenir revit dans de nombreuses institutions
de bienfaisance. Ce fut lui qui, grâce à cette même
charge de grand-maître de la garde-robe, pénétrant
de nuit jusqu’à Louis XVI, le faisant réveiller pour lui
apprendre la prise de la Bastille, et lui entendant dire comme première
parole : C’est une révolte!
lui répondit : Non,
Sire, c’est une révolution ! Tel est l’homme qui, jeune et condamné
par les devoirs de sa charge à subir le spectacle des derniers moments
de Louis XV, eut l’idée de nous en frire profiter. Ami de M. de
Choiseul, ennemi du ministère d’Aiguillon et de la maîtresse
favorite, il eût pu dire aux approches du danger, comme Saint-Simon
à la nouvelle de la mort de Monseigneur: « La joie néanmoins
perçoit à travers les réflexions momentanées
de religion et d’humanité par lesquelles j’essayois de me rappeler.
» A nos yeux comme aux siens, est-il besoin d’en avertir? de pareils
récits et les turpitudes mêmes où ils font passer ont
un sens sérieux: la nécessité et la légitimité
de 89 sont au bout, comme une conséquence irrécusable. La
scène où l’on réveille Louis XVI et le contrecoup
fatal de celles où, quinze ans auparavant, on suivait la fin honteuse
de Louis XV. L’enseignement historique ressort avec toute sa gravité.
C’est dans cette conviction qu’en livrant ces pages au public, nous sommes
assuré de ne manquer en rien ni à la mémoire ni à
la pensée de celui qui les a écrites.
Nous reproduisons la copie qui est entre nos mains, sans
chercher à y apporter même la correction, ni à plus
forte raison, l’élégance. M. Lacretelle, qui fut attaché
au duc de Liancourt, comme secrétaire intime pendant les premières
années de la Révolution, a raconté, dans un intéressant
chapitre de ses Dix années d’épreuves, comment on
vivait à Liancourt, en cette sorte de paradis terrestre, et quelles
occupations rurales, bienfaisantes ou littéraires y variaient les
heures : « Après de laborieuses recherches, écrit M.
Lacretelle, après avoir dépouillé une vaste et touchante
correspondance, il (le duc de Liancourt) rédigeait ses Mémoires, les soumettait à ma critique, à ma révision. J’avoue
que ce fut d’abord pour moi une torture que de chercher des embellissements
à un travail tout uni, mais parfaitement conforme au sujet. Mon
style me paraissait à moi-même trop ambitieux et trop fleuri.
Je voyais bien l’auteur en portait tout bas le même jugement ; Il
me dit un jour : Ma prose fait tache dans la vôtre. Ce compliment
plus ou moins sincère fut pour moi un avertissement d’user avec
réserve de mon métier de polisseur. Plus j’y mis de discrétion
et d’économie, et mieux nous nous entendîmes. » Nous
ne nous sommes pas même
cru en droit de nous permettre ce soin si
sobre ; à part un ou deux endroits où la copie était
évidemment fautive, nous en avons respecté tout le négligé.
Cette copie provient de celle que possède la Bibliothèque
de l’Arsenal, et qui, perdue dans la masse des papiers de M. de Paulmy,
a été récemment retrouvée par M. Varin.
(à suivre ici)
(à suivre ici)
lundi 11 décembre 2017
lundi 4 décembre 2017
Bibliothèque Médicis, avec Arlette Farge
Spécialiste du XVIIIè siècle, Arlette Farge est un véritable puits de science pour tout ce qui concerne le Paris des Lumières.
mercredi 29 novembre 2017
vendredi 24 novembre 2017
Marion Sigaut - La Révolution Française, la France et l'Histoire
On connaît le propos de Tocqueville selon qui "La Révolution a
achevé soudainement, par un effort convulsif et
douloureux, sans transition, sans précaution, sans
égards, ce qui se serait achevé peu à peu
de soi-même à la longue." Et d'ajouter : "Si
elle n'eût pas eu lieu, le vieil édifice social
n'en serait pas moins tombé partout, ici plus tôt,
là plus tard".
Bon, chez nous, ce fut assez tôt, notamment pour les raisons mentionnées ici par Marion Sigaut : une dette abyssale qui n'a cessé de se creuser tout au long du siècle, des guerres ruineuses (celle de 7 ans, celle d'Amérique).
Ecoutons les 10 premières de cette conférence, elles décrivent assez justement les derniers soubresauts d'une monarchie agonisante.
La suite n'est pas au niveau : prétendue complicité entre jansénistes et Encyclopédistes, affaire Calas, Necker poursuivant la politique de Turgot...
Un conseil : (re)lisez quelques passages de Tocqueville ici !
Bon, chez nous, ce fut assez tôt, notamment pour les raisons mentionnées ici par Marion Sigaut : une dette abyssale qui n'a cessé de se creuser tout au long du siècle, des guerres ruineuses (celle de 7 ans, celle d'Amérique).
Ecoutons les 10 premières de cette conférence, elles décrivent assez justement les derniers soubresauts d'une monarchie agonisante.
La suite n'est pas au niveau : prétendue complicité entre jansénistes et Encyclopédistes, affaire Calas, Necker poursuivant la politique de Turgot...
Un conseil : (re)lisez quelques passages de Tocqueville ici !
samedi 18 novembre 2017
mercredi 15 novembre 2017
vendredi 3 novembre 2017
Le supplice de Damiens
-->
Pour remercier les fidèles, cet extrait de mon Louise d'Epinay, paru ce printemps aux éditions Sutton.
Son rêve
commençait par une clameur, d’abord lointaine, en provenance du quai Pelletier
où les pataches et les bateaux-lavoirs s’étaient amassés dès l’aube dans
l’attente du convoi. Sur la place de Grève, encore bruyante un instant plus
tôt, tout le monde fit silence. Parmi le public massé autour des barrières,
quelques hommes jouèrent des coudes pour gagner les premiers rangs et ne rien
rater du spectacle. Au-dessus de leurs têtes, accoudés aux fenêtres de l’hôtel
de ville, les échevins bénéficiaient d’un point de vue privilégié, tout comme
les spectateurs assis aux balcons des maisons qui surplombaient la place. Ils
furent les premiers à voir apparaître les soldats de la Garde française,
peut-être une dizaine, qui entrèrent sur l’esplanade encouragés par les
vociférations de la foule. Sur un ordre de leur supérieur, les hommes rompirent
alors les rangs et vinrent se disposer tout le long de l’enceinte, les armes à
la main. Lorsque le tombereau apparut à l’angle des bâtiments, encadré par une
escouade de suisses, il fut accueilli par une nouvelle acclamation. Tiré par
deux chevaux, le chariot pénétra lentement sur la place, et chacun put enfin
découvrir les traits du futur supplicié. Vêtu d’une veste sombre, d’une chemise
couleur de soufre et d’une culotte, Robert-François Damiens était agenouillé à
l’arrière du tombereau, tête basse, une main posée sur un montant et dans
l’autre une torche ardente qu’il tenait aussi droite que possible, malgré son
état de faiblesse. Comme les cris et les invectives redoublaient, il releva les
yeux et affronta le public du regard. L’homme avait le visage long, le teint
basané, la barbe et le regard noirs. Plus tard, parmi ceux qui racontèrent son
exécution, certains jurèrent qu’il avait souri, qu’il les avait toisés avec
hauteur et d’un air provocant. De l’endroit où il se tenait, à l’extrémité sud de
la place, l’abbé Martin ne voyait rien de tout cela. Il demeurait immobile, les
bras croisés sur la poitrine, pendant que du bout des doigts il serrait
nerveusement le crucifix glissé sous sa chape. Autour de lui, massés contre la
rambarde, les spectateurs essayaient tant bien que mal de se dégager une vue
sur l’échafaud, situé à une trentaine de pas de là. Deux soldats venaient
d’extraire le condamné du tombereau. Comme ses jambes ne le portaient plus, il
fut soulevé, enveloppé dans une couverture, jusqu’aux premières marches de l’hôtel
de ville, avant d’être jeté à terre sans ménagement. Les portes s’ouvrirent, et
lorsque l’archevêque apparut sur le seuil et qu’il se pencha sur le condamné
afin de recueillir sa demande de réparation, tout le monde tendit l’oreille
dans l’espoir d’entendre les derniers mots du régicide. Pendant les dix minutes
que dura l’entrevue, même les vendeurs de boissons firent silence, jusqu’à ce
que le prélat se relève enfin et fasse signe aux exécuteurs d’emmener leur
prisonnier. Légèrement surélevé, l’échafaud mesurait environ huit pieds de long
sur quatre de large. Pour l’occasion, le bourreau de Paris était secondé par
une dizaine d’officiers venus des villes voisines, et par deux confesseurs,
tout de noir vêtus, qui se pressèrent aussitôt autour du condamné pour
l’enjoindre de baiser le crucifix. L’homme laissa tomber la tête vers l’avant
et l’abbé Martin entendit à quelques pas de lui une voix féminine qui
s’écriait :
« Le monstre !
Il a craché sur la croix ! »
Cela provoqua
un mouvement de foule auquel les gardes répondirent en se resserrant, les armes
levées, le long des solives qui barraient l’accès à la place. Dans le tumulte
qui s’ensuivit, personne ne prêta attention à la lecture de l’arrêt de justice.
On n’avait plus d’yeux que pour les bourreaux qui retiraient leurs fourneaux du
foyer et les rapprochaient précautionneusement de l’échafaud, où Damiens venait
d’être sanglé, couché sur la table de supplice, à l’aide de cercles de fer qui
le maintenaient par les épaules et jusqu’à la ceinture. Quand il fut allongé,
les deux confesseurs vinrent s’agenouiller à ses côtés, le crucifix brandi
devant eux, pour l’exhorter dans ses derniers instants.
« Dieu
tout-puissant, faites grâce à ce malheureux pour la rémission de ses péchés… »
Les quelques
mots murmurés par l’abbé se perdirent dans le tumulte de cris et d’injures qui
déferlait sur la place. Le clerc lança un regard désespéré vers le balcon central
de l’hôtel de ville, où l’archevêque s’était avancé pour donner le signal aux
bourreaux.
Déjà, l’un
d’eux s’était détaché du groupe, tenant au-dessus de sa tête l’arme du crime,
un petit canif dont Damiens s’était servi pour perpétrer son forfait. Il
s’approcha lentement du prisonnier, se pencha sur son corps, et après avoir
donné l’ordre de le maintenir, il poignarda d’un mouvement sec la main qui
avait attenté à la vie du roi. La lame traversa les os et vint se ficher
jusqu’à la garde dans le support en bois. L’un des exécuteurs lâcha alors le
bras du condamné et versa sur le membre une solution soufrée à laquelle son
acolyte mit aussitôt le feu à l’aide d’une torche. Sous l’effet de la brûlure,
Damiens se cabra violemment, tirant en vain sur les ceintures métalliques qui
l’entravaient. Une odeur de chair grillée envahit instantanément la place,
soulevant le cœur de certains spectateurs pendant que d’autres rendaient leur
dîner sous eux. Aux fenêtres et aux balcons des maisons, on vit quelques dames
porter leur mouchoir devant leur nez, ce qui suscita l’hilarité générale.
« Les
garces ont payé près de dix livres pour ne rien rater du spectacle, gueula
quelqu’un, et voilà qu’elles se trouvent mal !
- Ne crains
rien, beugla un autre, elles vont tout de même en mouiller leurs dessous ! »
Le bon mot
provoqua de nouveaux rires, bientôt interrompus par la vue des bourreaux qui
s’avançaient vers le supplicié en exhibant au-dessus de leur tête des tenailles
dentelées et rougies au feu.
« Cette
fois, il va brailler ! » se réjouit une jeune femme en battant des
mains.
Un exécuteur
avait empoigné Damiens pour lui déchirer sa chemise. Lorsque ses adjoints
appliquèrent leurs pinces sur la chair de son ventre, l’homme se raidit et
poussa un long cri de douleur. D’un mouvement tournant, les deux tortionnaires
lui arrachèrent un large lambeau de peau, et à l’aide d’une louche, un
troisième versa sur les blessures une coulée de plomb fondu, puis un filet
d’huile bouillante. Le condamné se souleva à nouveau, sans un murmure cette
fois, mais il se tourna vers ses confesseurs comme pour les implorer de mettre
fin à ses tourments. Les deux hommes se courbèrent pour mieux l’entendre, et il
se passa un long temps avant qu’ils se relèvent et ordonnent aux préposés de
poursuivre leur œuvre.
« Mon
Dieu, comment pouvez-vous tolérer une telle horreur ? » protesta
l’abbé d’une voix faible, pendant qu’autour de lui les gueulements
redoublaient.
Les officiers
s’attaquèrent ensuite aux mamelons, qu’ils arrachèrent encore grésillants avant
de les présenter triomphalement au public.
Damiens hurla
quelques mots, rendus inintelligibles par l’hystérie qui avait gagné la foule.
Certains braillaient à tue-tête, invectivant le malheureux, pendant que
d’autres encourageaient les bourreaux à se montrer plus cruels encore. Tout près
de lui, Martin vit même une jeune femme, une lavandière sans doute, se tourner
vers son compagnon pour l’embrasser à pleine bouche. Le clerc sentait ses
jambes se dérober sous lui. Incapable d’émettre la moindre plainte, il n’avait
plus d’yeux que pour cet archevêque, son supérieur, qui demeurait impassible,
une main posée sur la rampe du balcon, toujours attentif à l’horreur qui se
déroulait sous son regard complice.
« Soyez
maudit ! » fulmina l’abbé en serrant les poings.
Sa protestation
fut interrompue par un énergumène qui le bouscula pour se frayer un passage
jusqu’aux premiers rangs, où il héla un soldat de la garde.
« Laissez
passer, dit ce dernier en ricanant, monsieur est un amateur ! »
Sa plaisanterie
provoqua quelques moqueries, mais comme l’homme était en grande tenue et qu’il
portait l’épée au côté, on le laissa s’avancer jusqu’à la barrière, au plus
près de l’échafaud. Martin le vit sortir un cornet de sa veste et le porter à
son oreille afin d’entendre plus distinctement les plaintes du supplicié.
Je connais cet
homme, songea l’abbé qui le voyait de trois quarts, sans parvenir à se souvenir
où il l’avait rencontré par le passé. Peut-être à Groslay dans sa
paroisse ? Ou encore chez monsieur d’Épinay, à La Chevrette1 ?
Une nouvelle
clameur ramena le clerc à lui-même. Les suisses venaient de faire entrer quatre
chevaux sur la place, accueillis par les bourreaux qui tirèrent les animaux par
le harnais et les alignèrent par paires à l’extrémité de l’échafaud, tournés en
direction de la Seine. Damiens, qui ne comprenait pas ce qui se passait dans
son dos, essaya tant bien que mal de se contorsionner pour tourner la tête.
L’un des exécuteurs lui passa alors une grosse corde autour de chaque jambe, la
serra dans un nœud coulant sur la hanche, puis l’appliqua le long des cuisses
jusqu’aux pieds, pendant qu’un de ses adjoints enserrait soigneusement ses
membres avec de fines cordelettes. Lorsque l’opération fut achevée, les deux
hommes tirèrent les cordes vers l’arrière et vinrent les fixer, chacun de leur
côté, au pommeau d’une selle. Le condamné se trouva bientôt jambes par-dessus
tête, les pieds à l’oblique, et retenu à la taille par l’épais cercle de fer
qui le maintenait plaqué contre l’échafaud. Les spectateurs retenaient leur
souffle, frémissants d’impatience et impressionnés par le savoir-faire des
tortionnaires. Ces derniers répétèrent la même manœuvre, très lentement,
garrottant les deux bras de Damiens avant de tendre les liens jusqu’aux
chevaux. Il y eut un long moment de flottement durant lequel les confesseurs
adressèrent quelques admonestations au prisonnier, mais cette fois-ci, malgré
ses souffrances, le pauvre diable refusa de leur répondre.
La première
secousse lui arracha un nouveau hurlement.
Dans
l’assistance, on eut l’impression que ses membres s’allongeaient vers
l’arrière, qu’ils s’étiraient à n’en plus finir, jusqu’à ce que l’exécuteur
relâche enfin la bride des chevaux et détende les cordes. En qualité de maître
d’œuvre, le bourreau de Paris se tenait à côté de l’échafaud, une montre à la
main. Il compta une trentaine de secondes et donna le signal de la deuxième
secousse. Les premiers rangs du public jurèrent par la suite qu’ils avaient
entendu un craquement, sans doute provoqué par le déboîtement des membres
inférieurs. Lorsque la pression se relâcha, la vue des jambes reposant inertes
et dans un angle improbable sur les planches de l’échafaud provoqua un murmure
horrifié parmi les spectateurs les plus proches. À côté de lui, l’abbé vit la
petite lavandière porter les mains devant ses yeux et se mordre les lèvres
d’effroi. D’autres exultaient au contraire, d’autant que le supplicié demeurait
conscient et que la douleur lui arrachait d’interminables râles entrecoupés de
jurements.
Bien qu’on eût
pris soin de dépaver l’enceinte, les fers des chevaux avaient glissé dans le
sable, et malgré les efforts du bourreau, les secousses suivantes demeurèrent
infructueuses. L’homme agonisait mais ses membres tenaient bon. On amena alors
deux nouvelles bêtes, qu’on joignit aux autres, et pendant qu’on fixait de
nouveaux liens, le maître d’œuvre s’approcha du condamné, et à l’aide d’un
poignard tranchant, il coupa d’un mouvement preste les nerfs qui retenaient ses
jambes et ses bras.
À l’absence de
plainte, chacun devina que le martyre arrivait à son terme.
Cette fois, les
six bêtes furent lancées au trot, arrachant sans même ralentir les deux bras et
l’une des jambes. Damiens ouvrit une dernière fois la bouche, le buste tendu
vers le ciel, puis il retomba sans vie contre la table, ce qui déchaîna un
tonnerre d’applaudissements. Le bourreau détacha alors les trois membres avant
de les jeter sur l’échafaud. Un autre défit le corps du défunt et dans un
mouvement circulaire, il présenta son buste sanguinolent à la foule qui salua
son geste avec frénésie. Ce qui restait du régicide fut jeté au feu. Sous
l’effet du soufre mêlé à l’huile, la chair s’embrasa comme une torche,
soulevant une fumée noire et malodorante qui fit reculer les exécuteurs.
Encadrée par
les soldats du guet, la foule commençait déjà à se disperser. Dix-sept heures
venaient de sonner à l’horloge du campanile. Pour les habitants des quartiers
aisés, c’était l’heure de se rendre à l’Opéra ou dans leurs cercles, où ils
devaient être attendus avec impatience. Les autres, ceux des faubourgs
populaires, pourraient toujours descendre jusqu’aux cafés du Palais-Royal pour
y boire quelques pintes de bière et échanger leurs impressions. Au passage,
certains s’inclinèrent devant l’archevêque qui, appuyé au balcon, leur répondit
d’un imperceptible mouvement de tête.
La communion
dans l’horreur, songea tristement l’abbé Martin, à qui les larmes venaient aux
yeux en voyant défiler ces hommes et ces femmes, tous repus de haine et de mort
maintenant qu’on leur avait accordé leur pitance.
Lorsqu’il
tourna à son tour le dos au bûcher, le jeune clerc sentit qu’un feu sans nom
avait embrasé ses entrailles et qu’il ne tarderait pas à l’emporter corps et
âme dans des abîmes de souffrance.
1 L’allusion au cornet nous
incite à penser qu’il s’agit de monsieur de La Condamine (qui était
malentendant), le seul parmi les intellectuels des Lumières à avoir assisté à
l’exécution. Pourtant, à notre connaissance, l’homme n’a jamais fréquenté le
cercle de la famille d’Épinay.
Inscription à :
Articles (Atom)